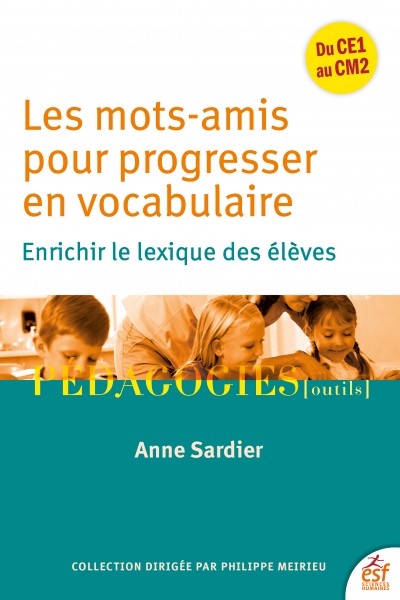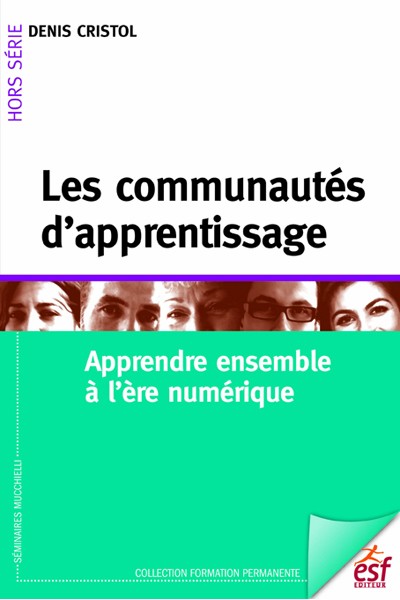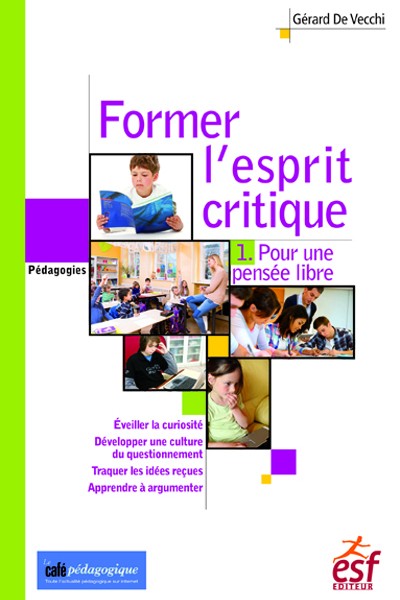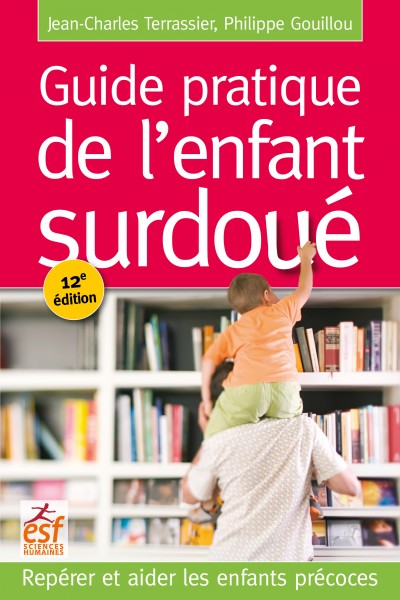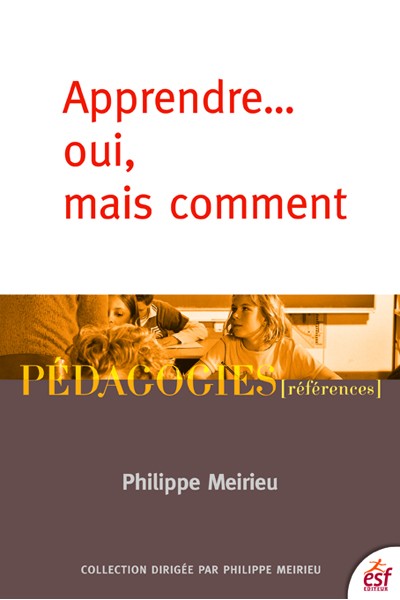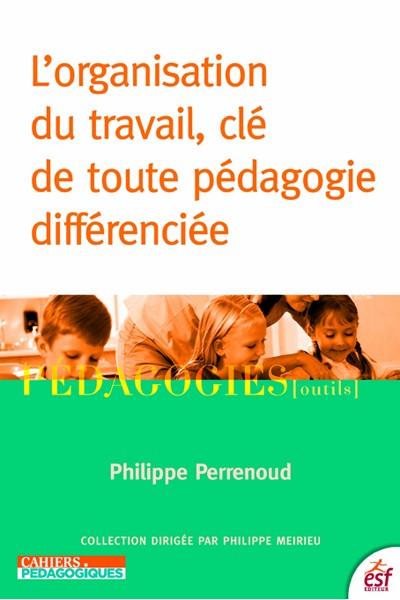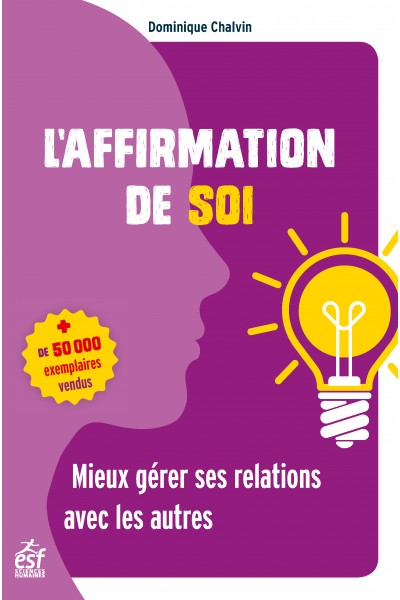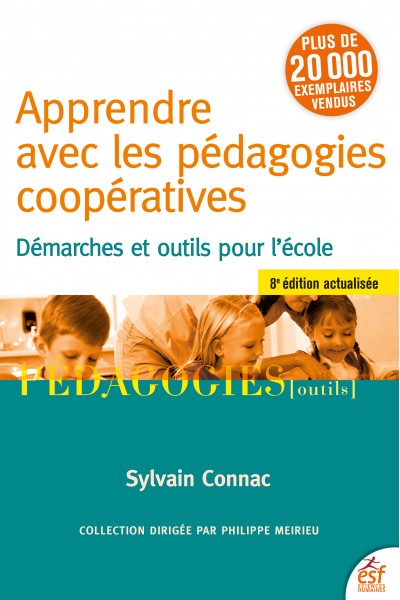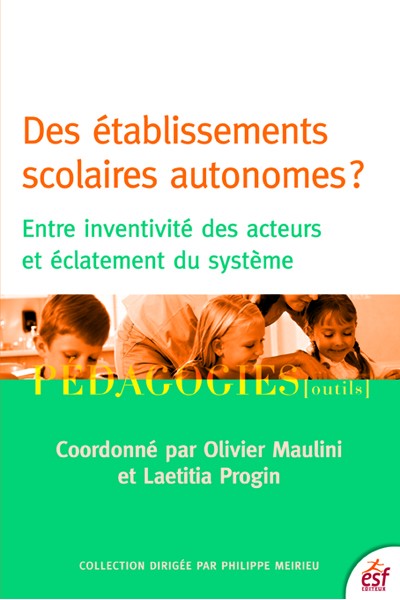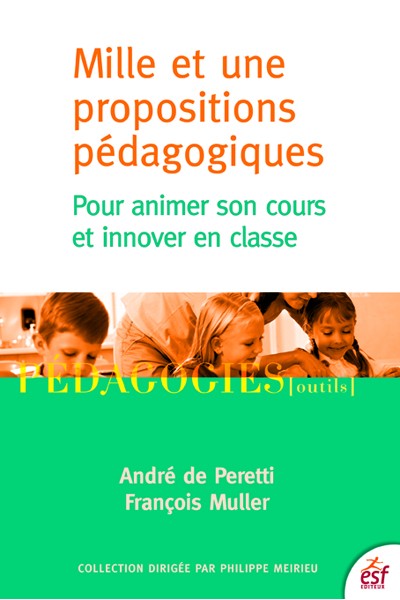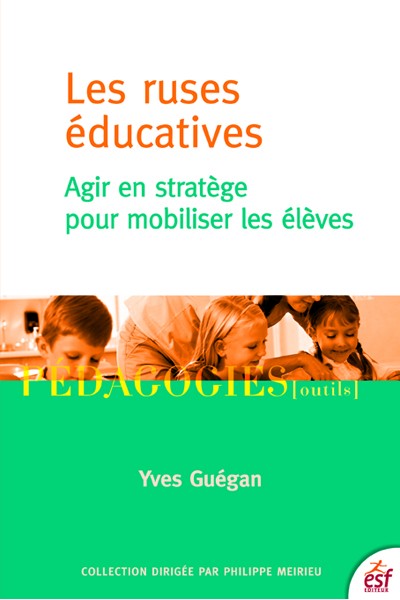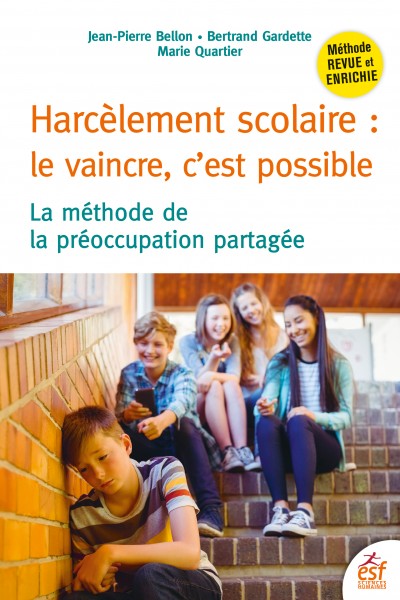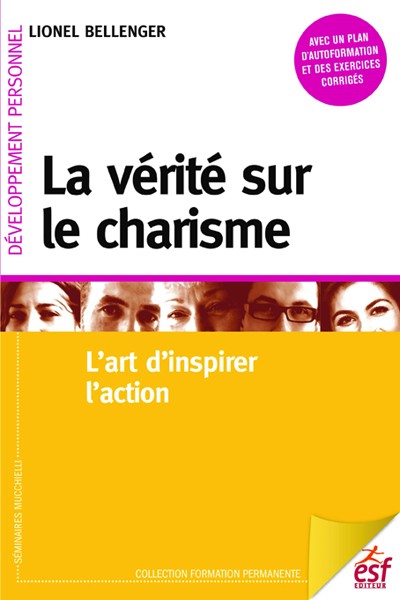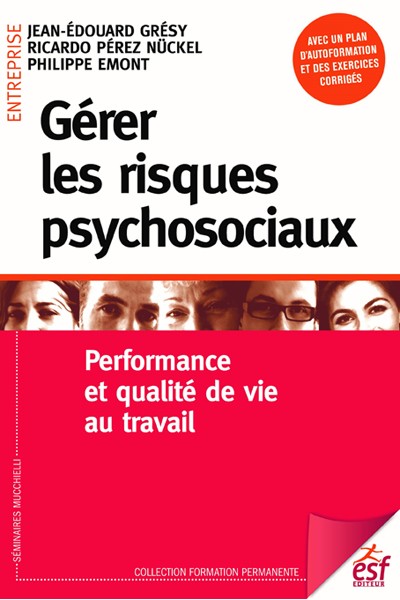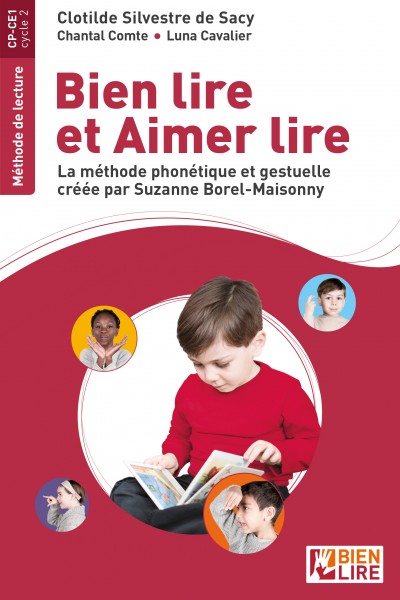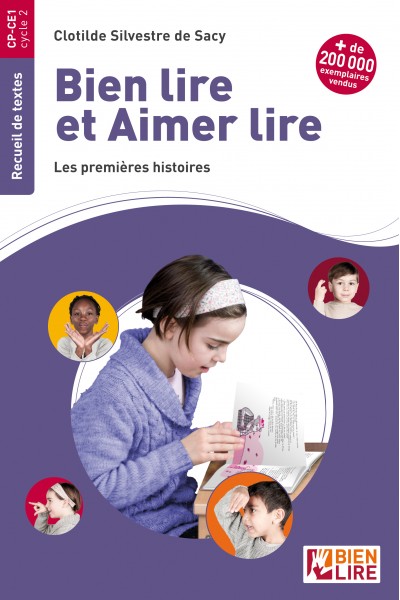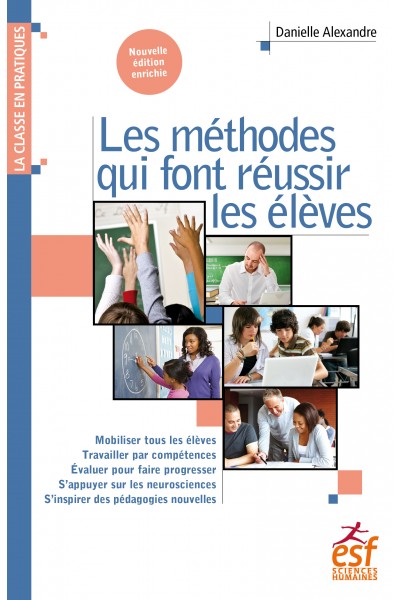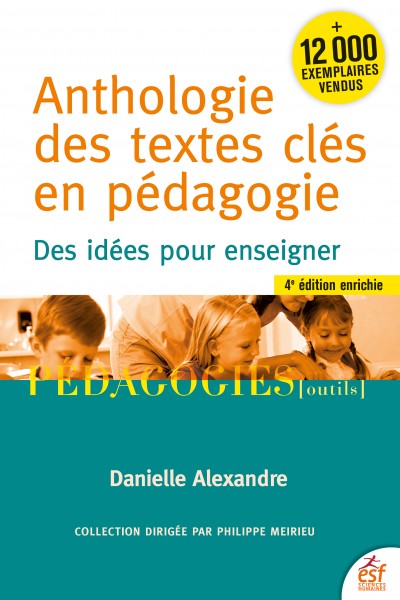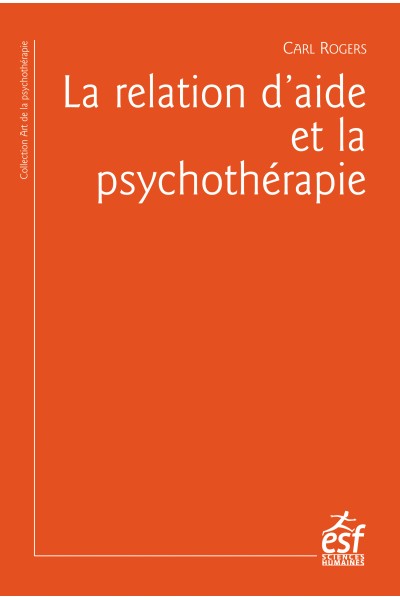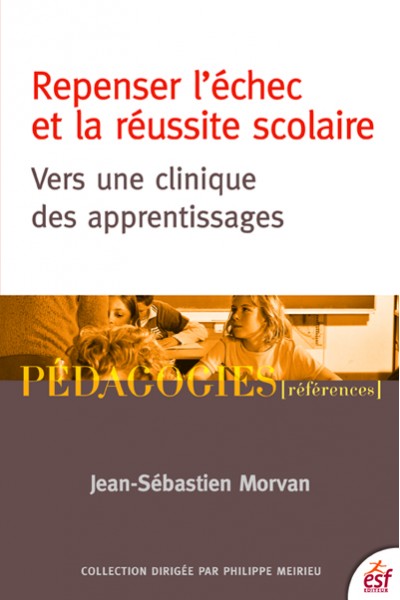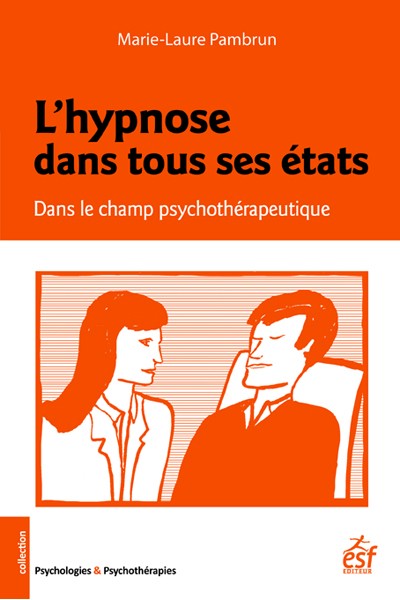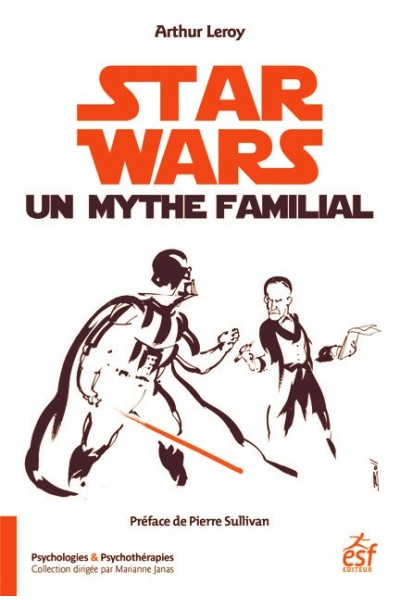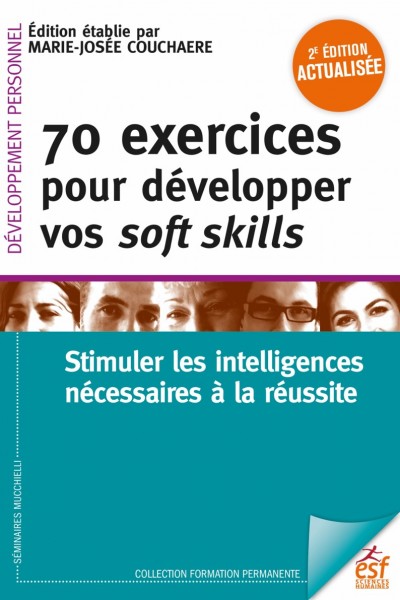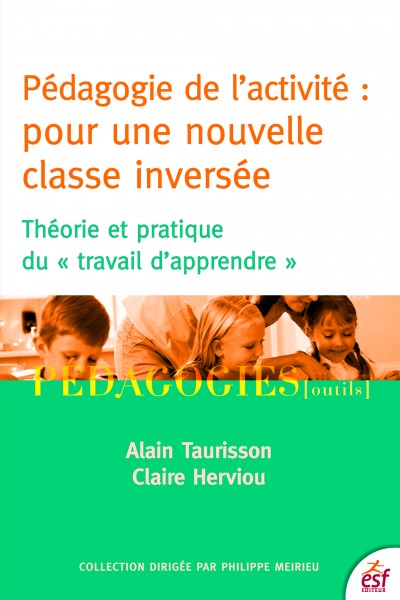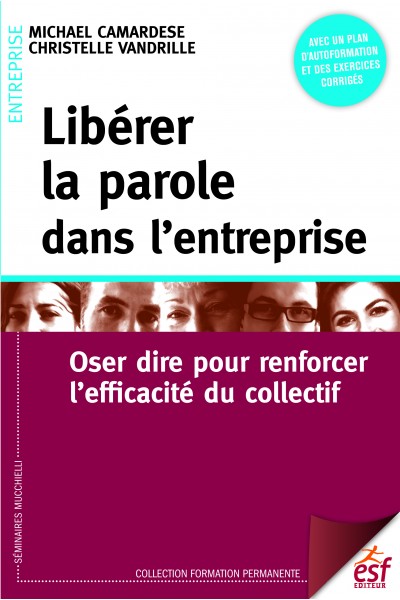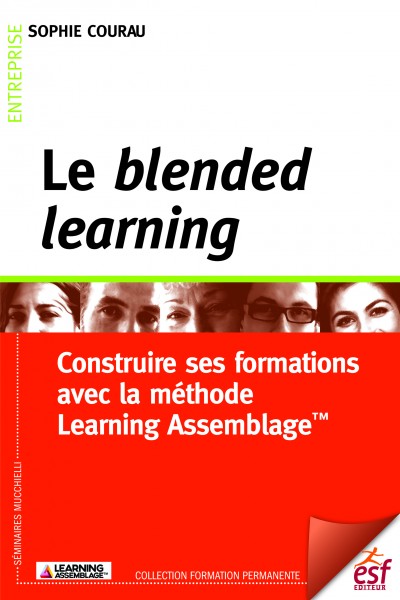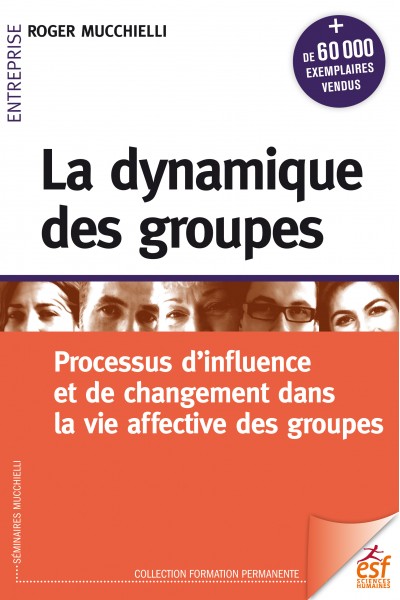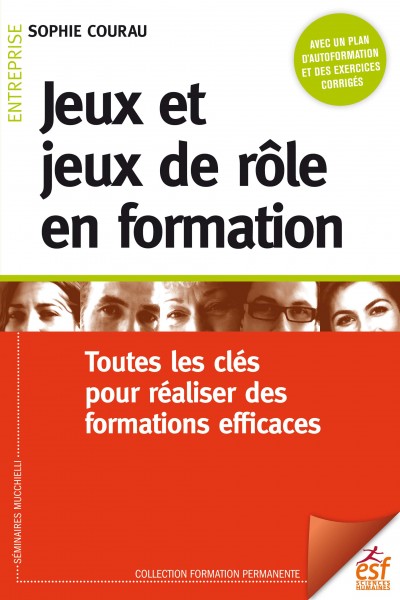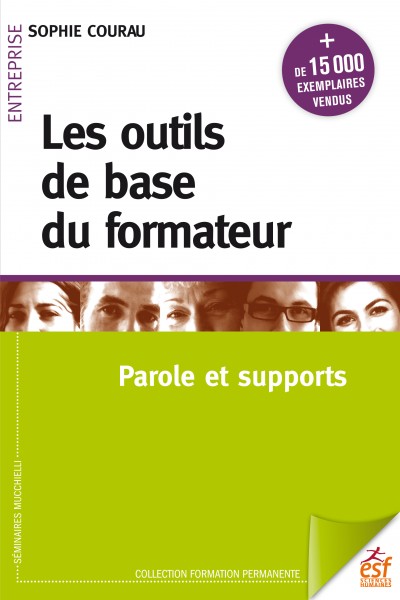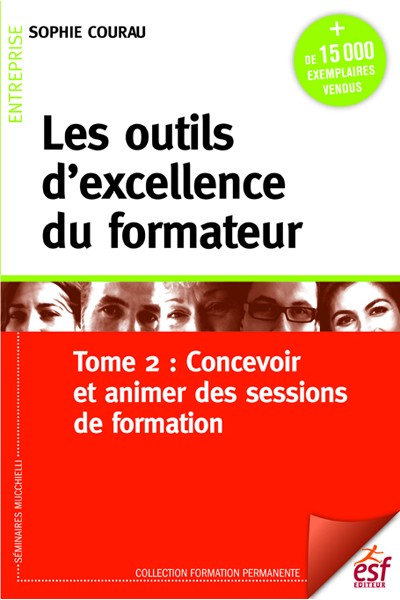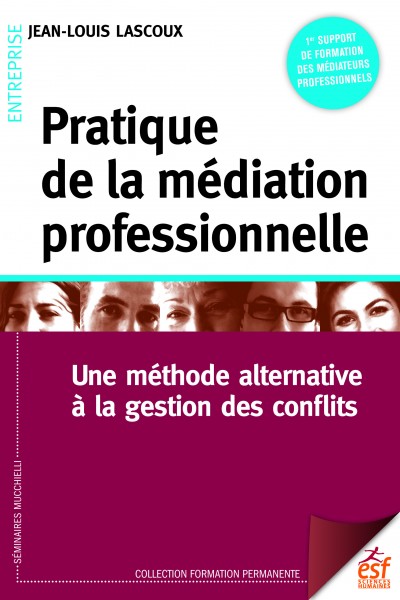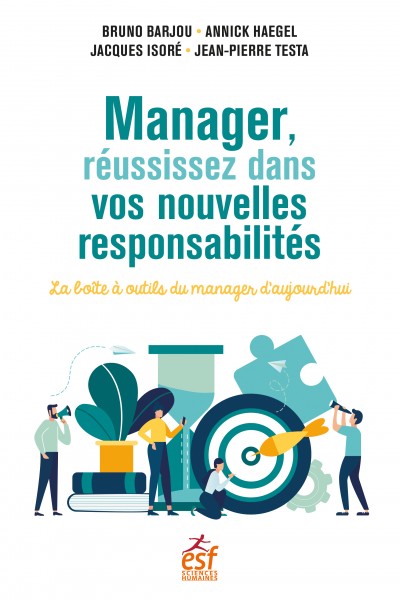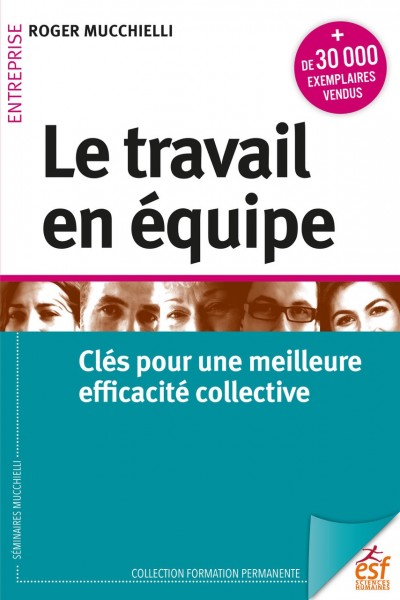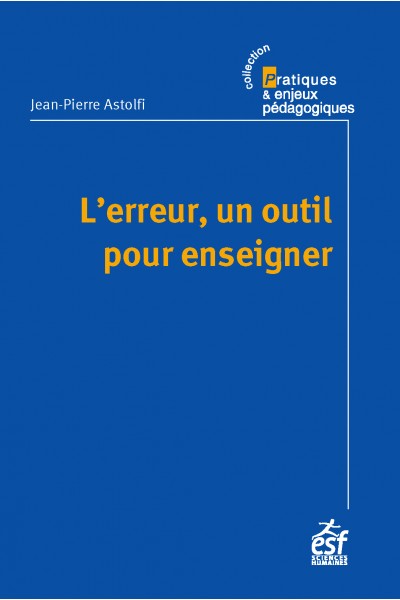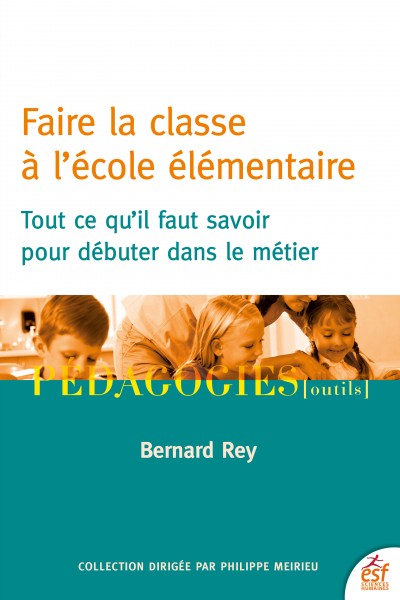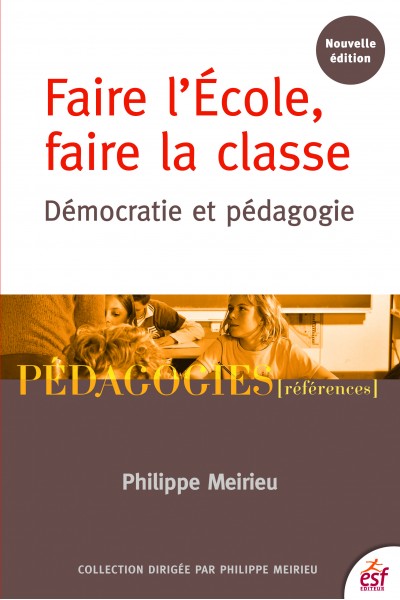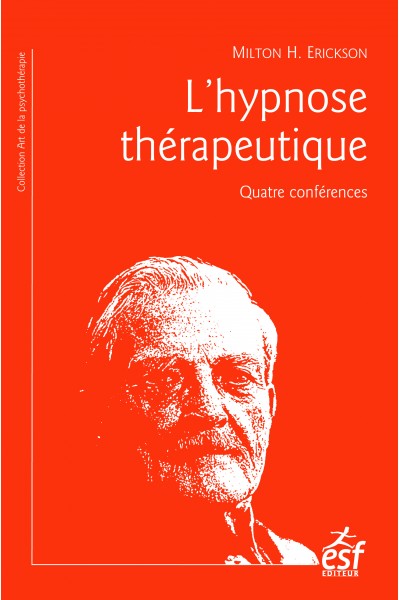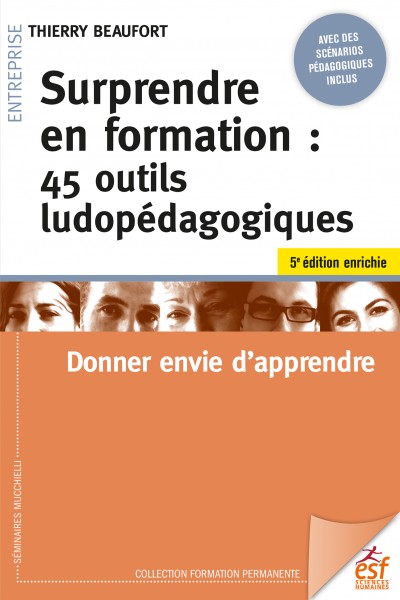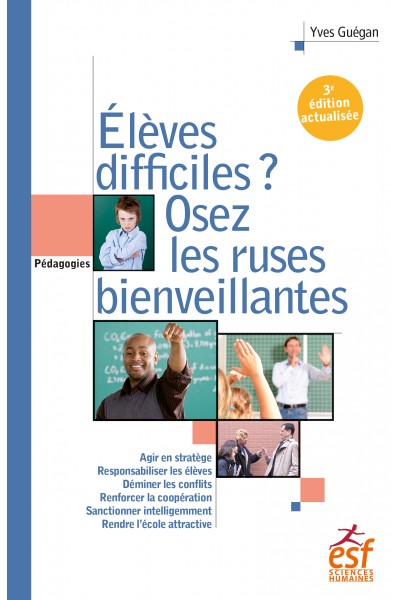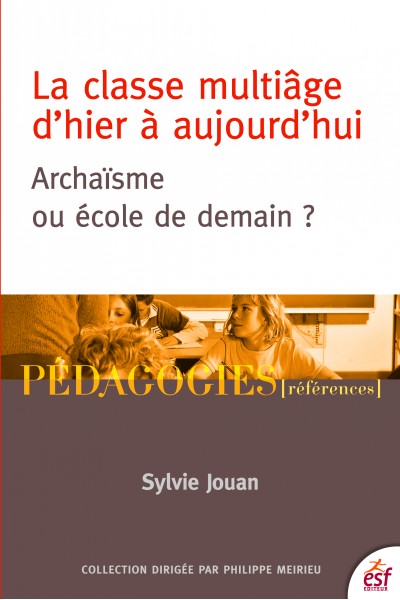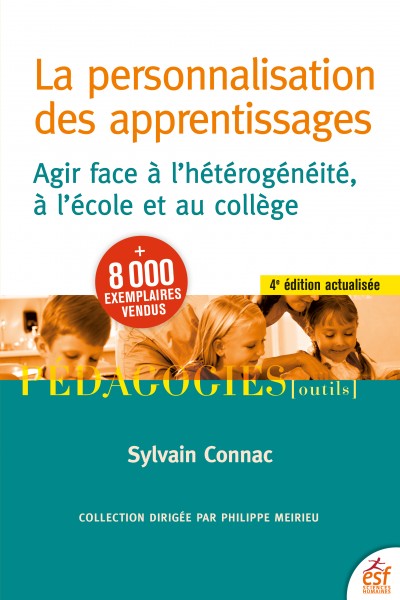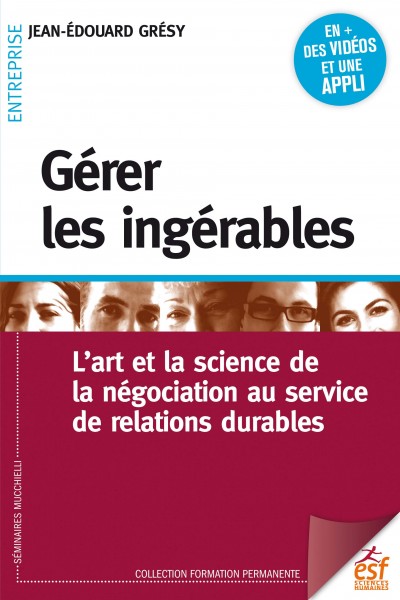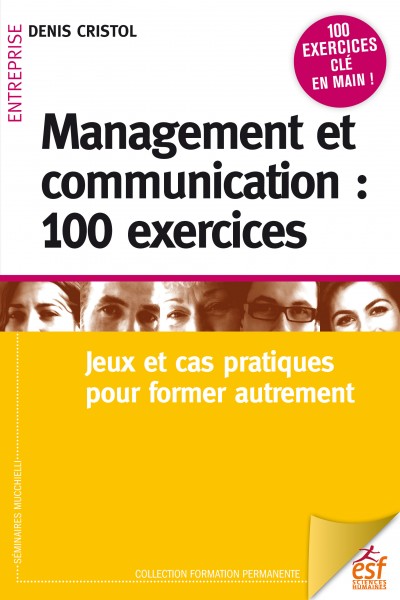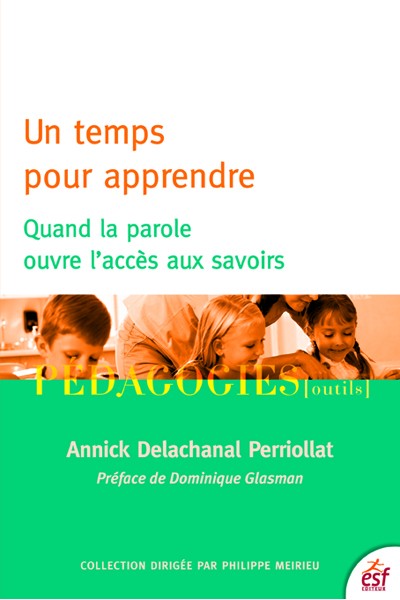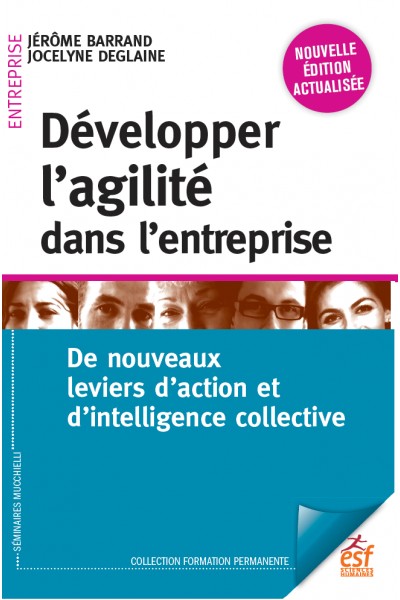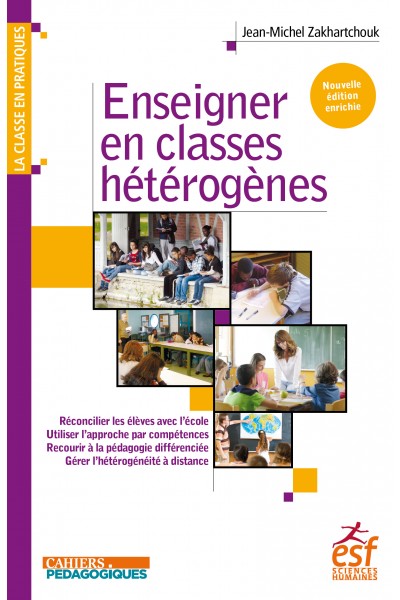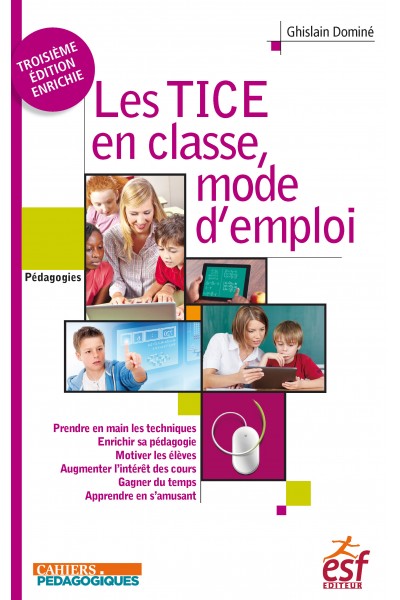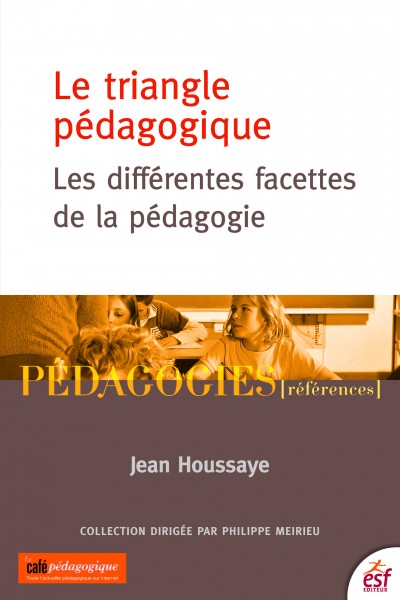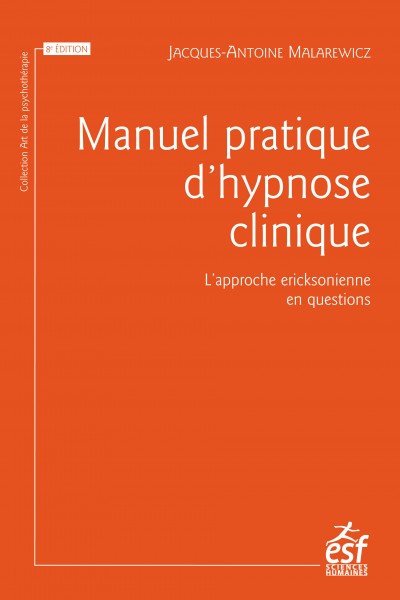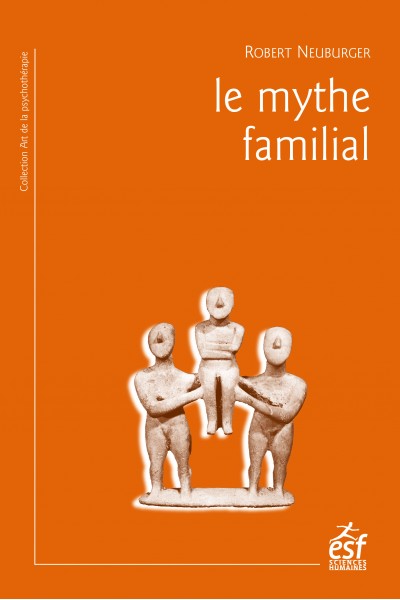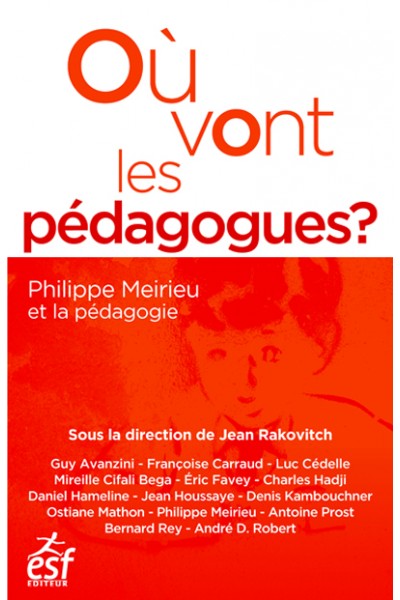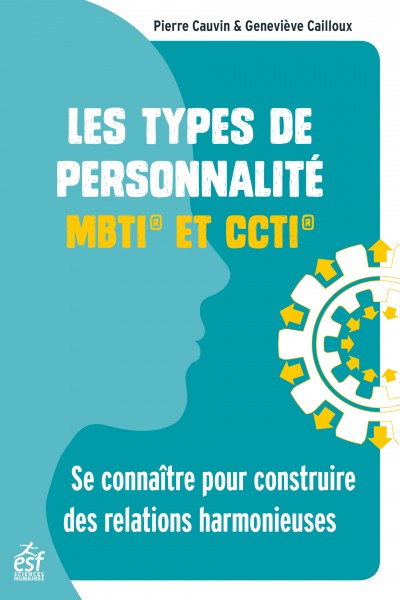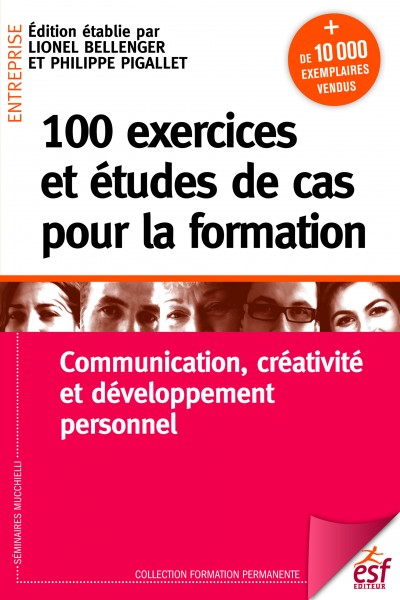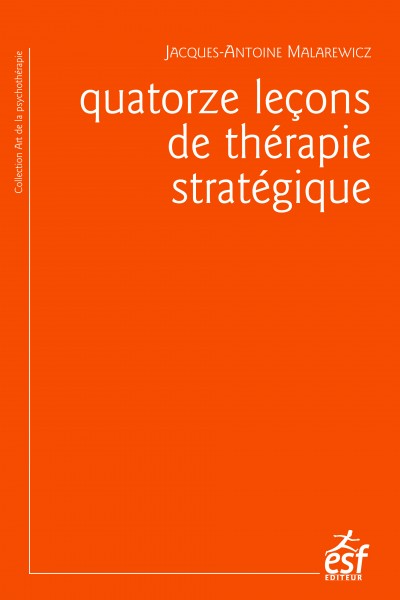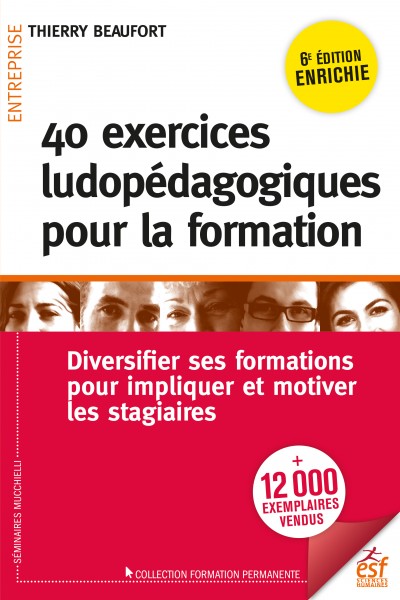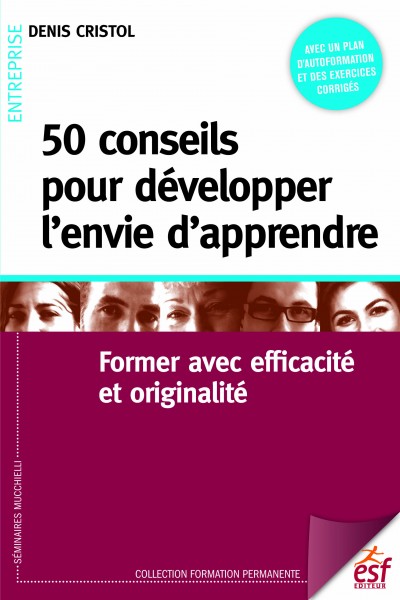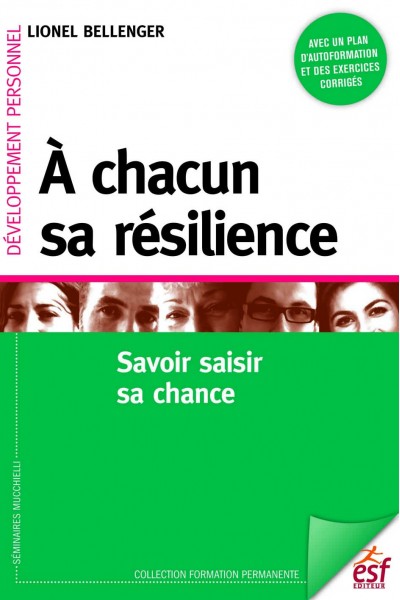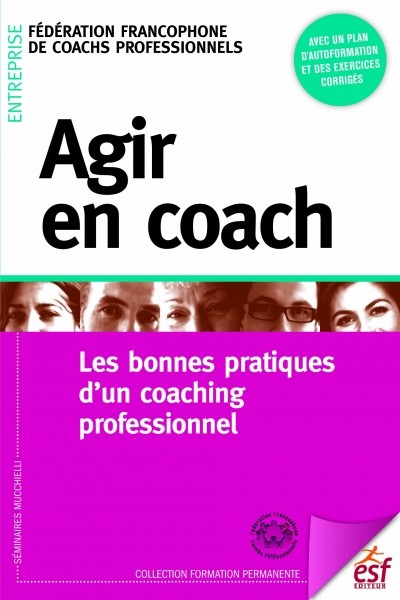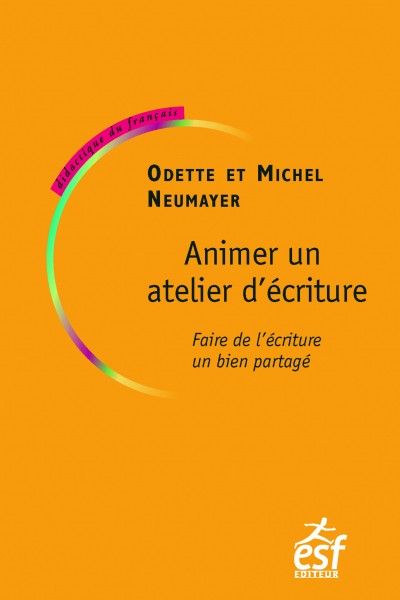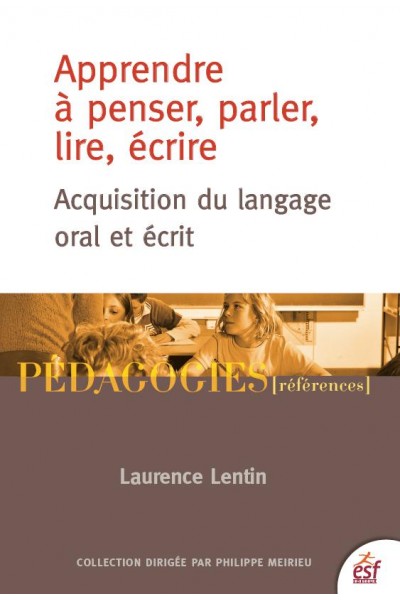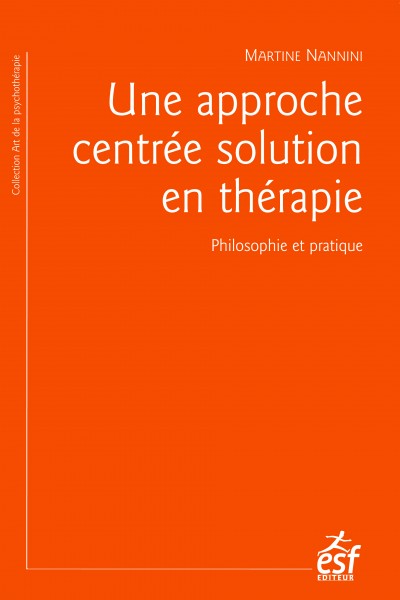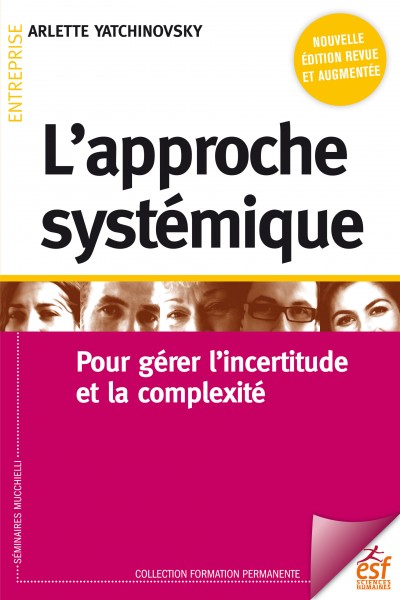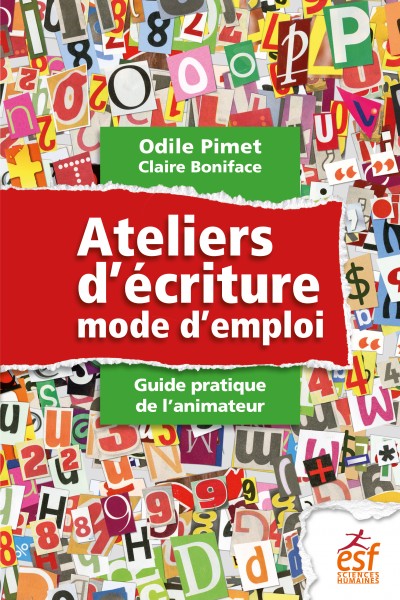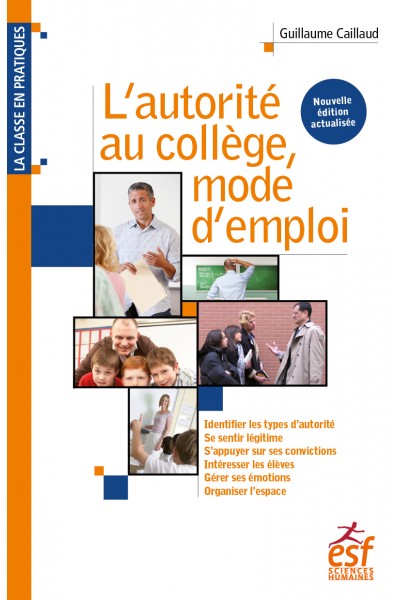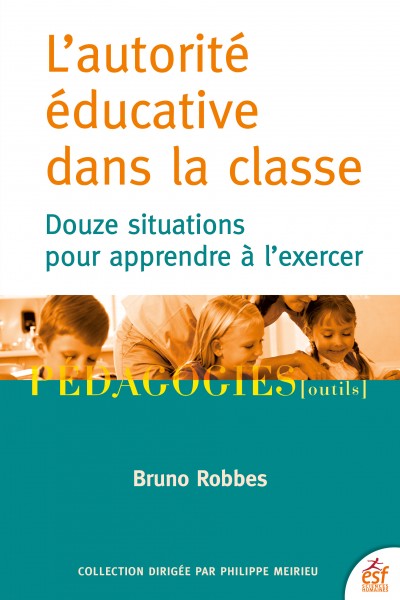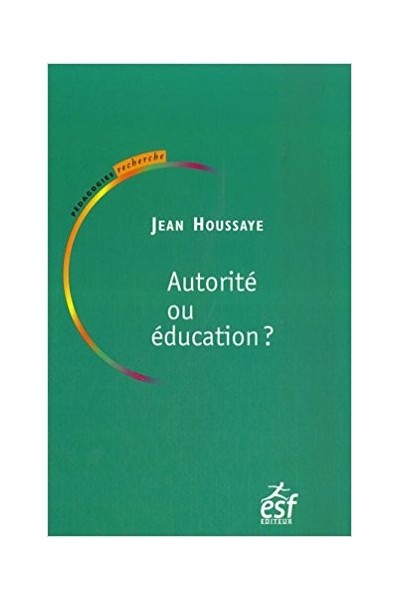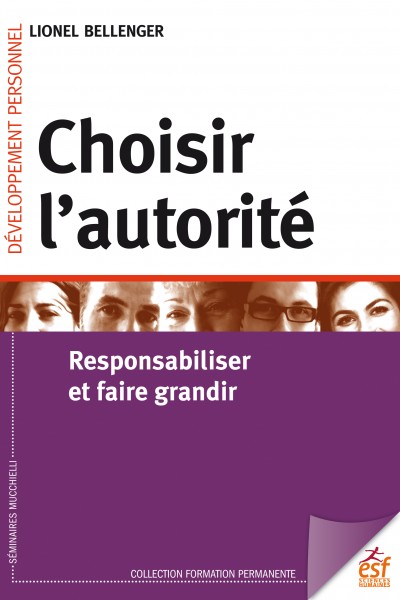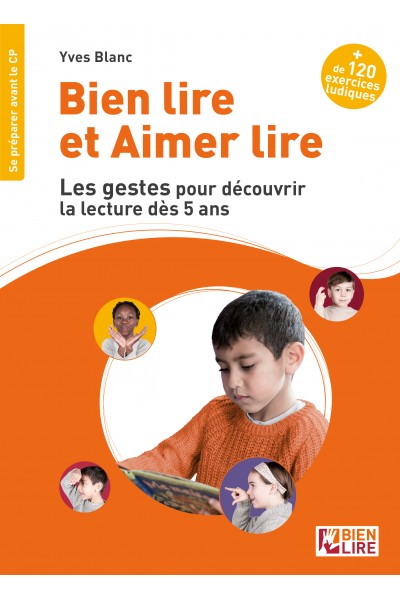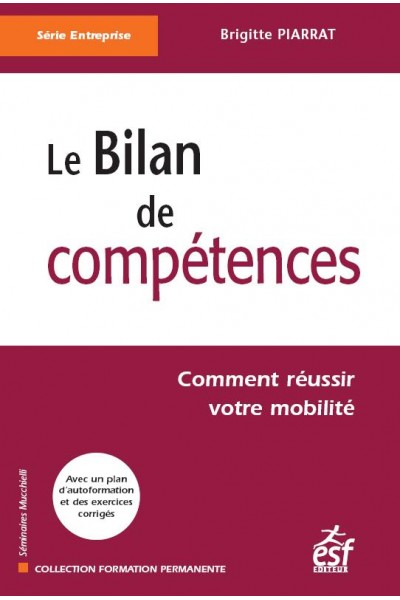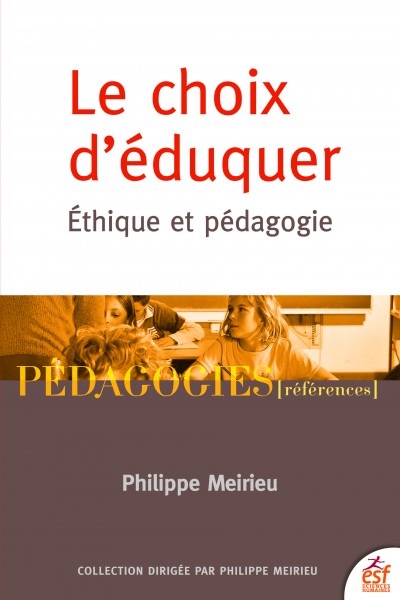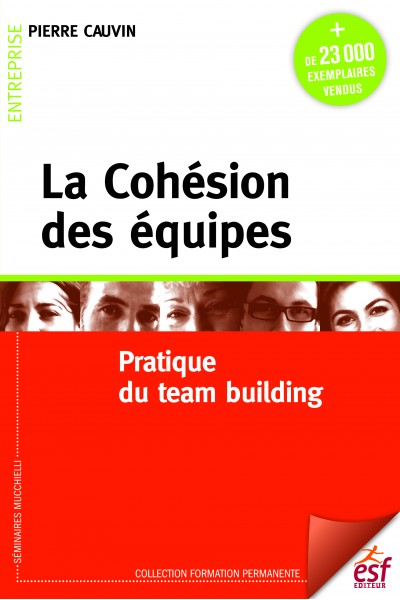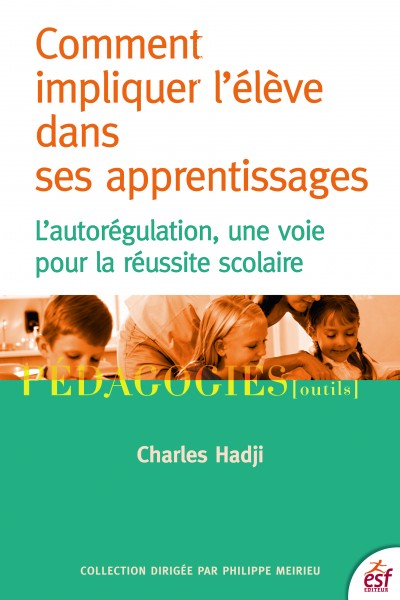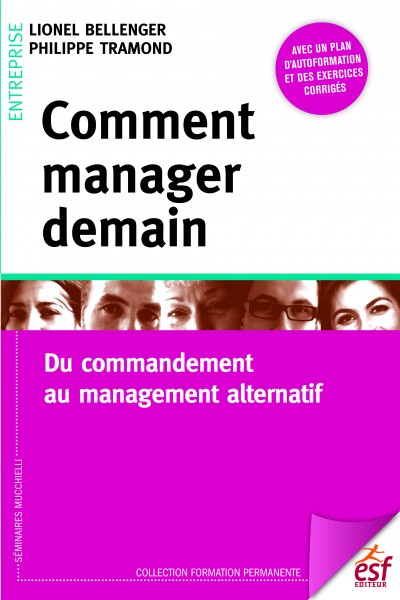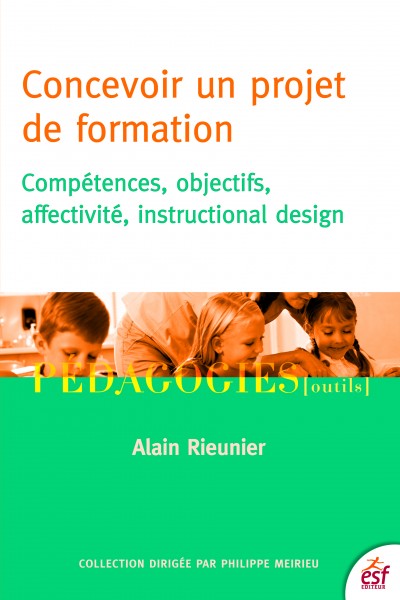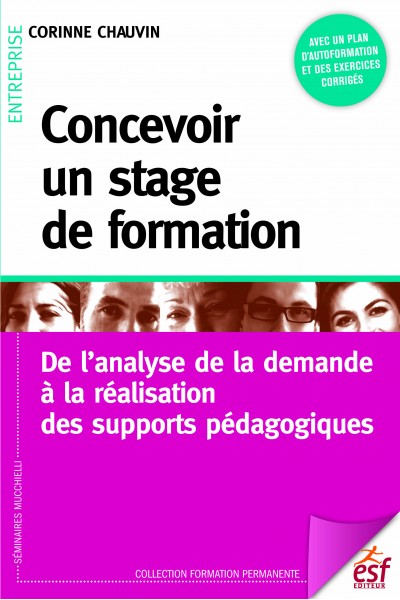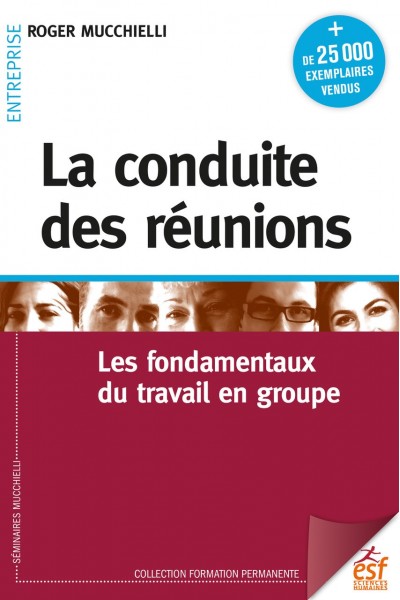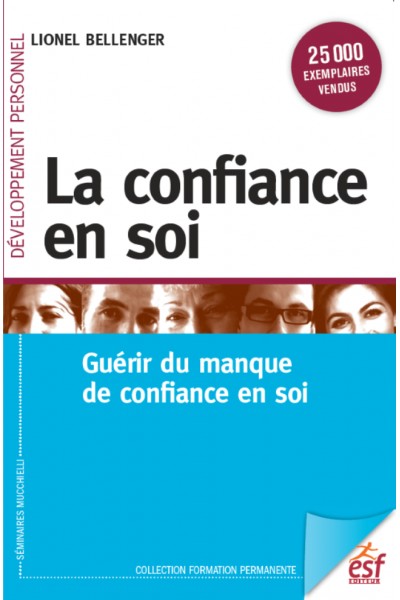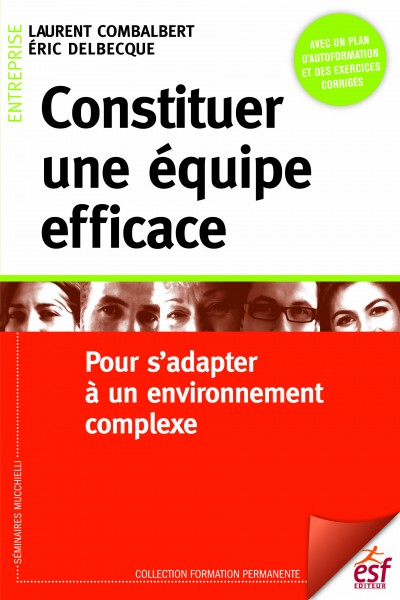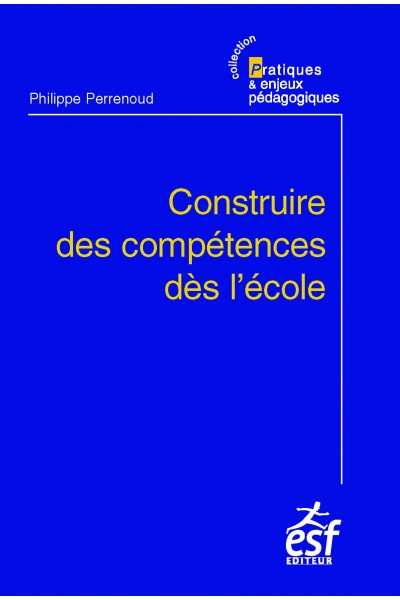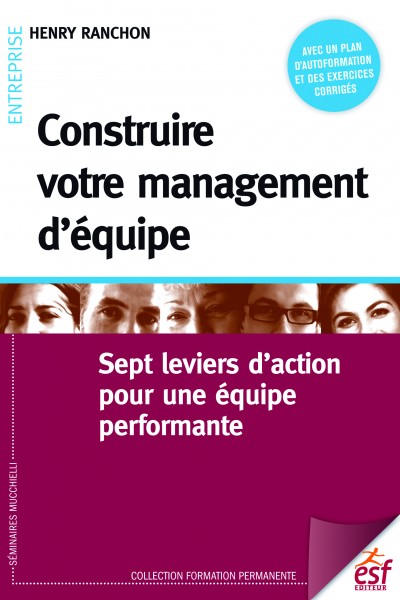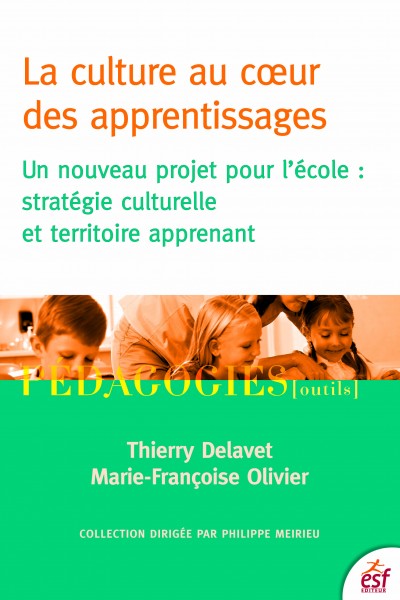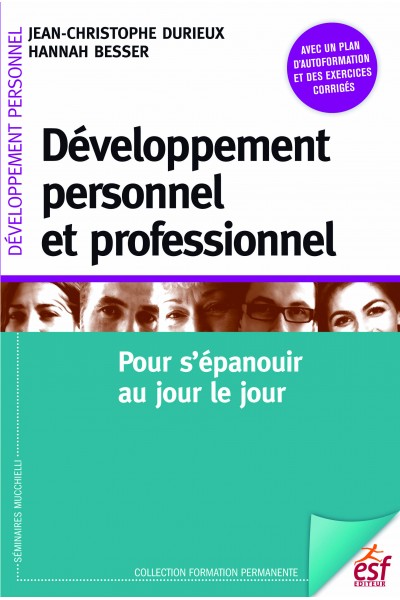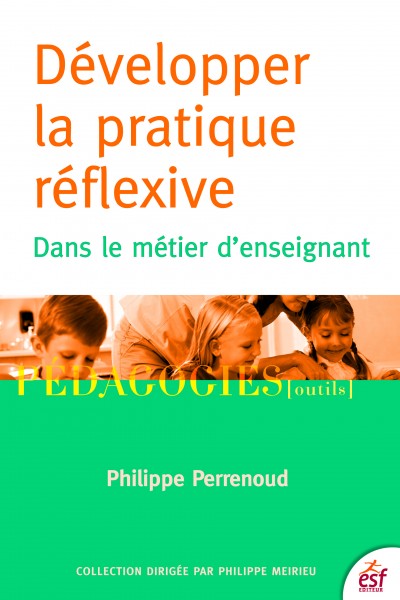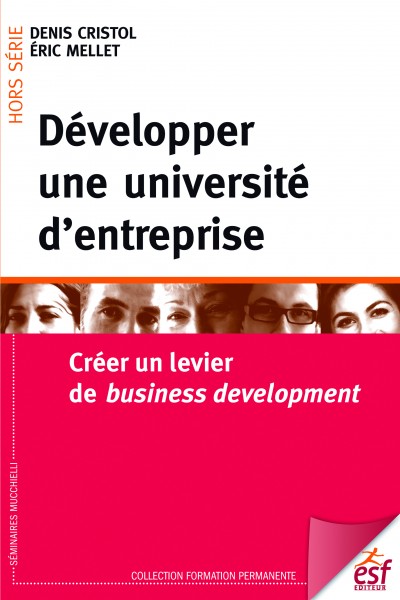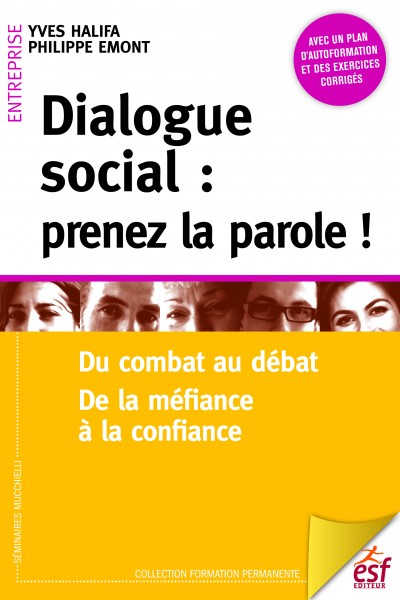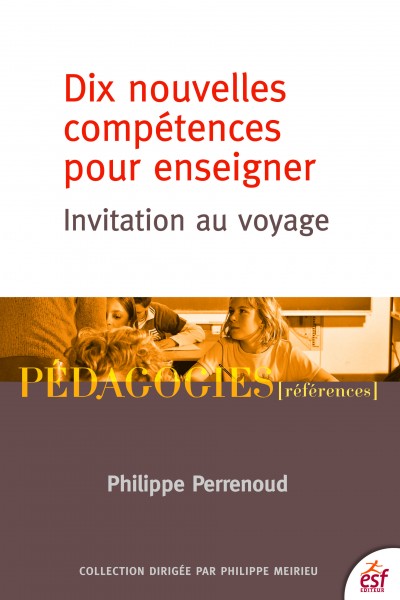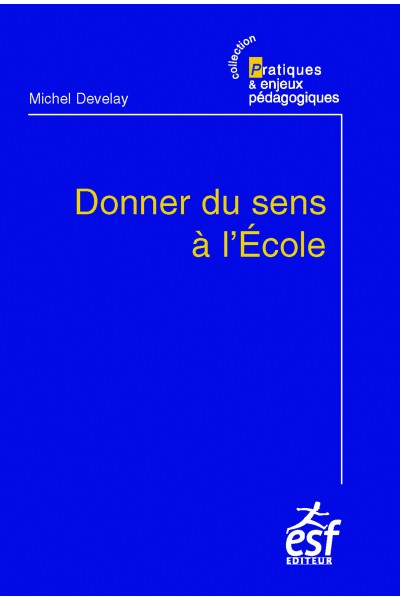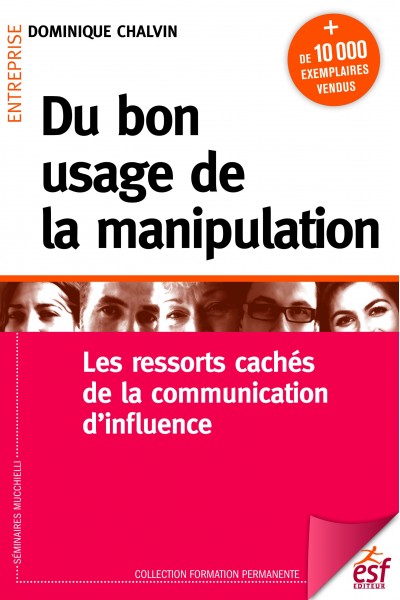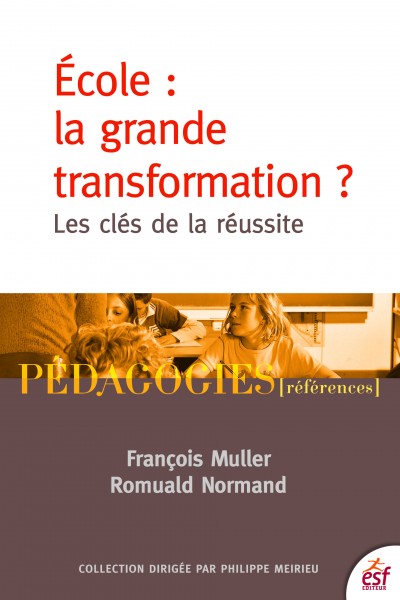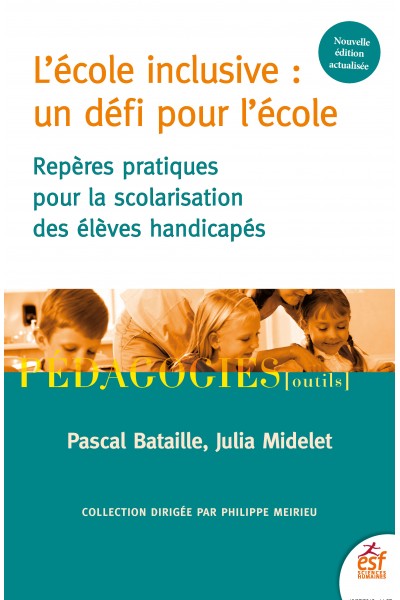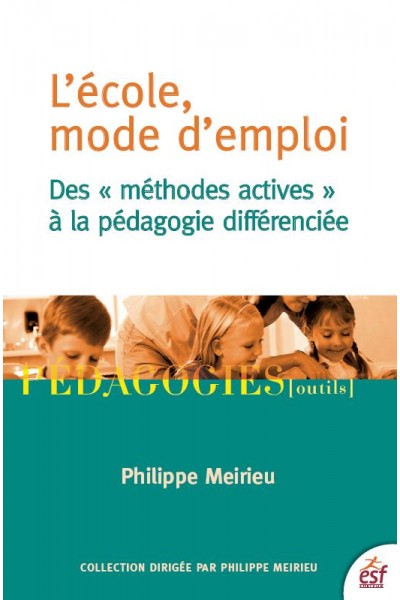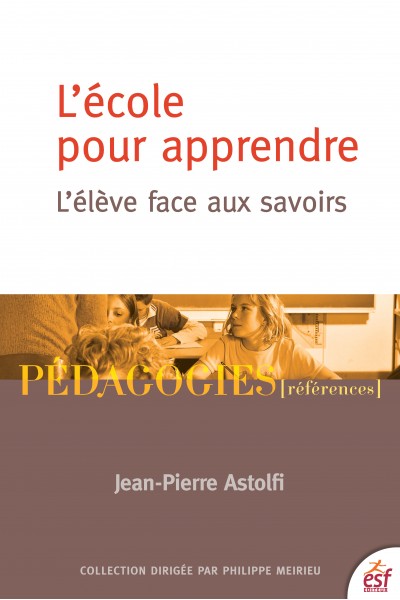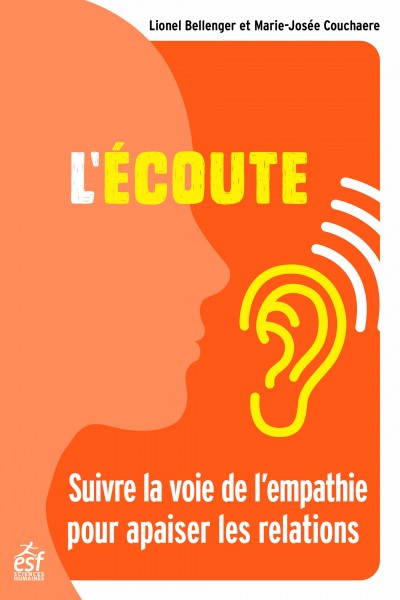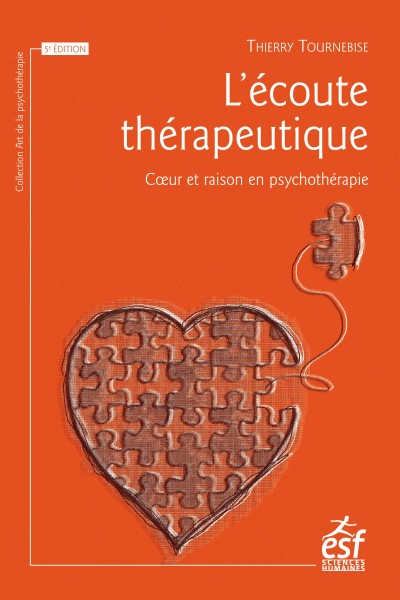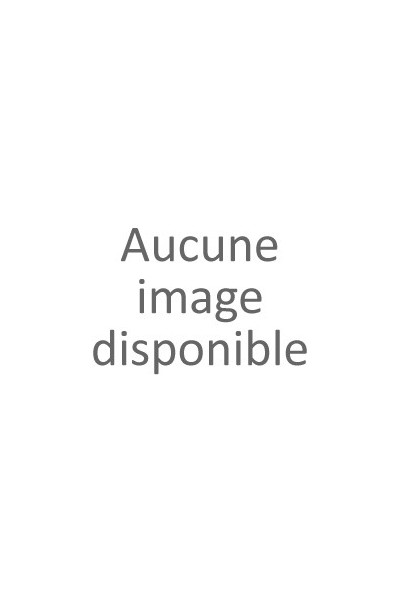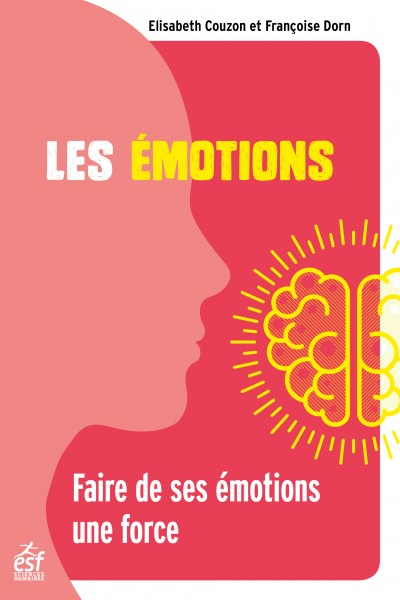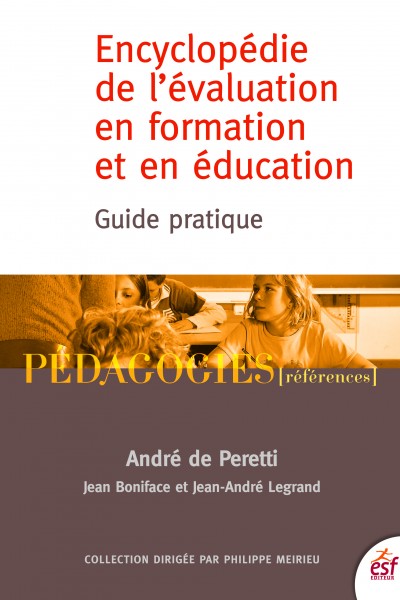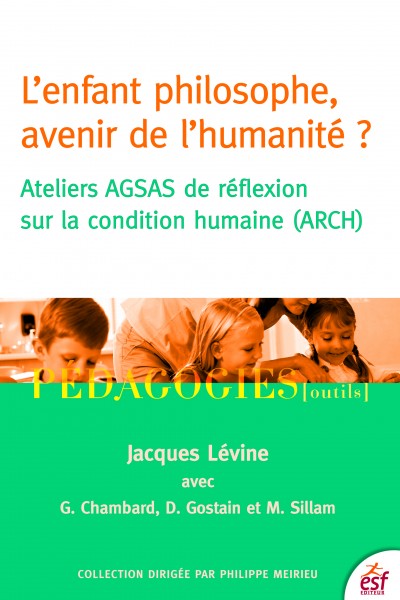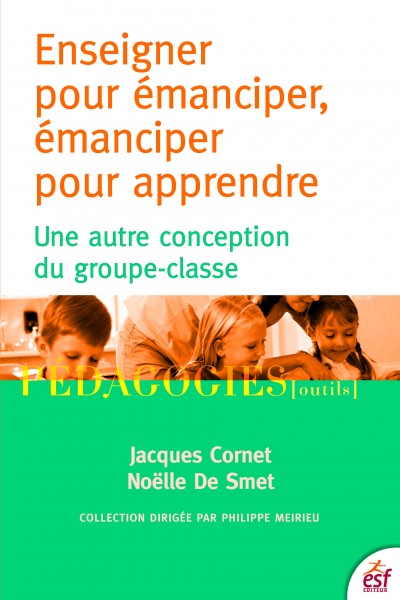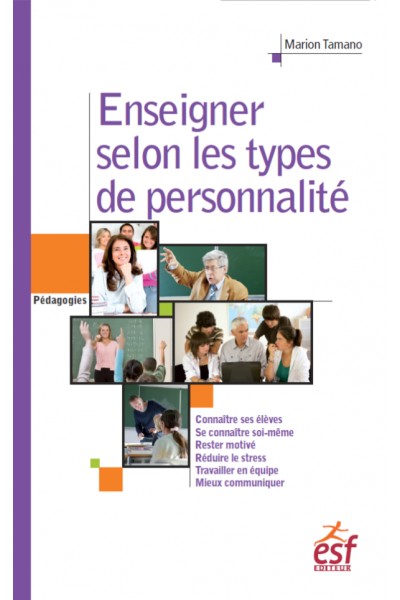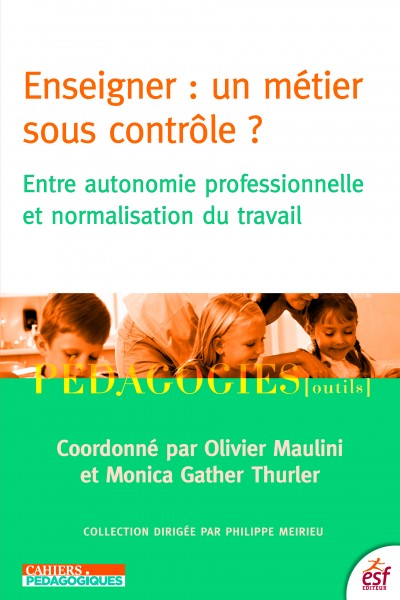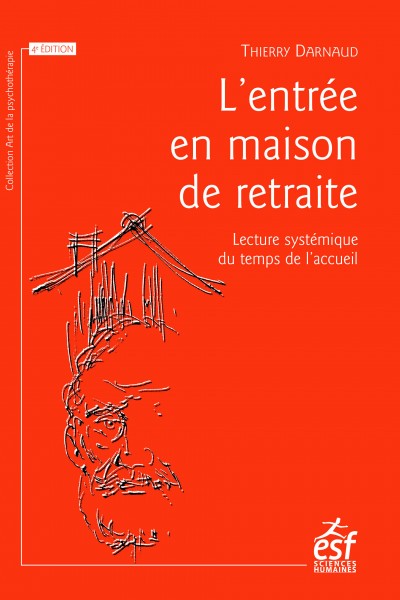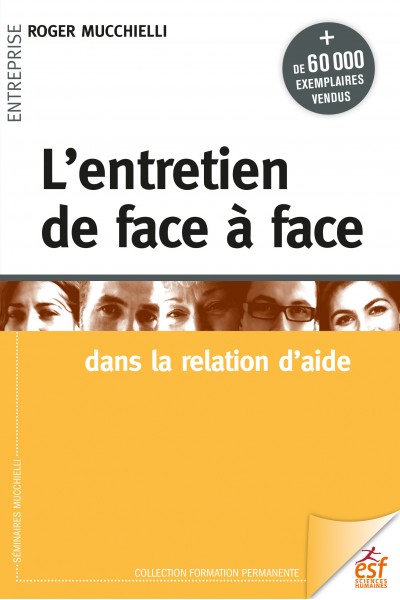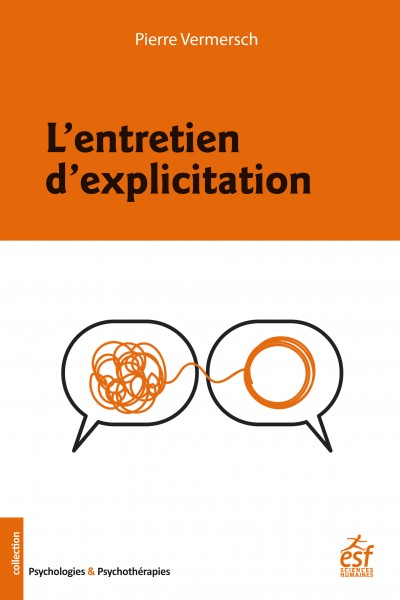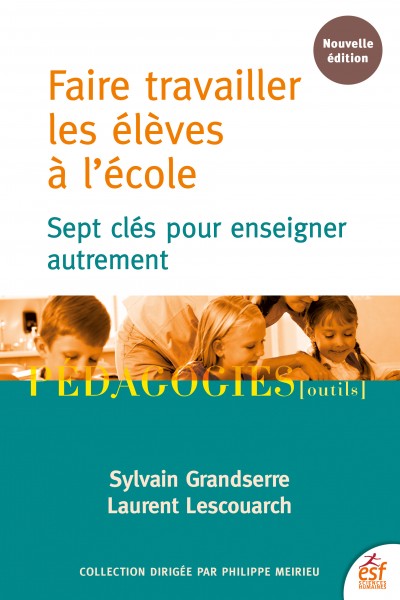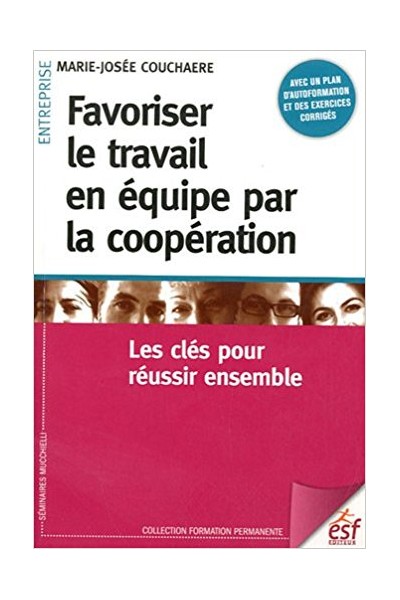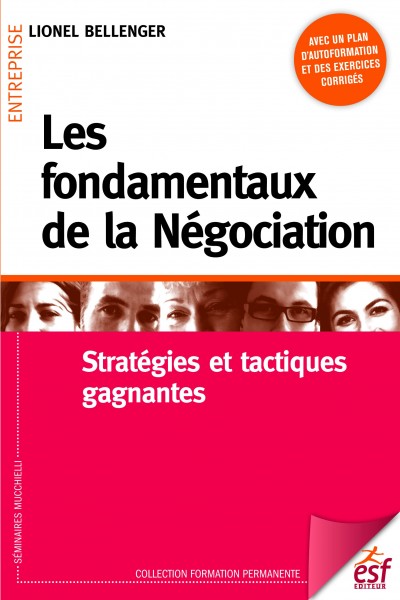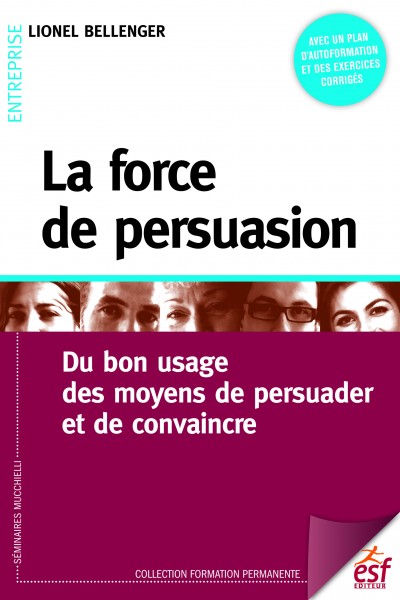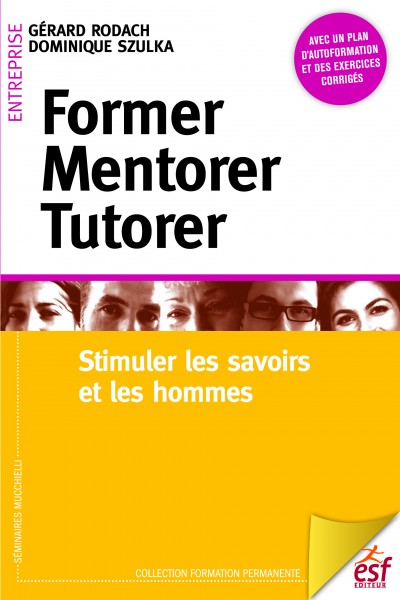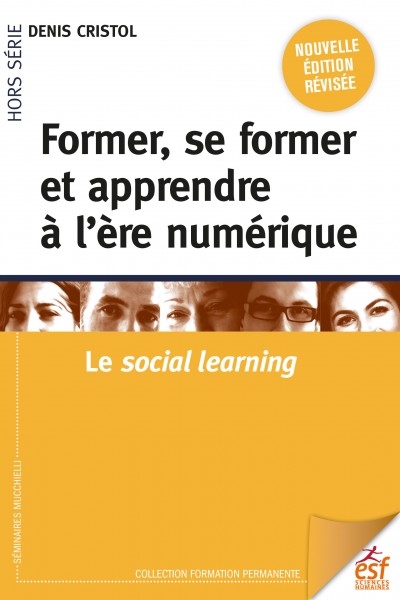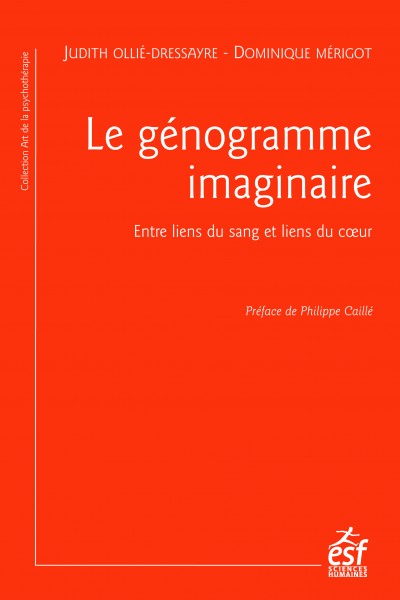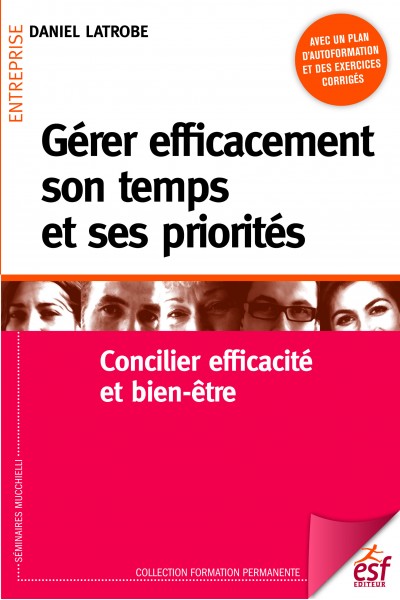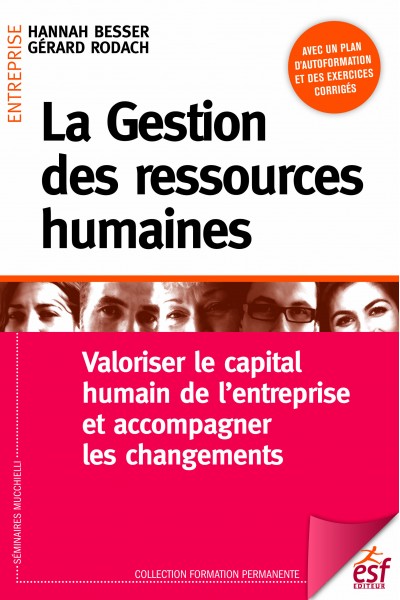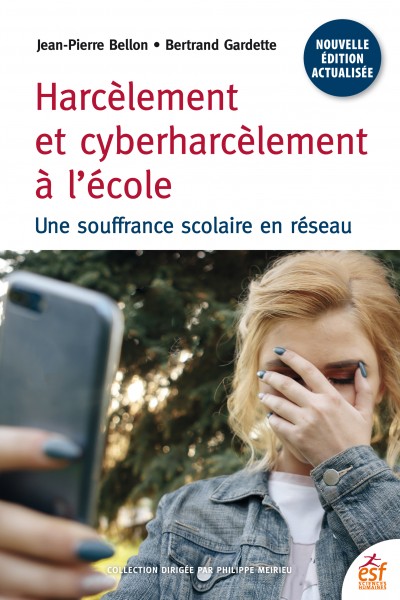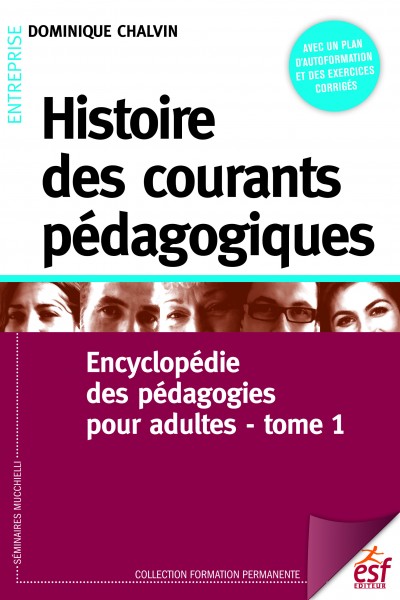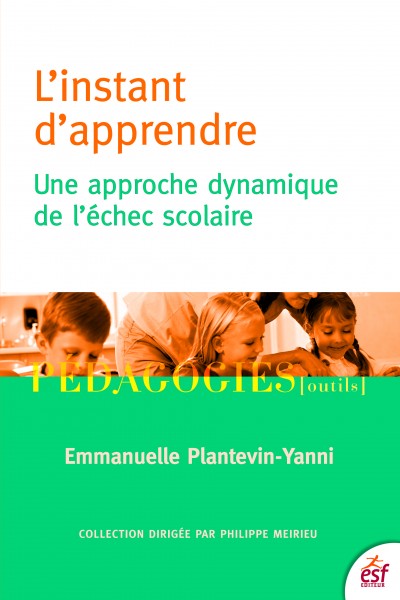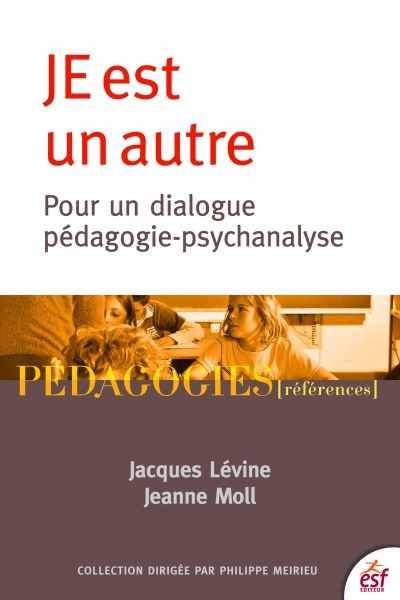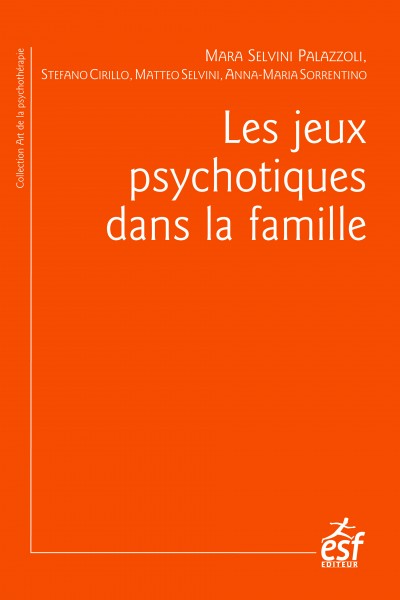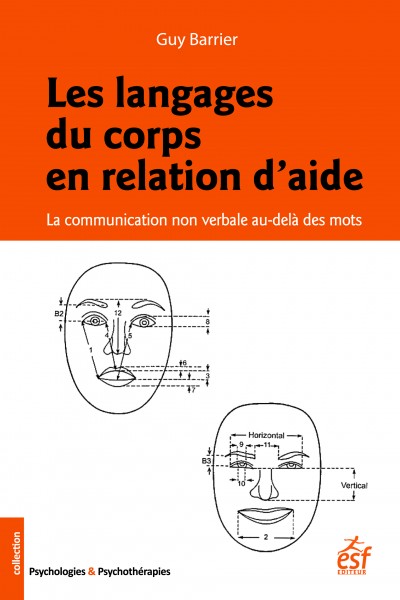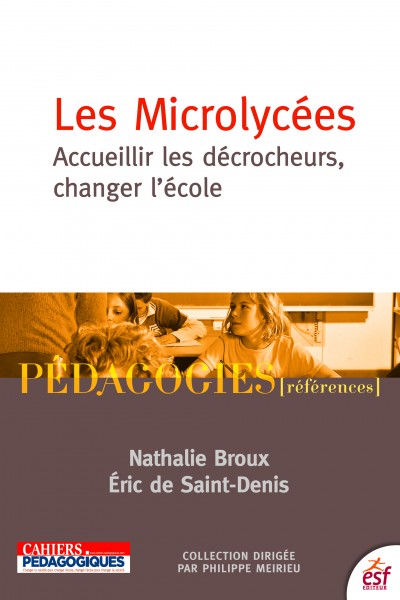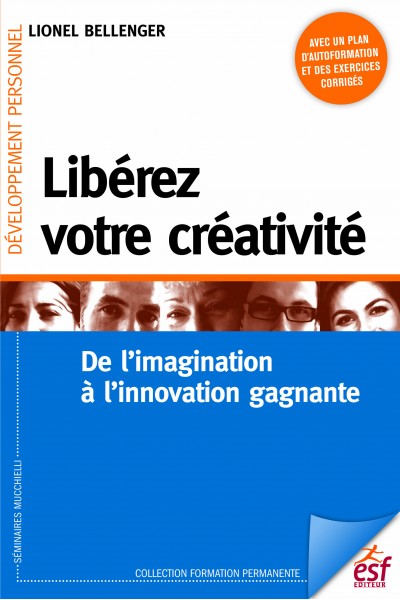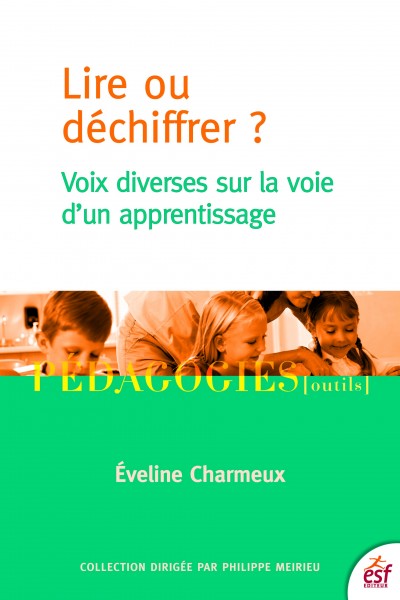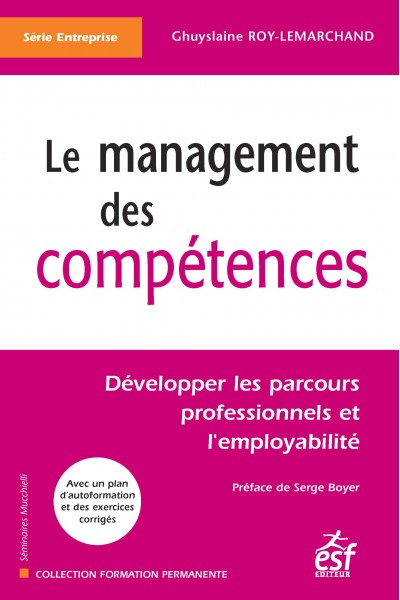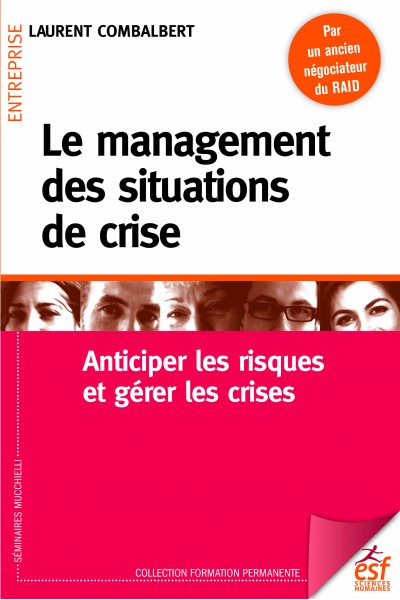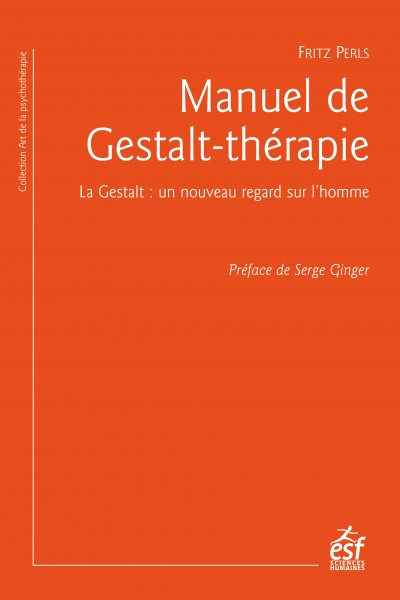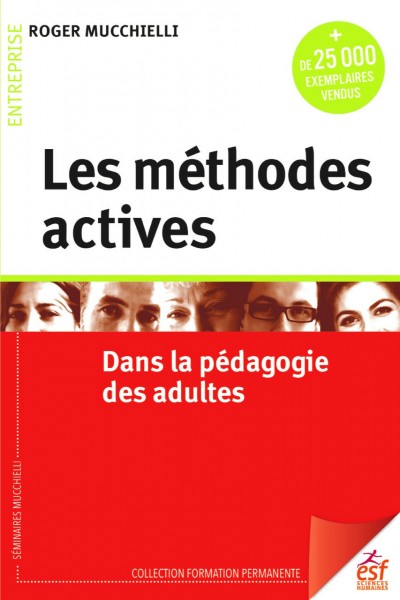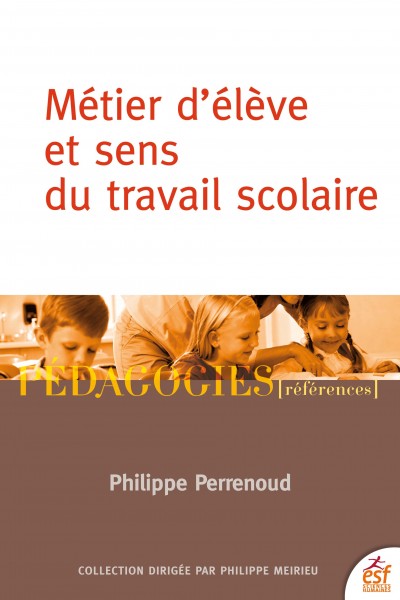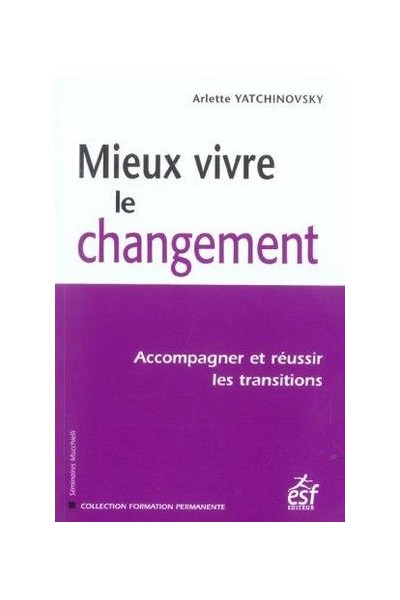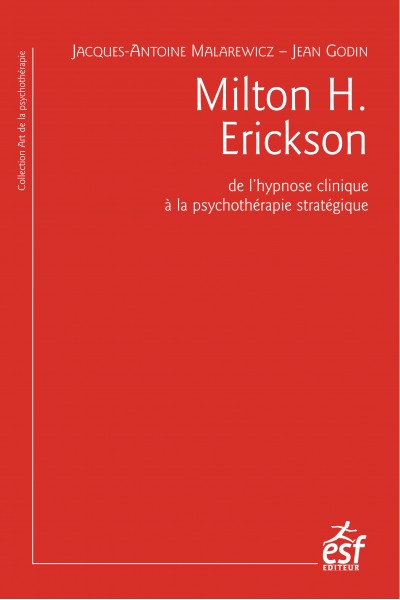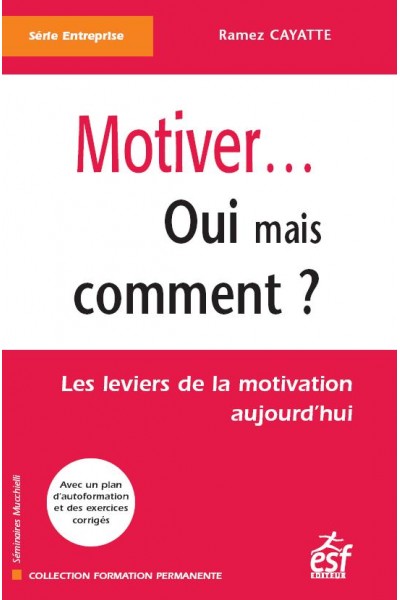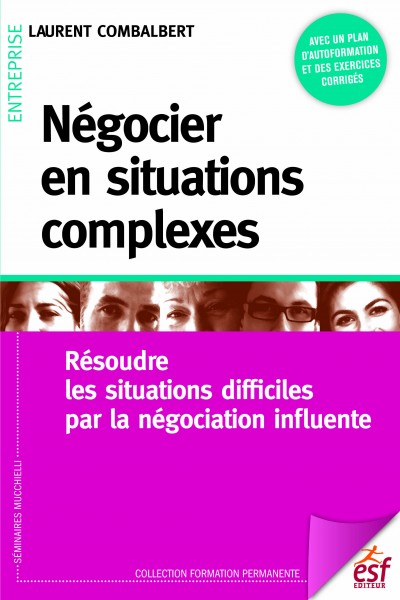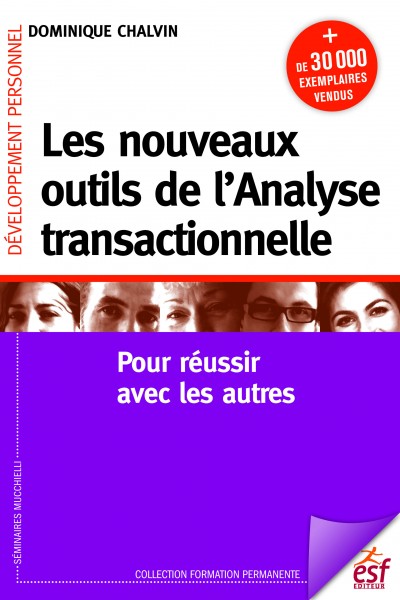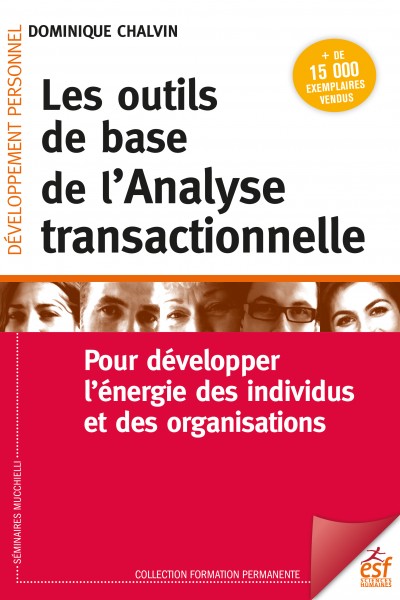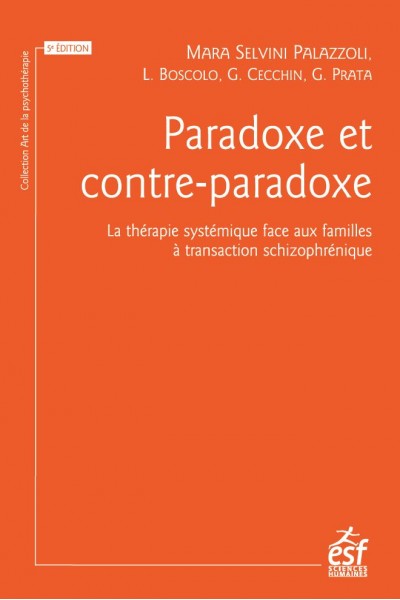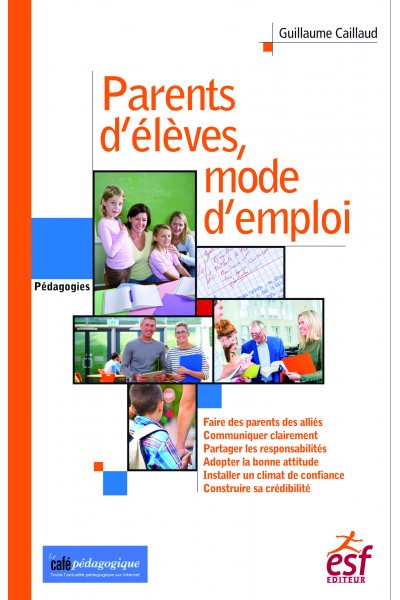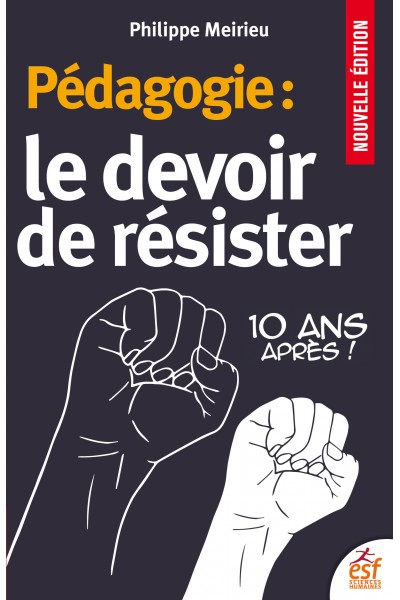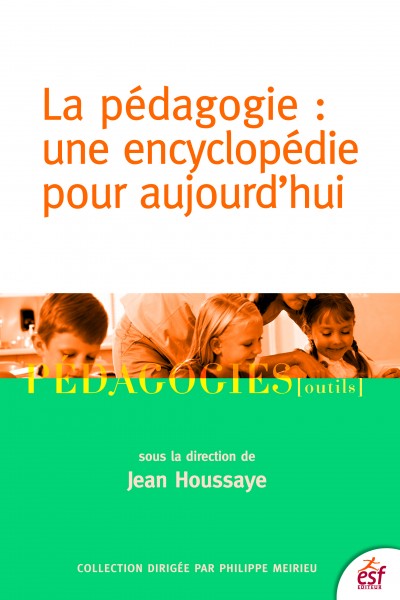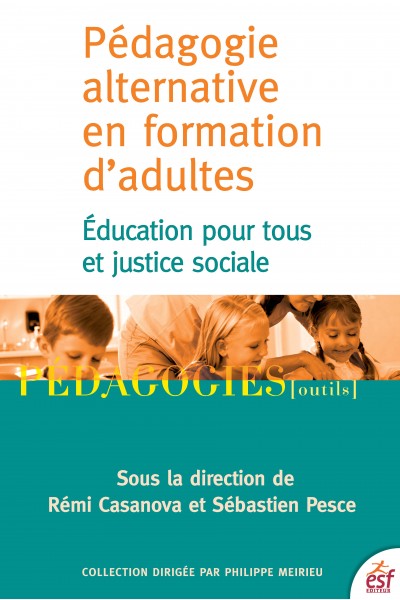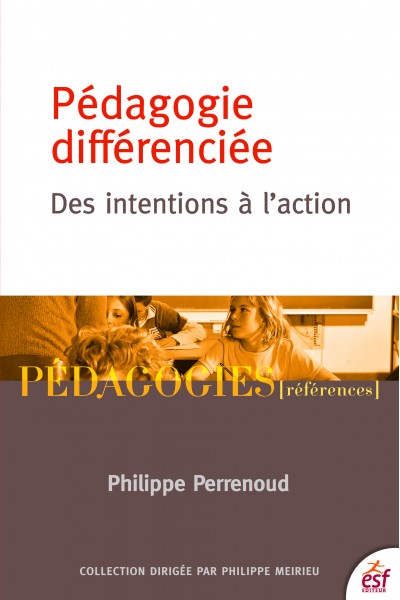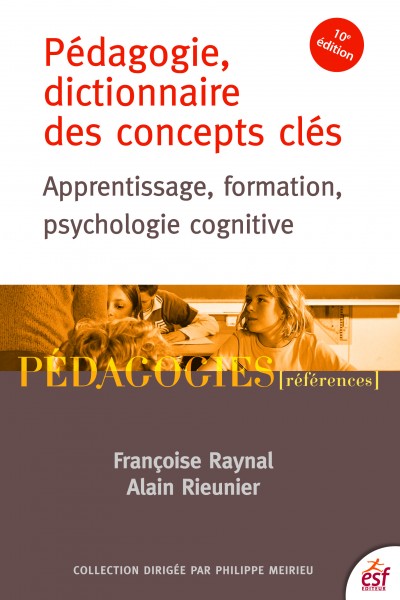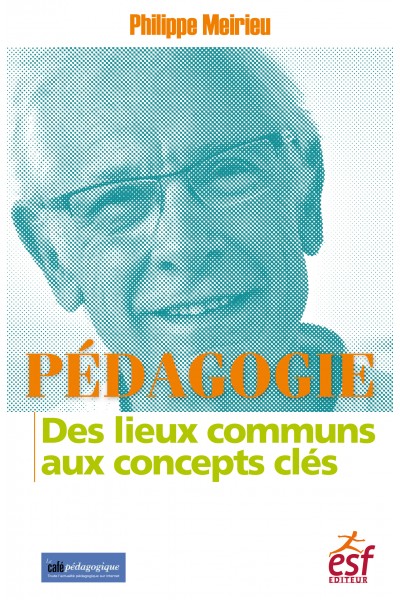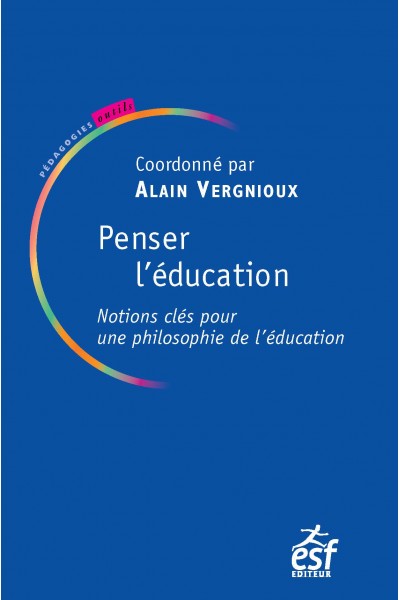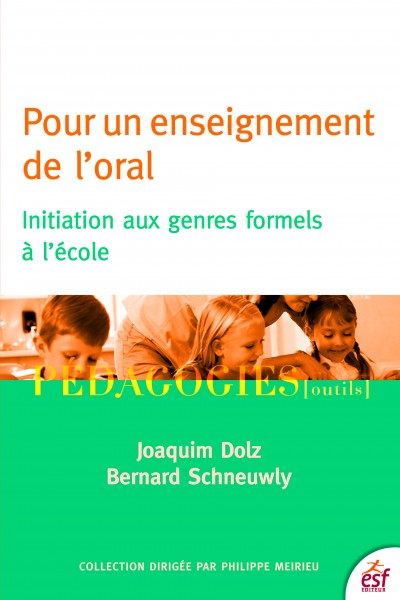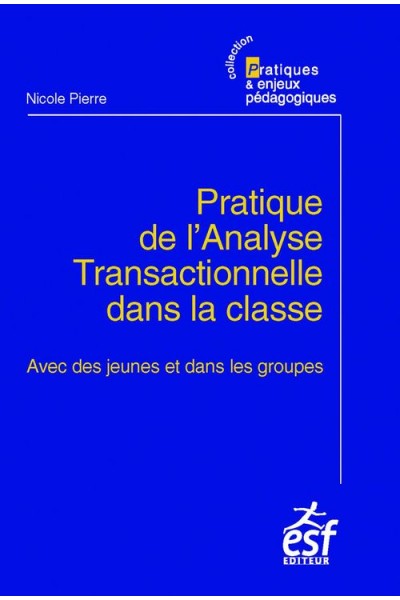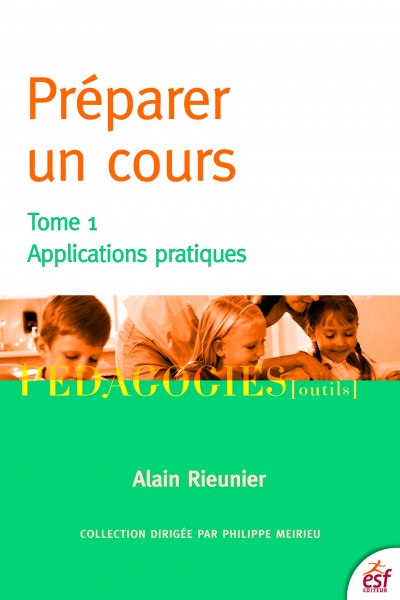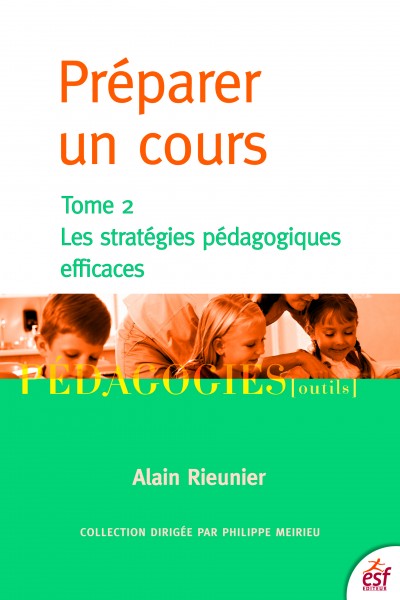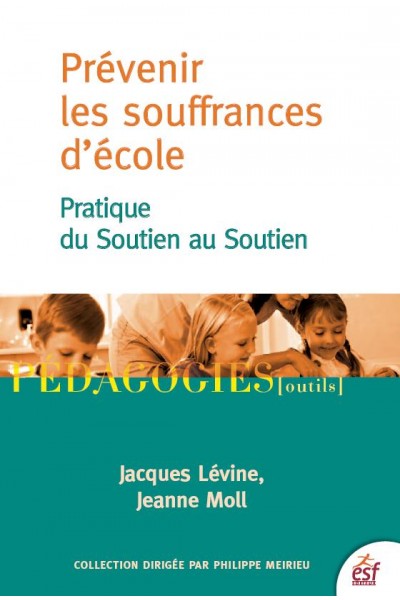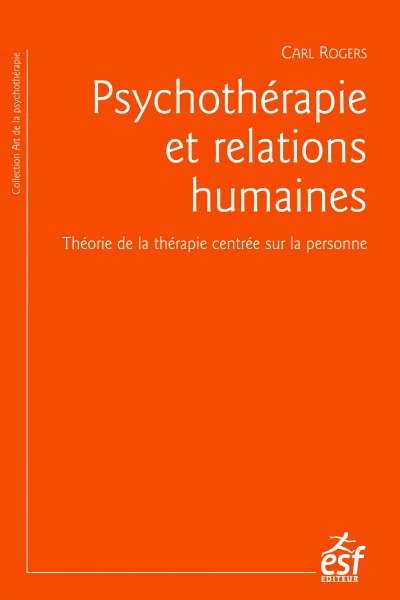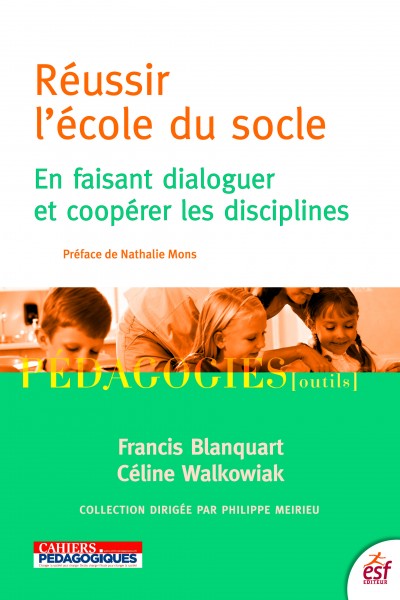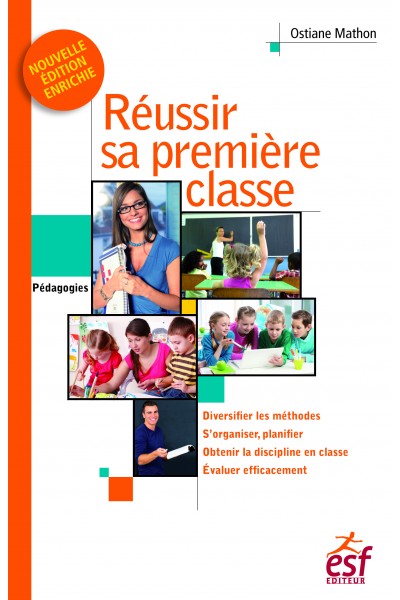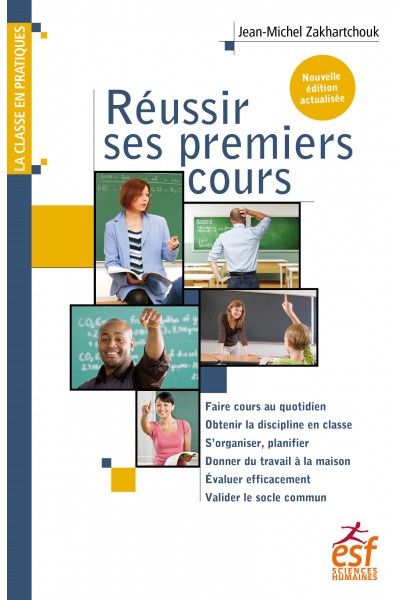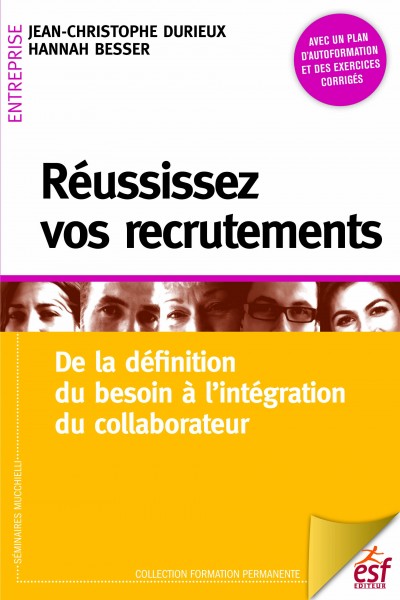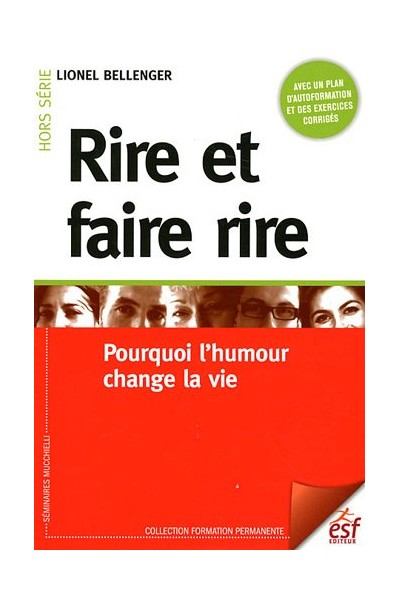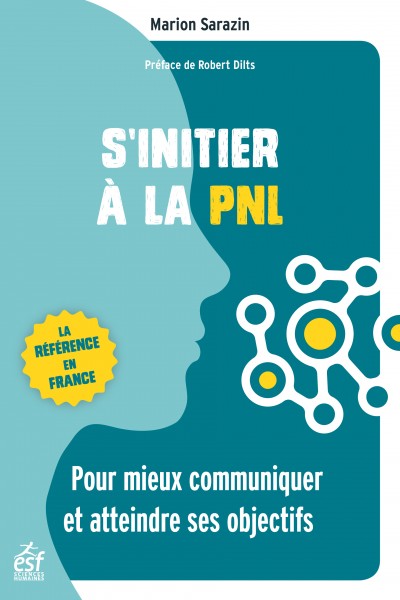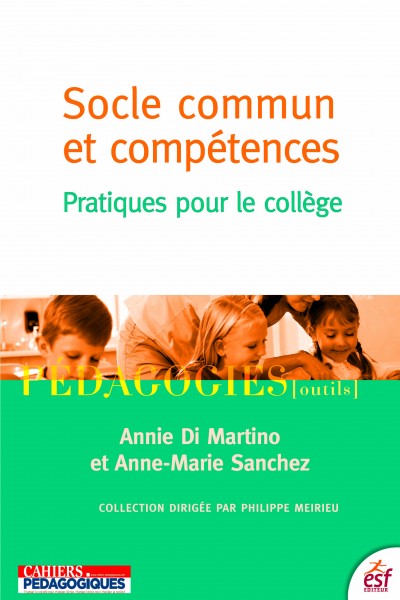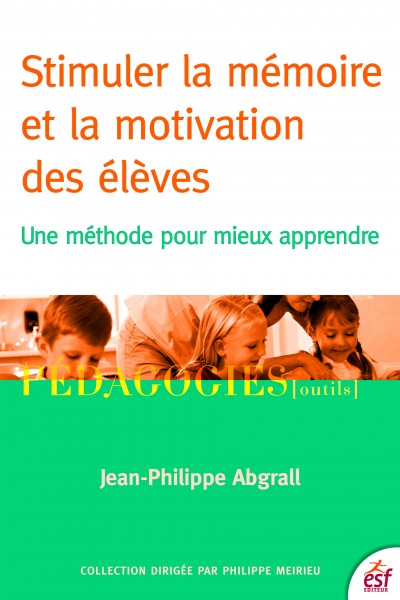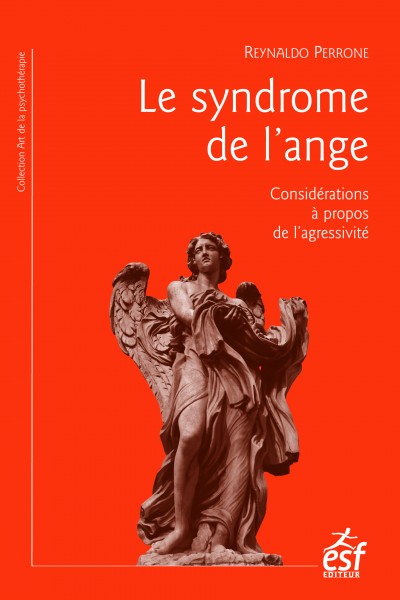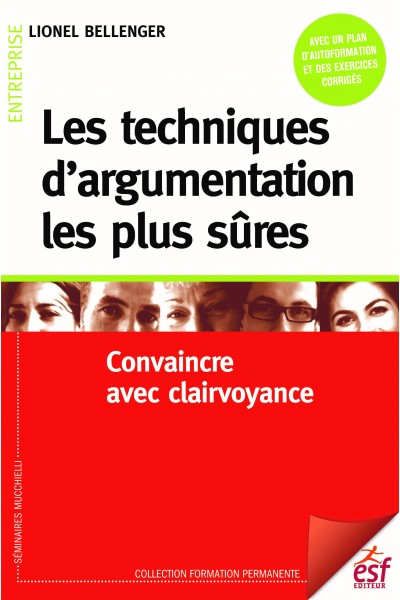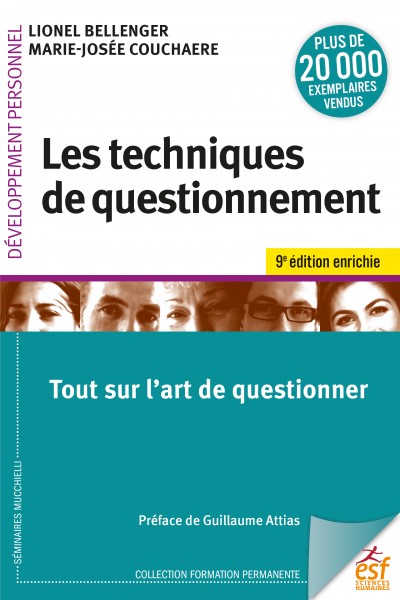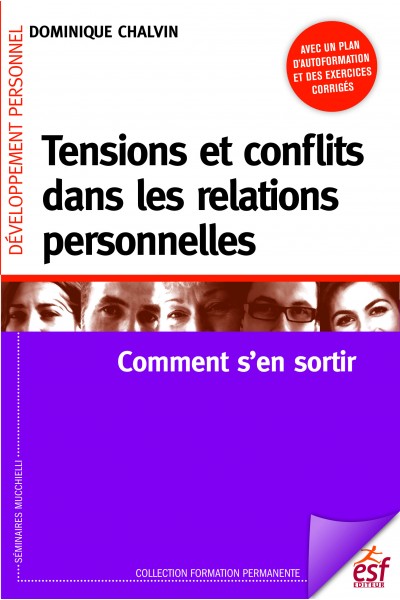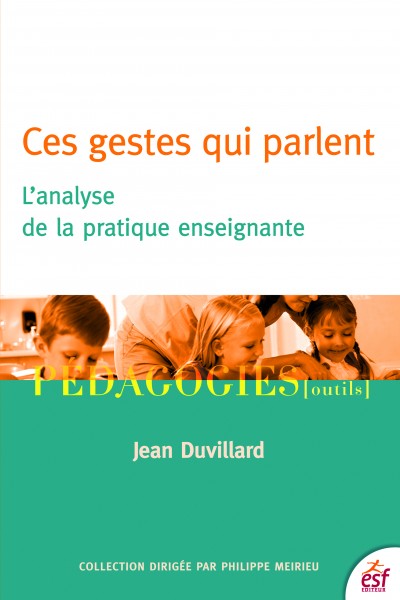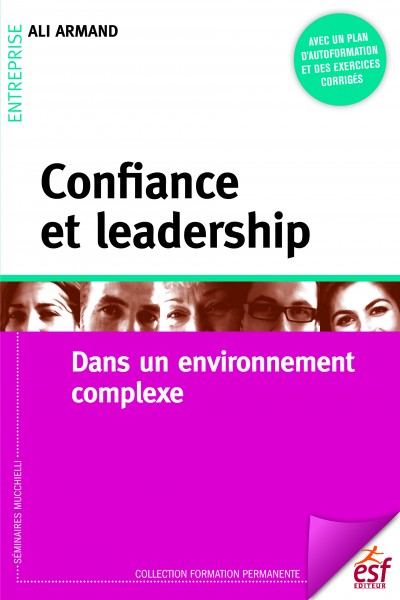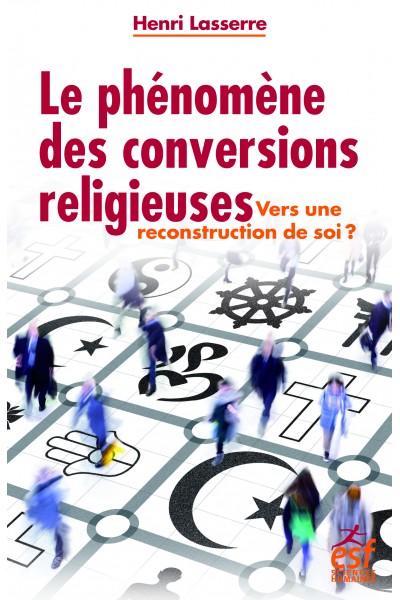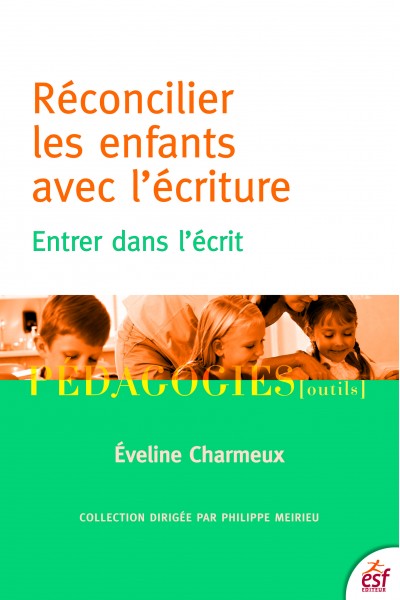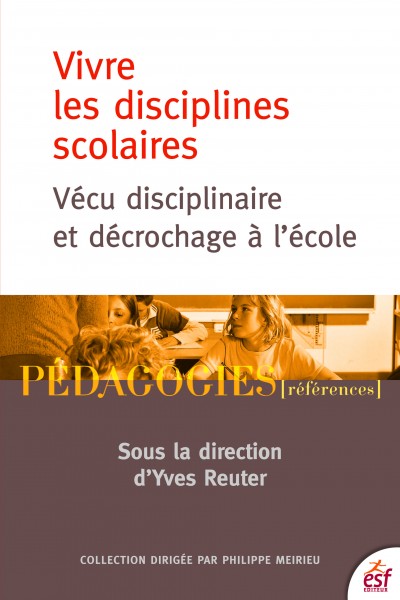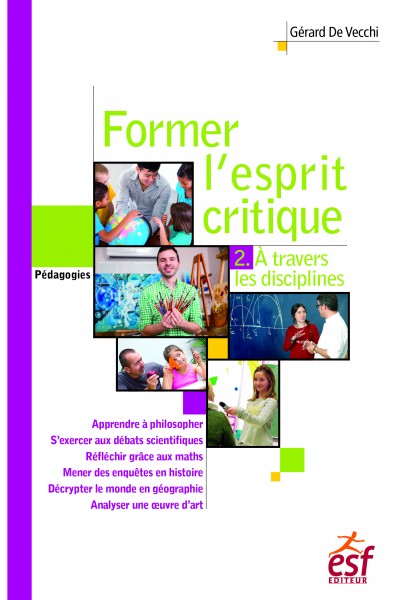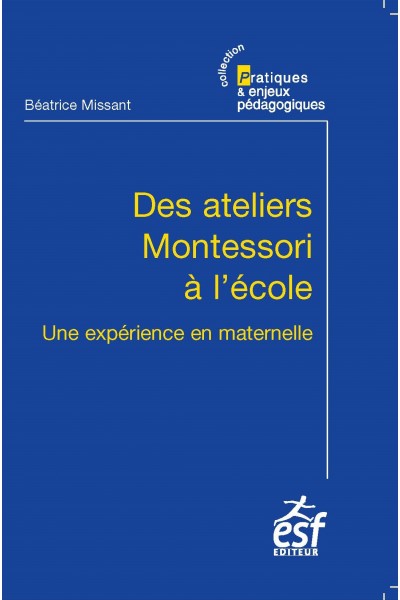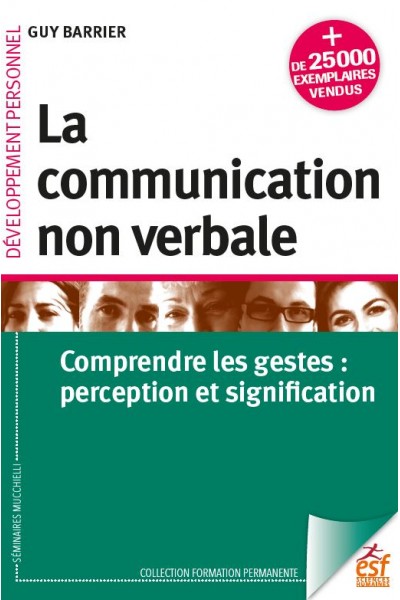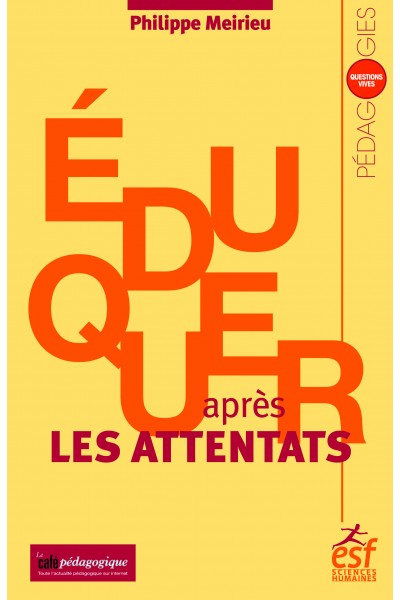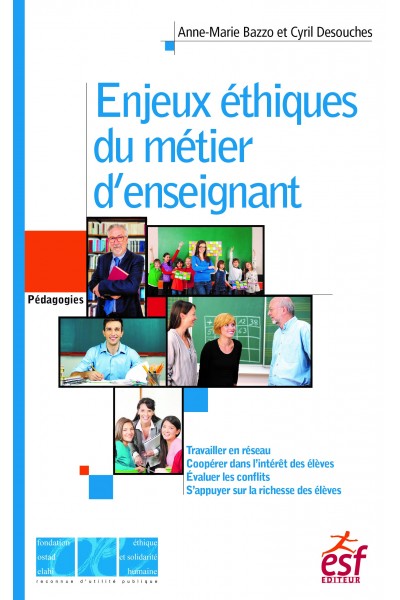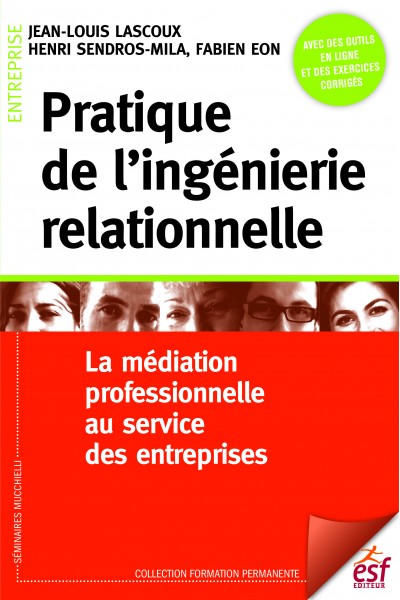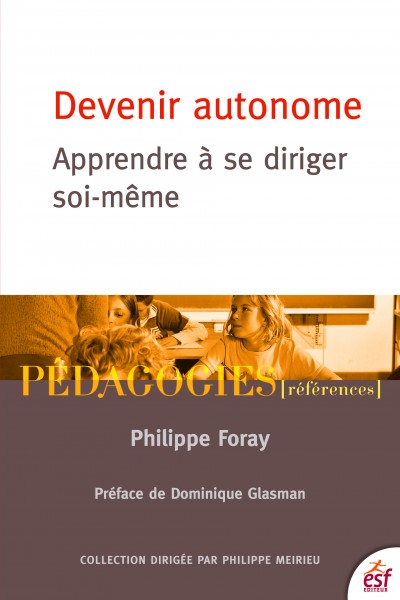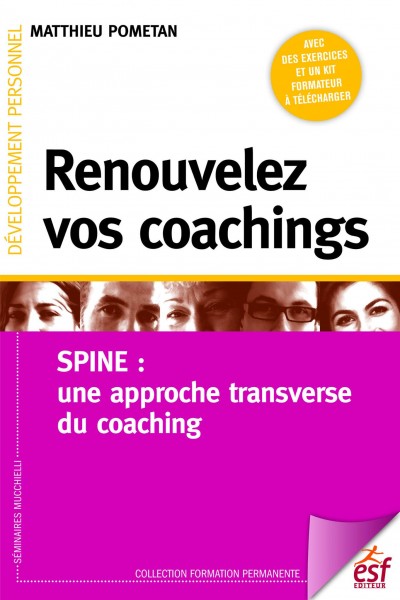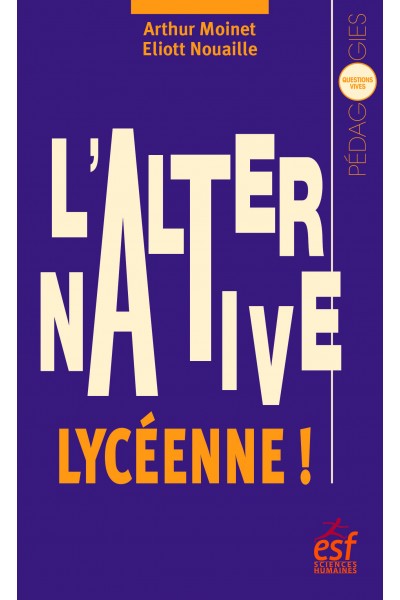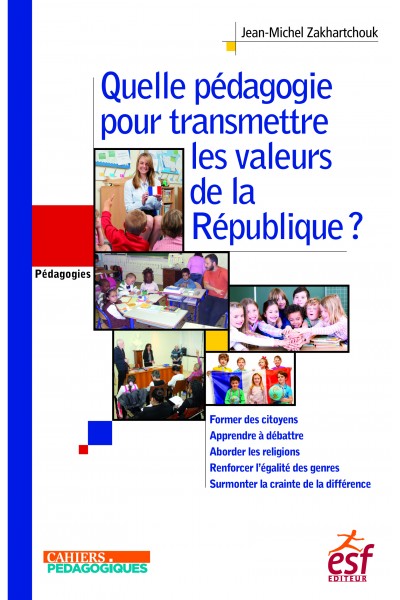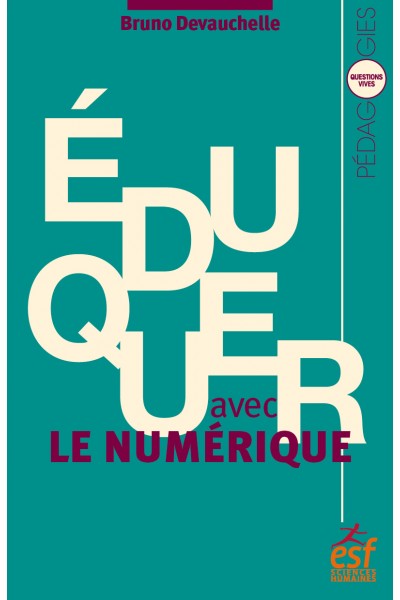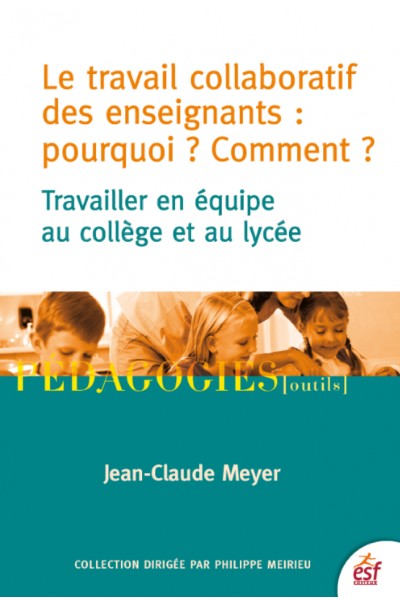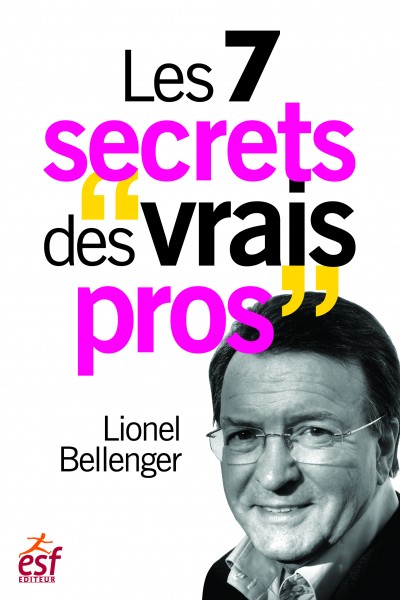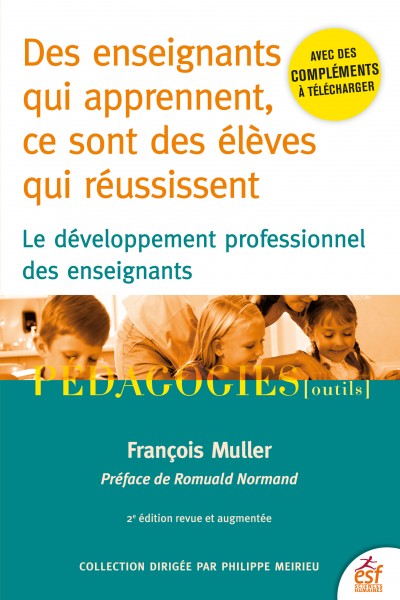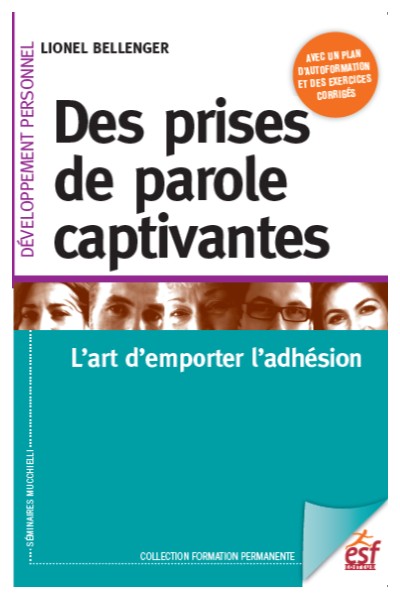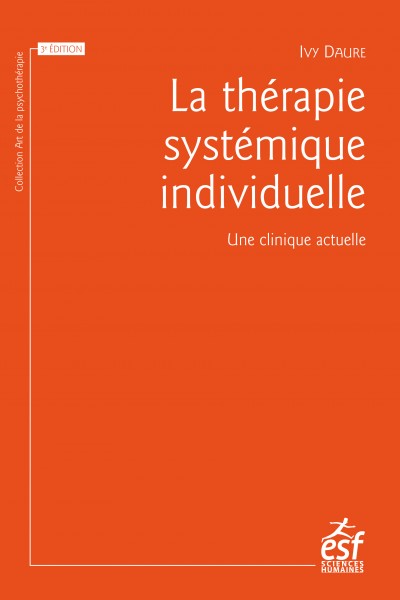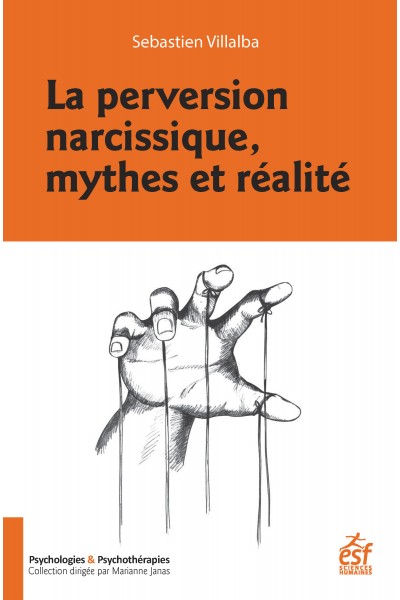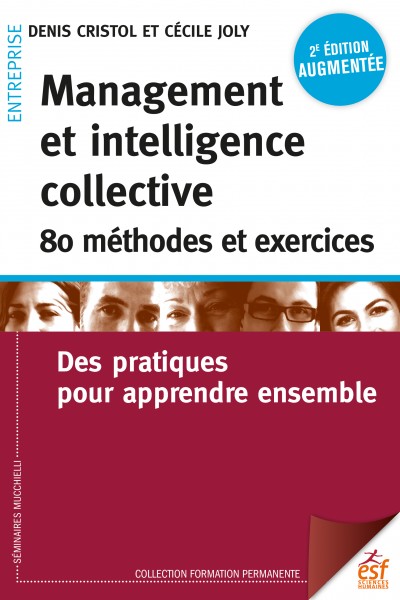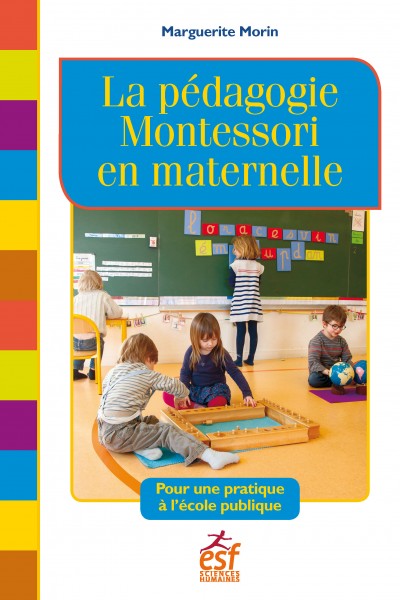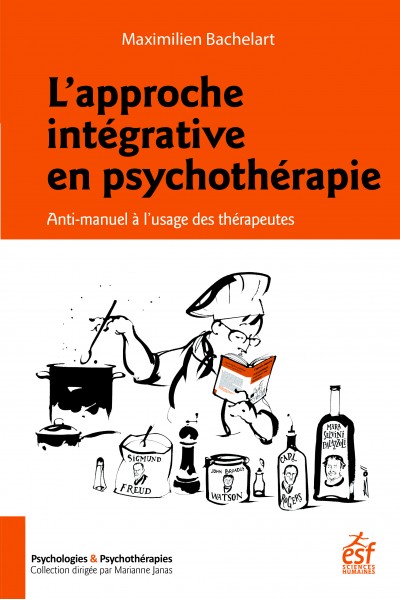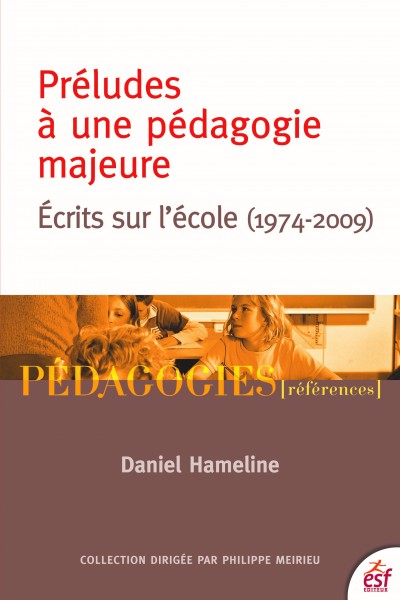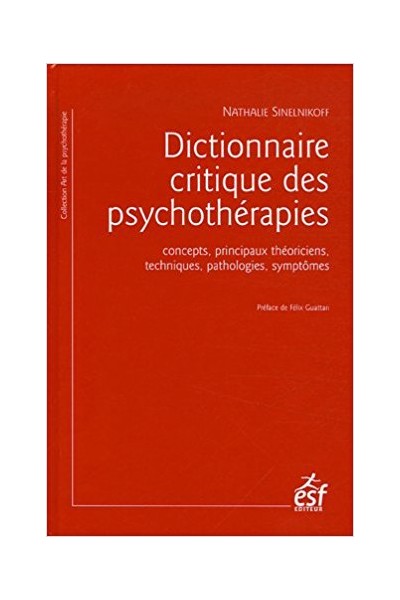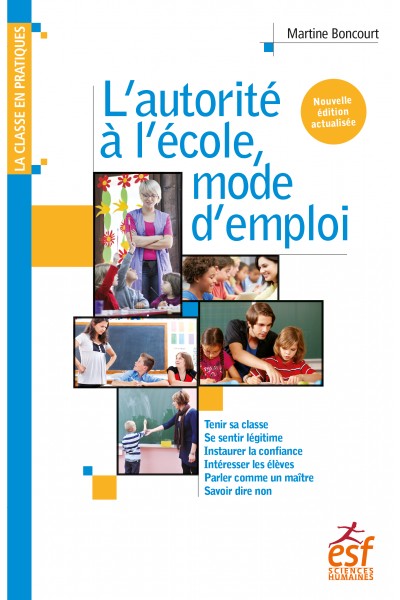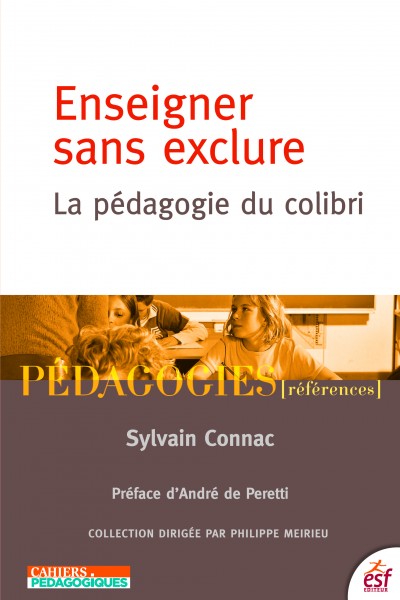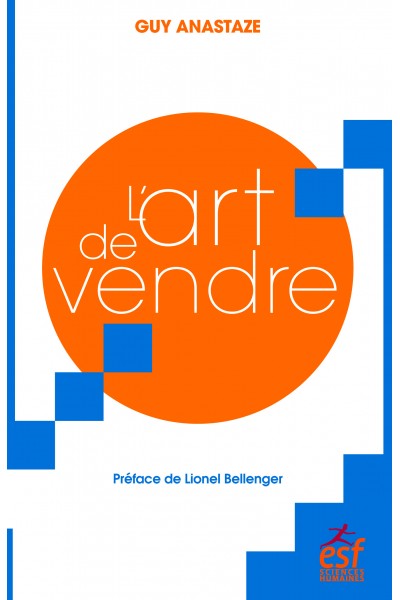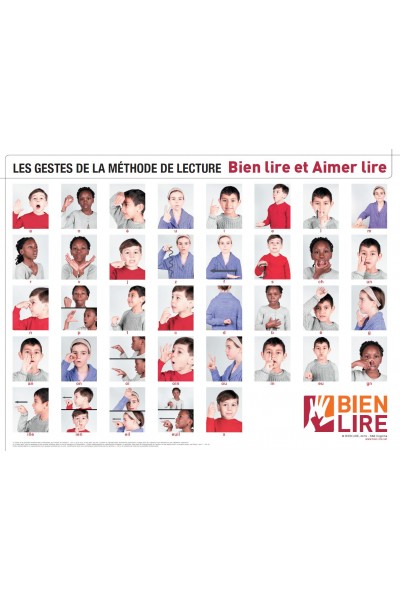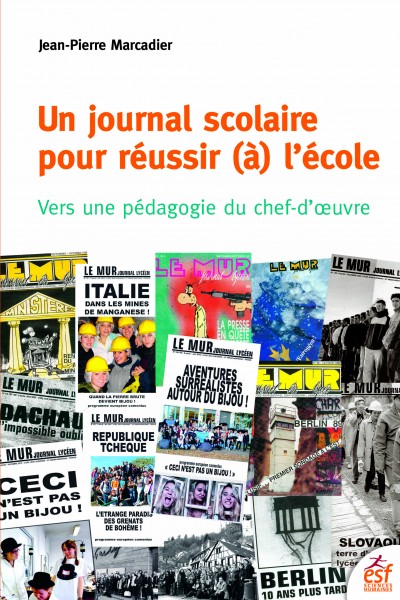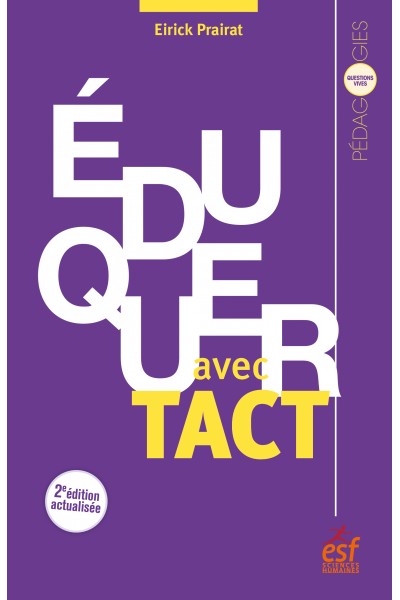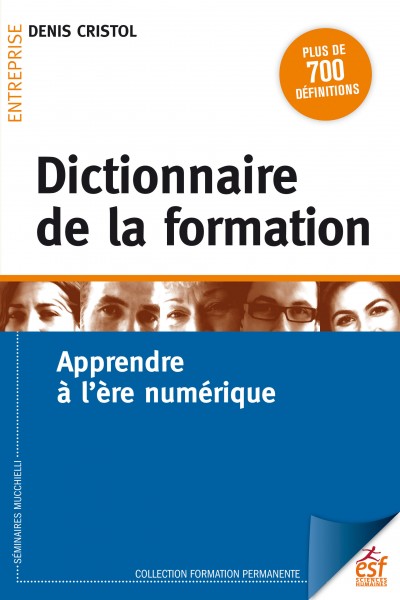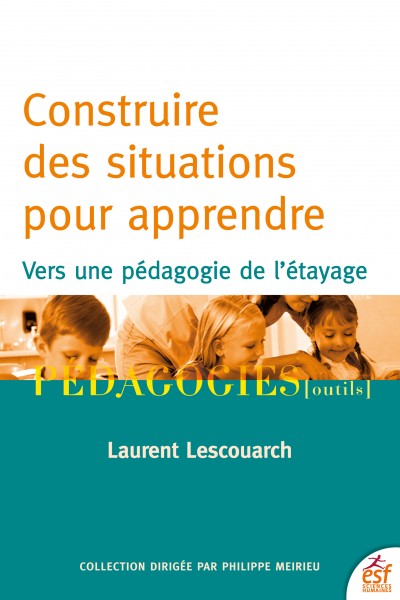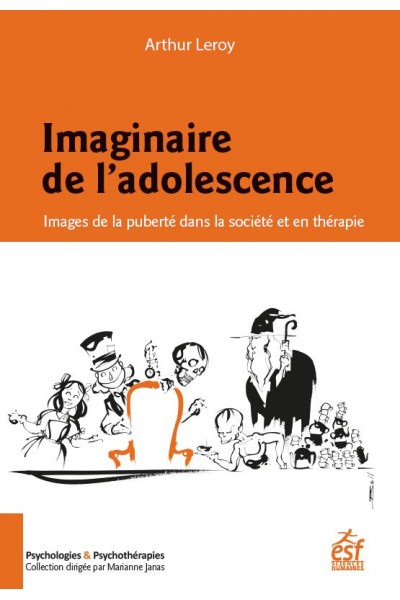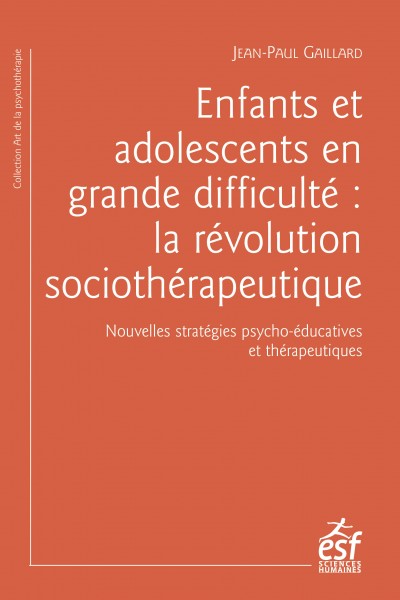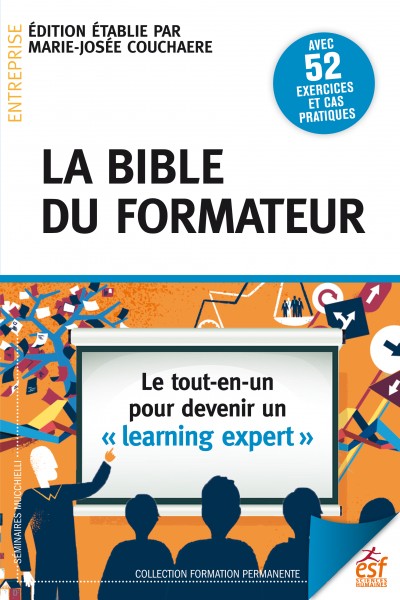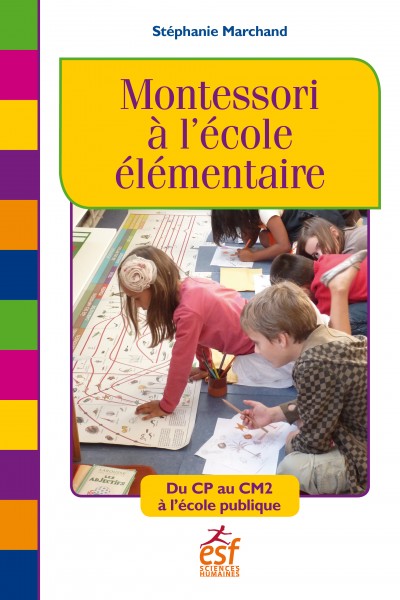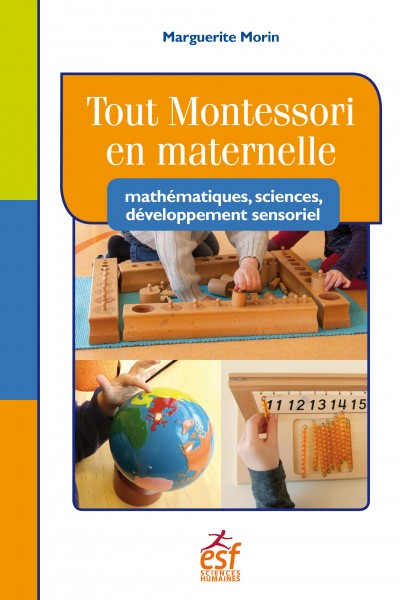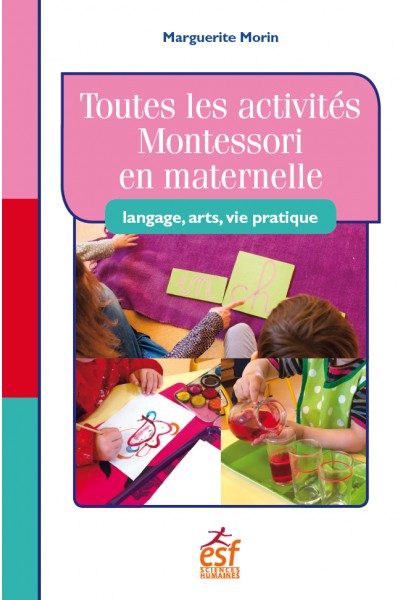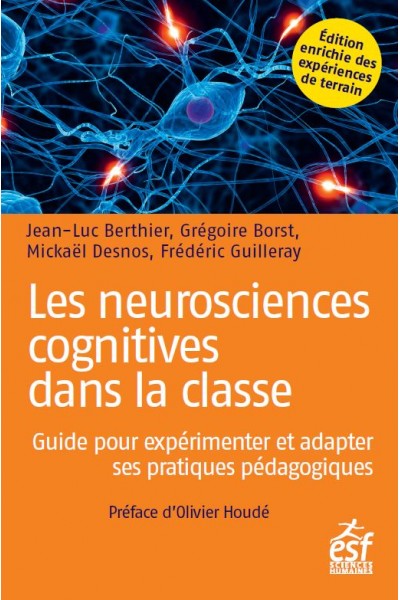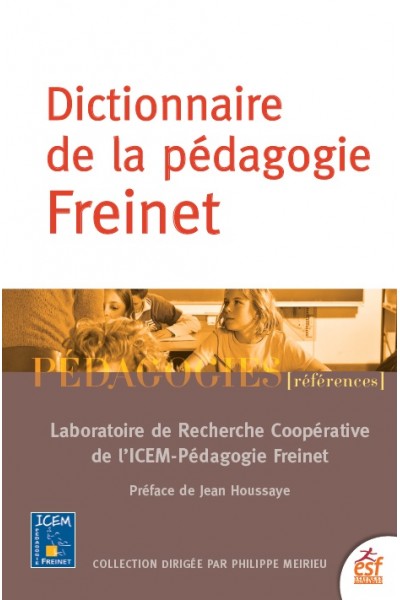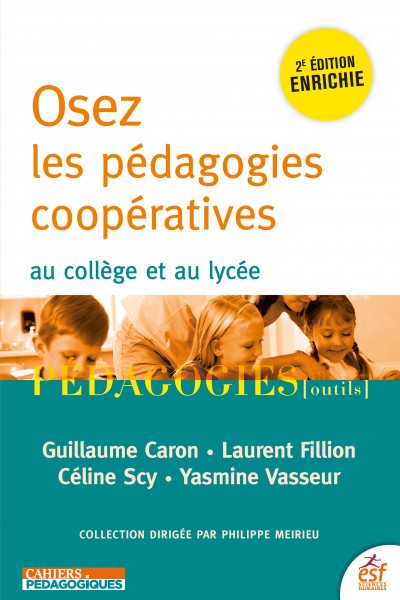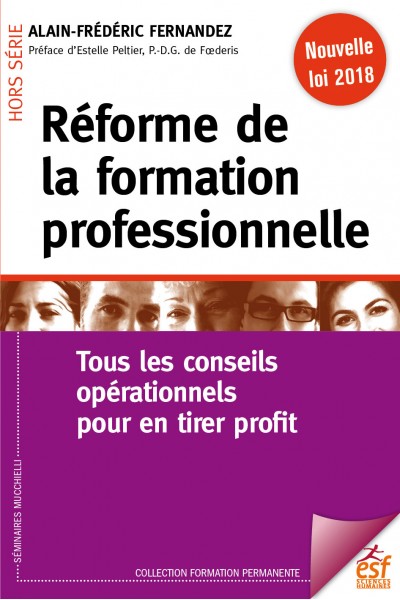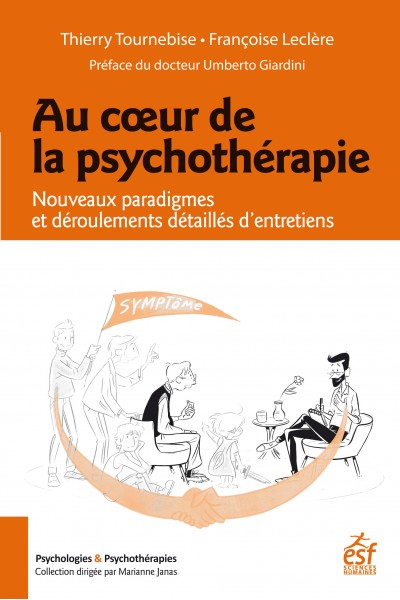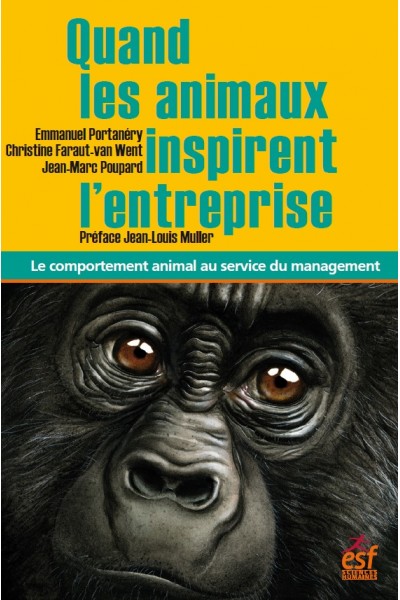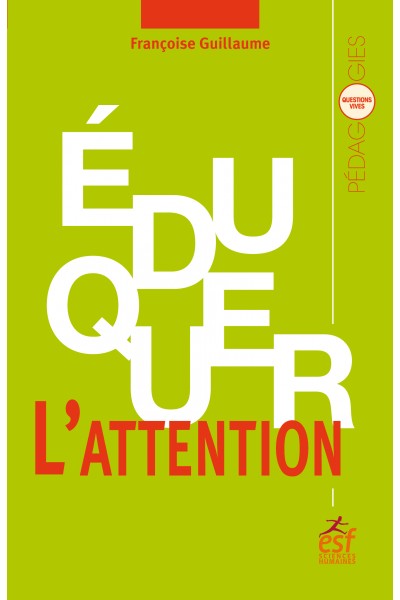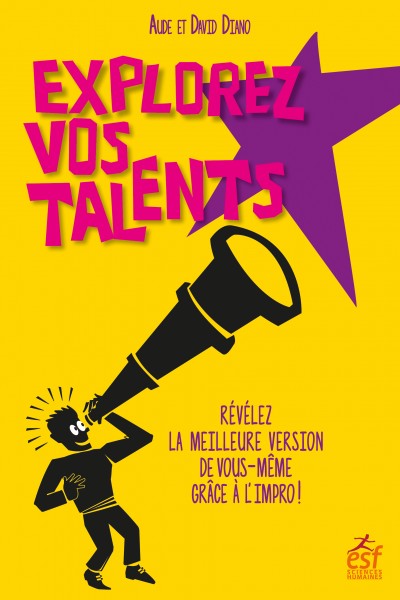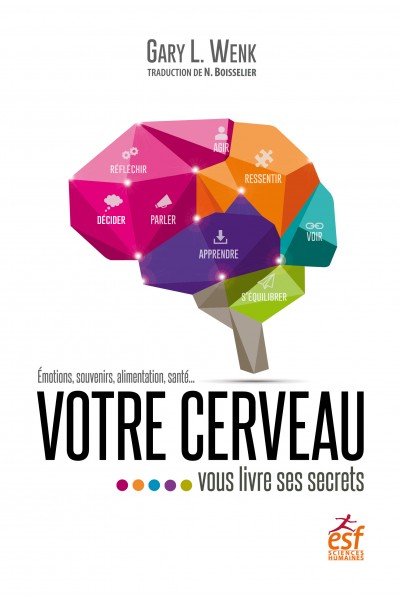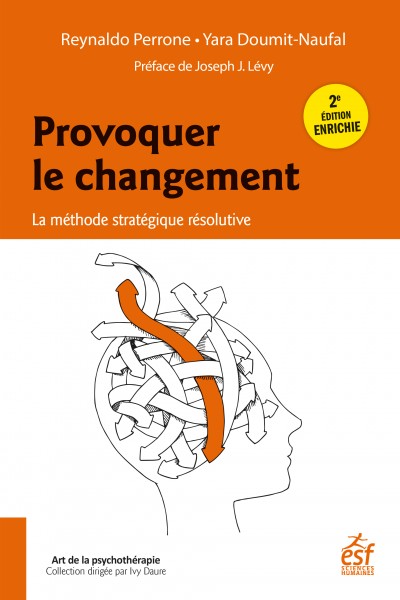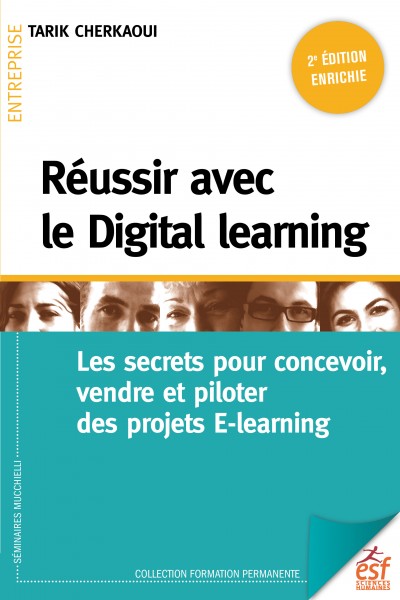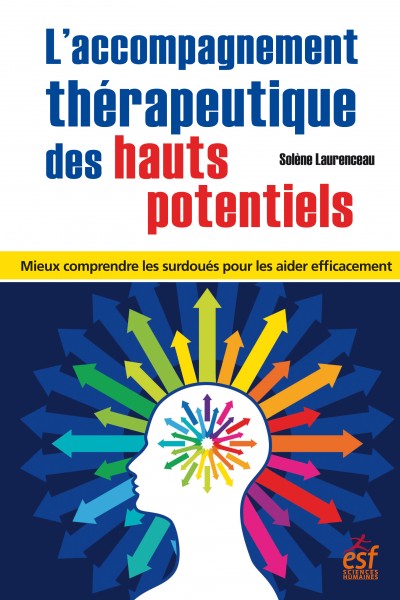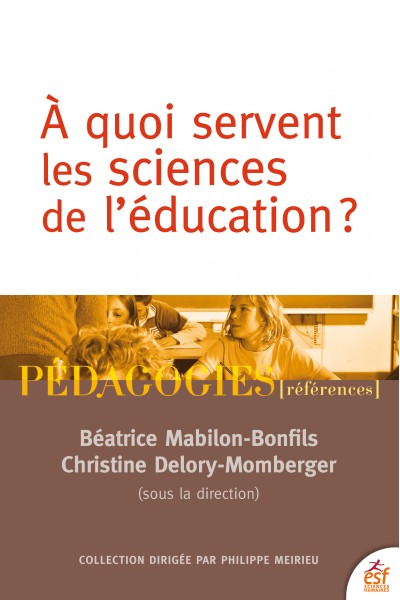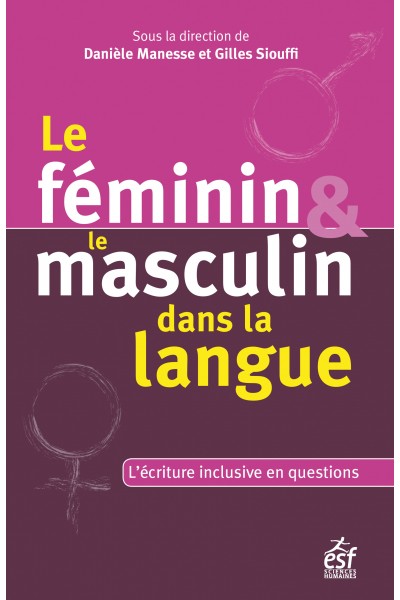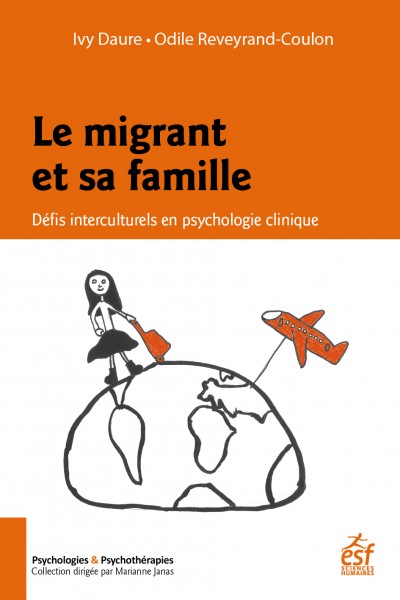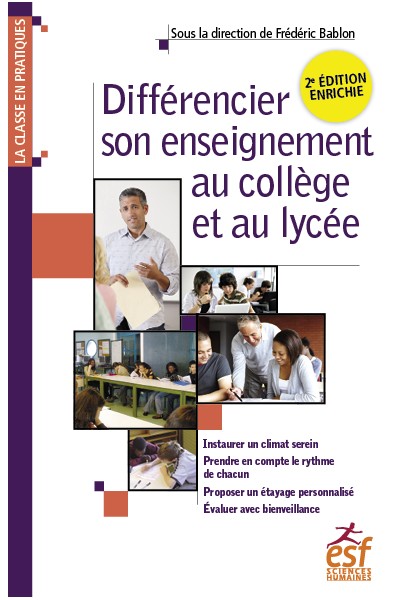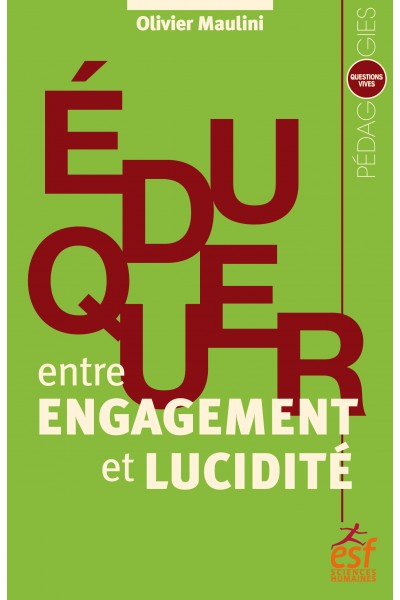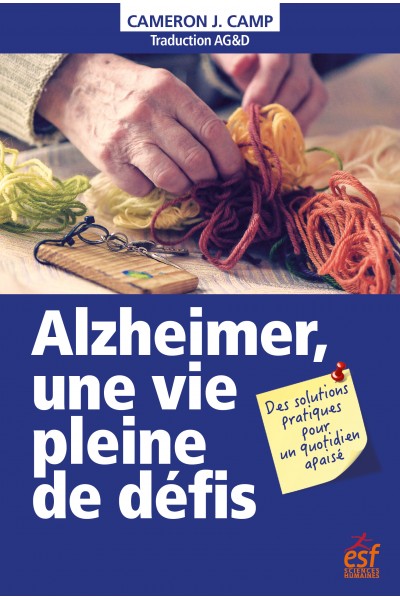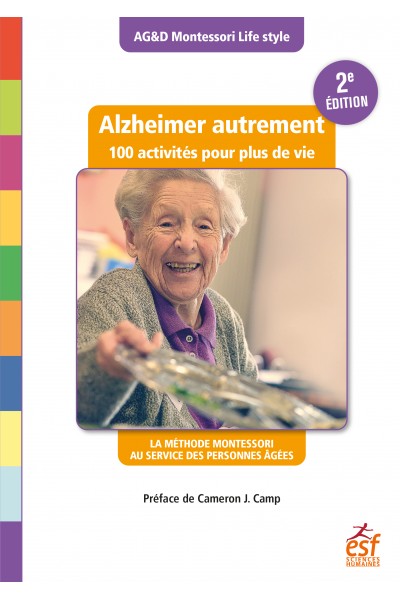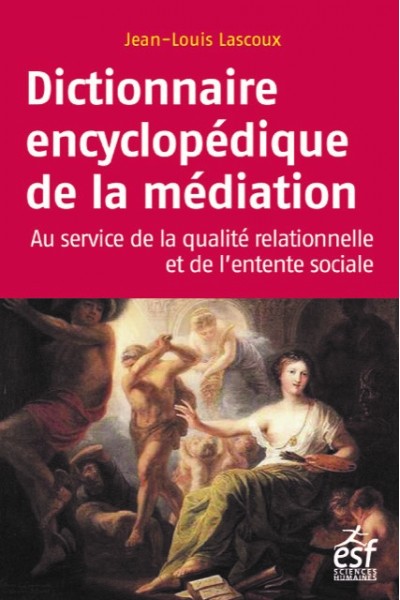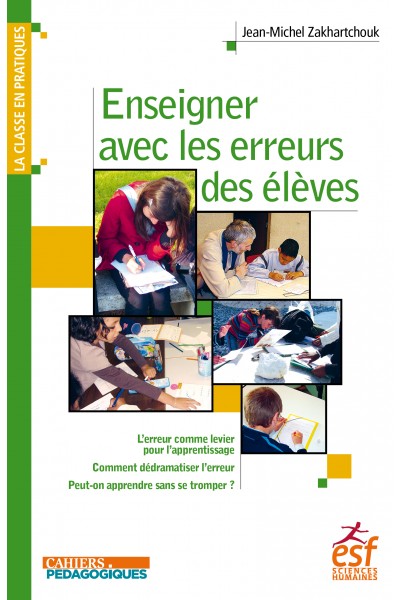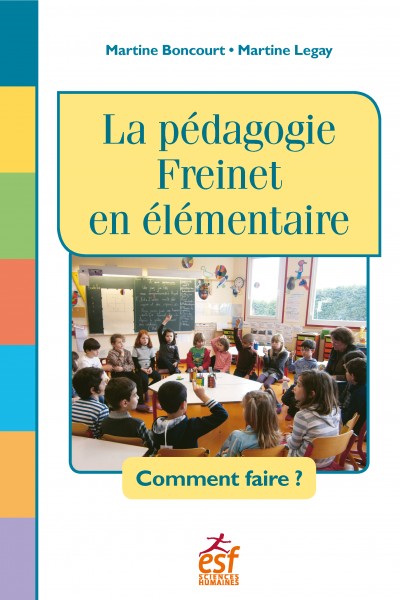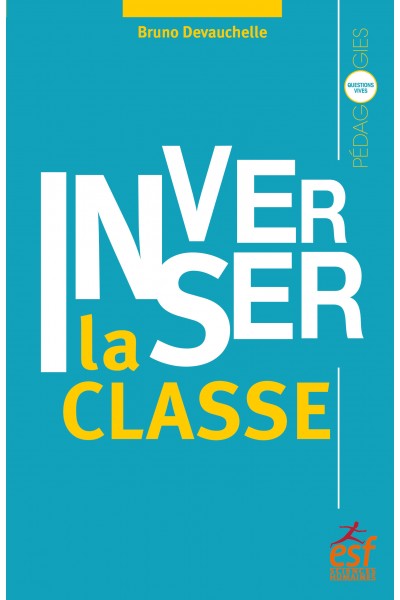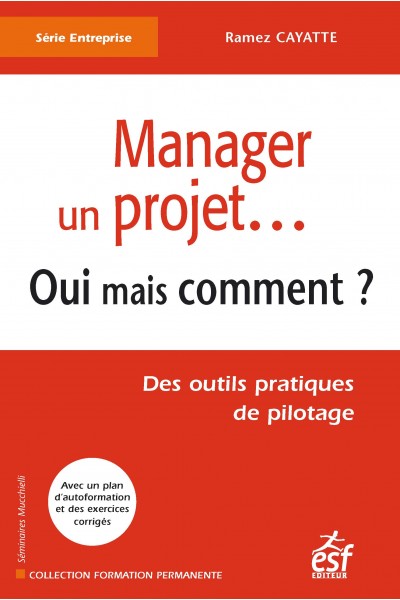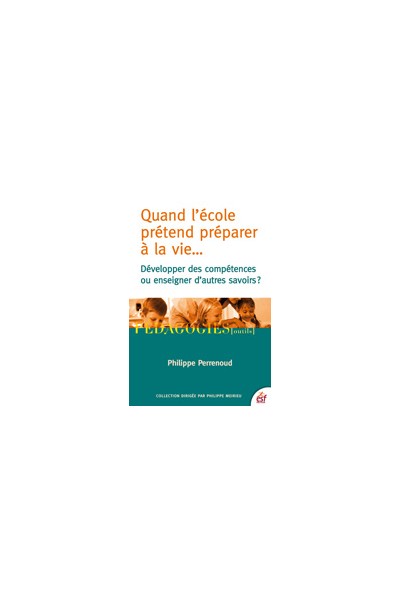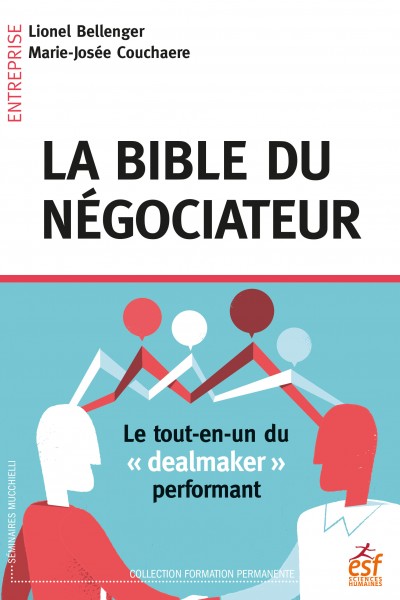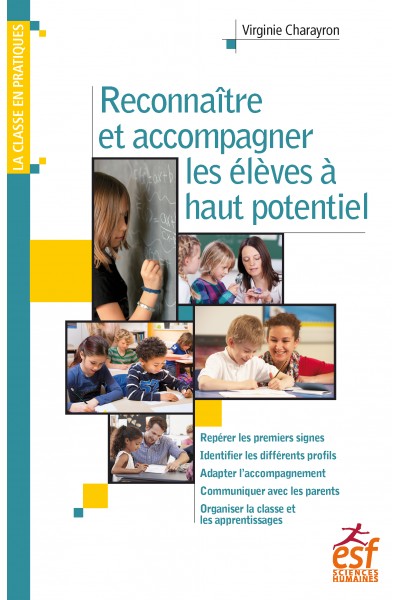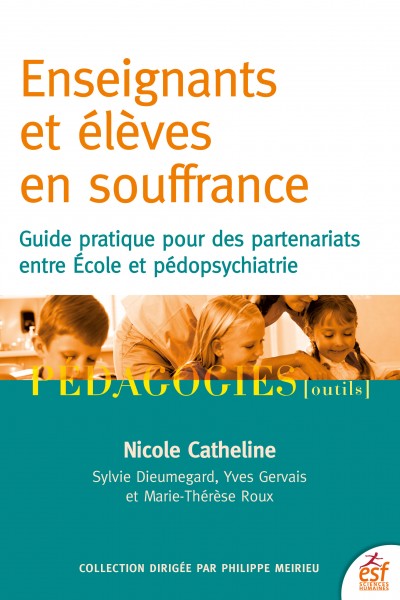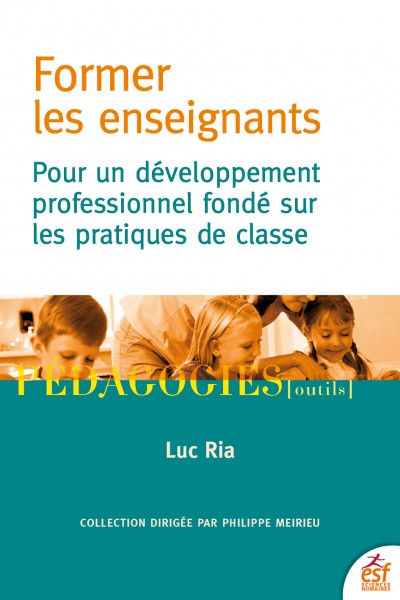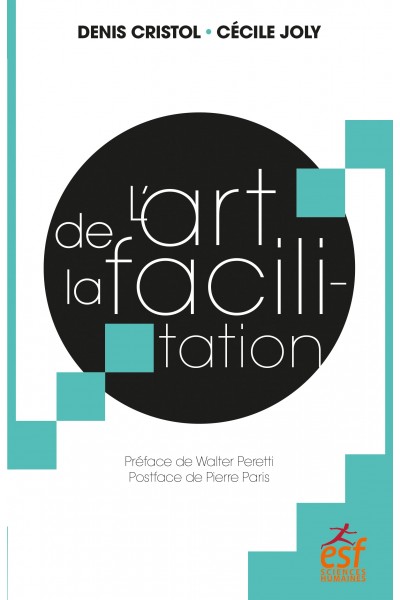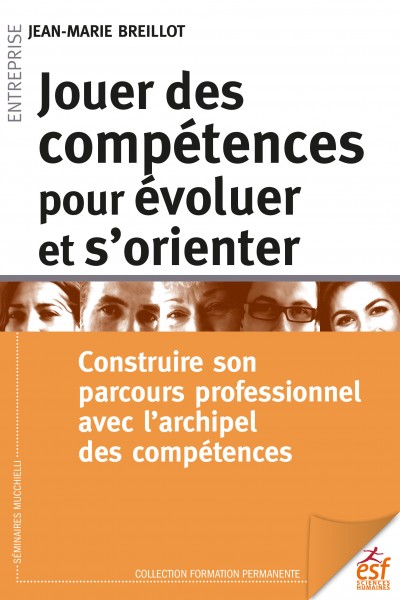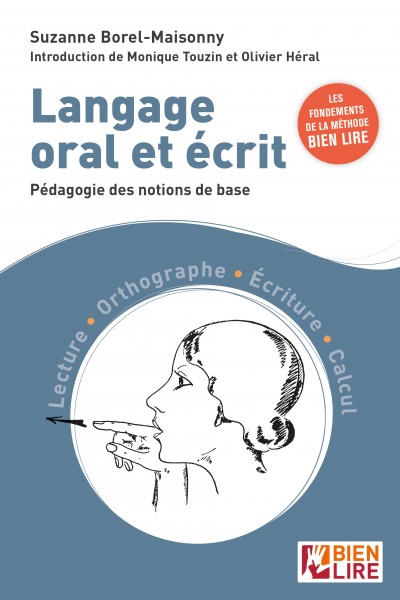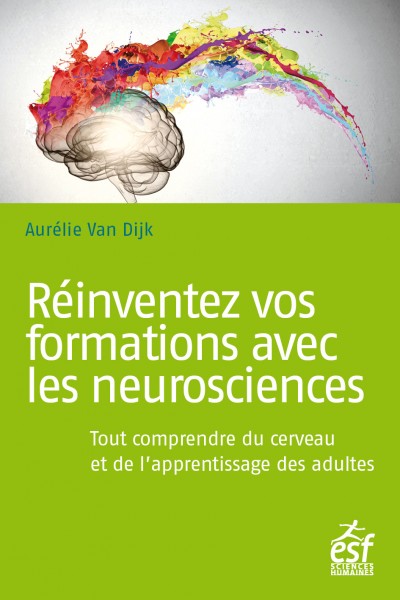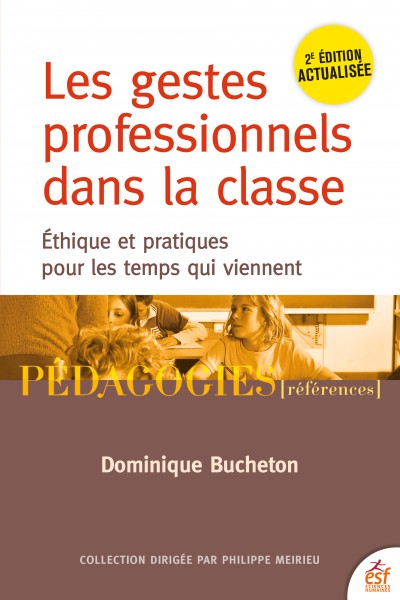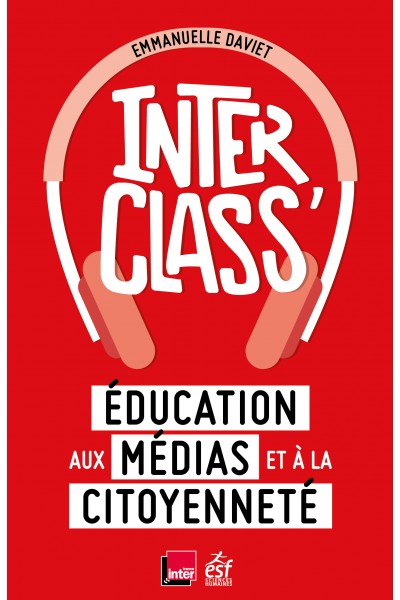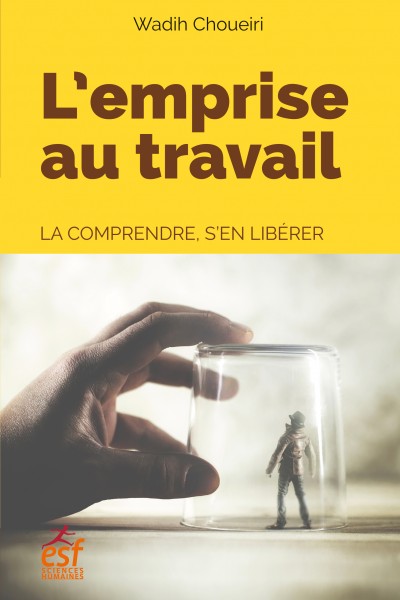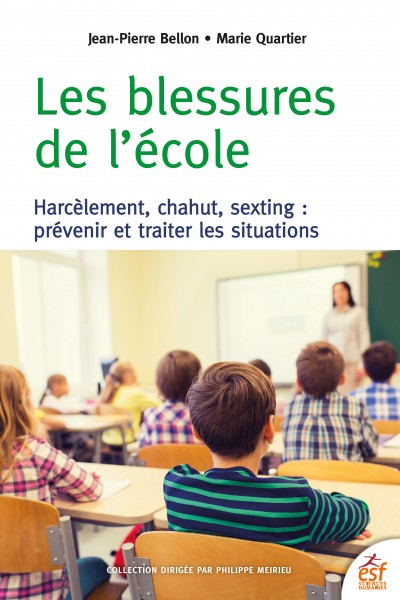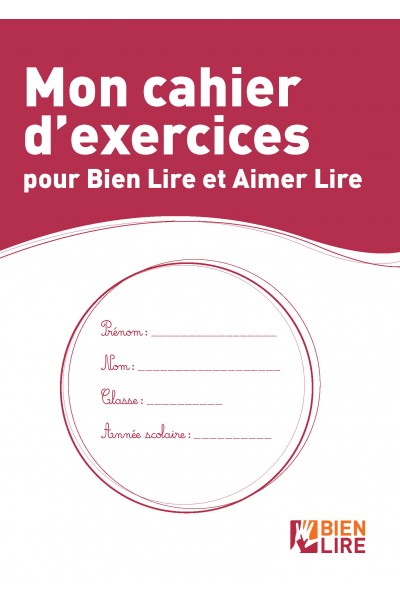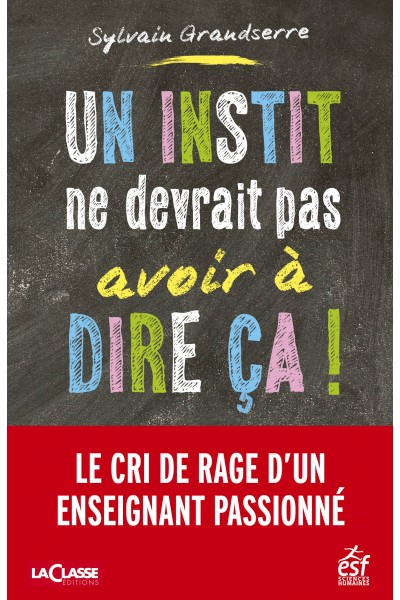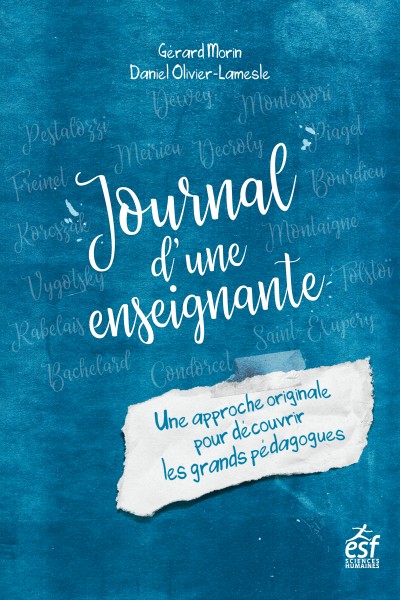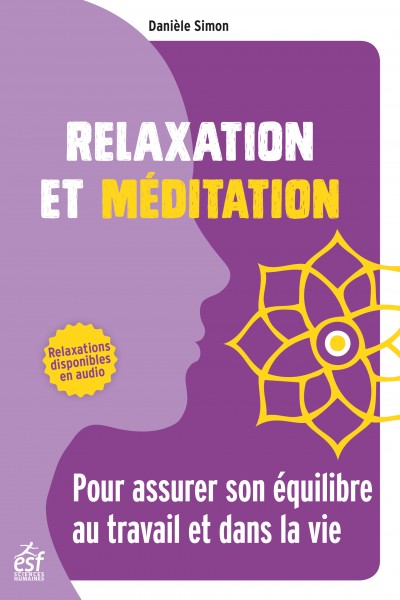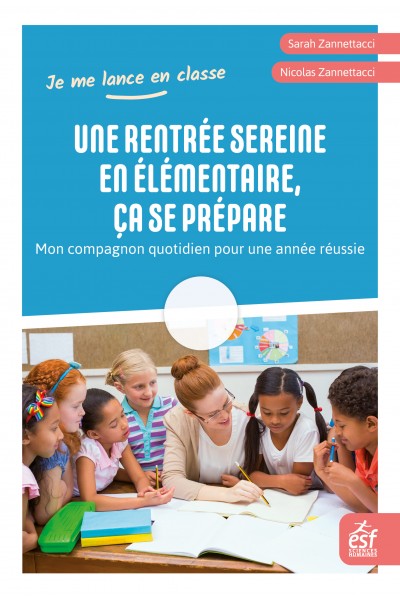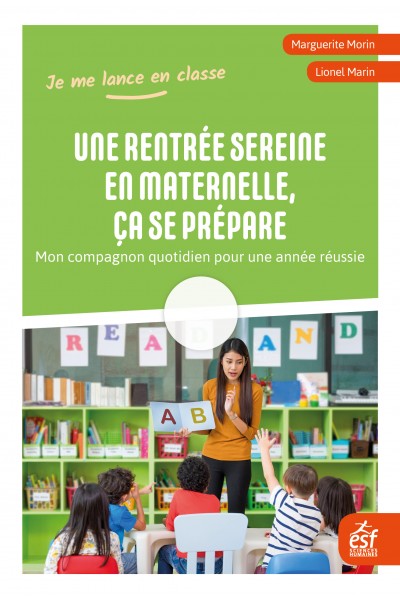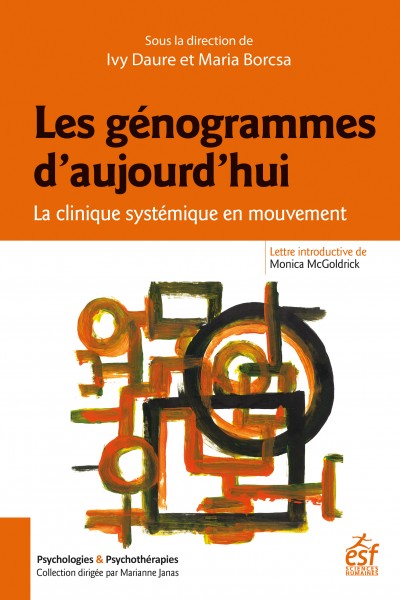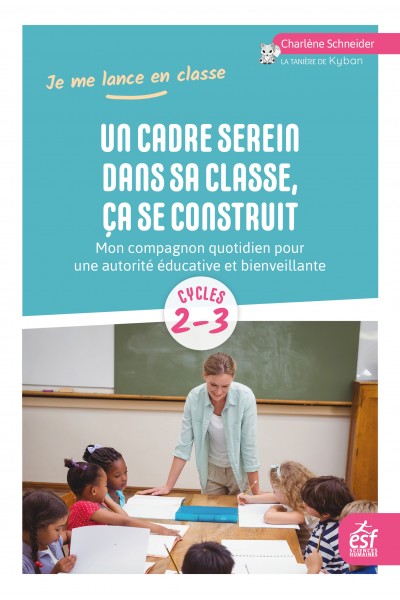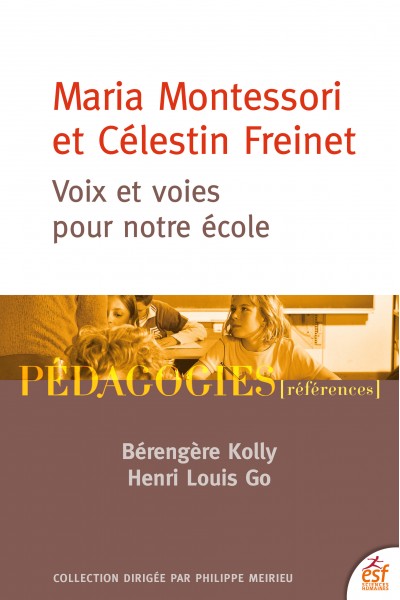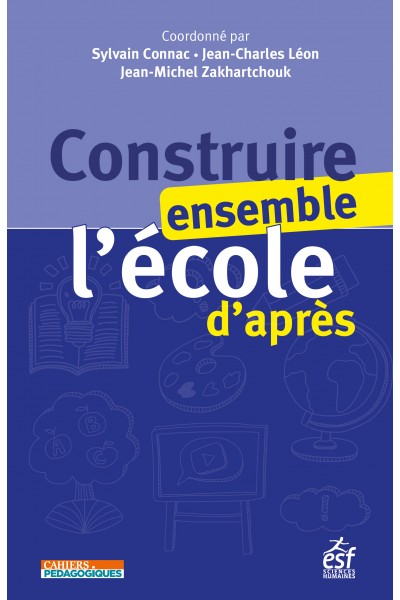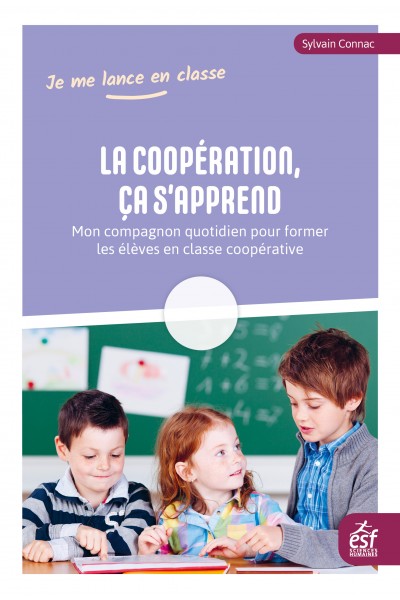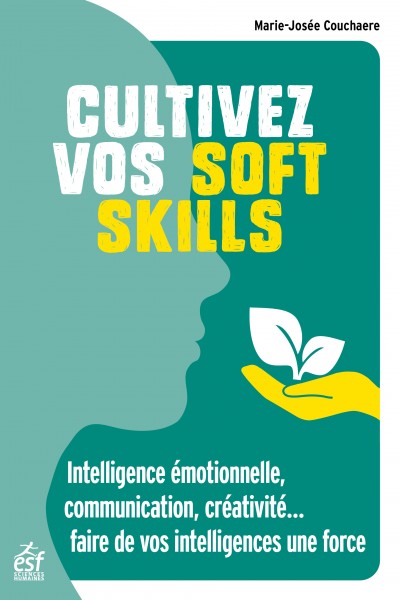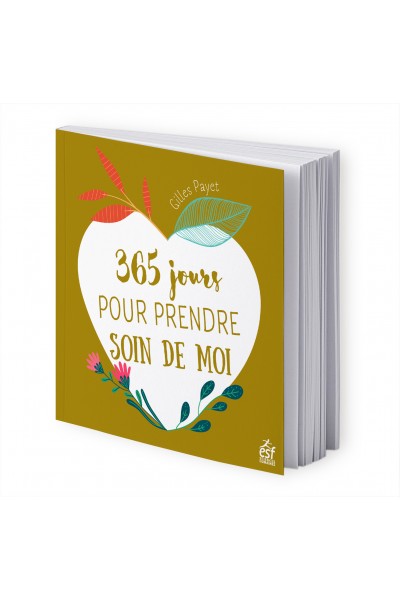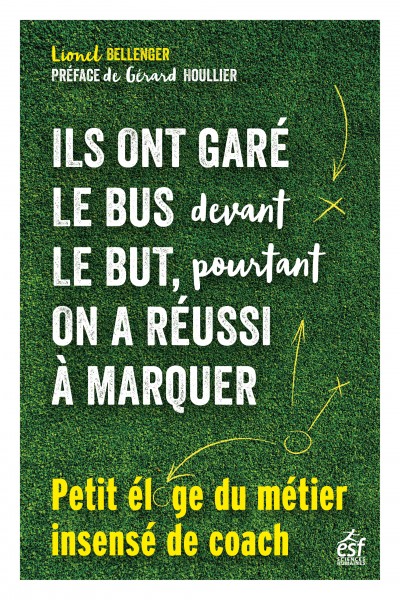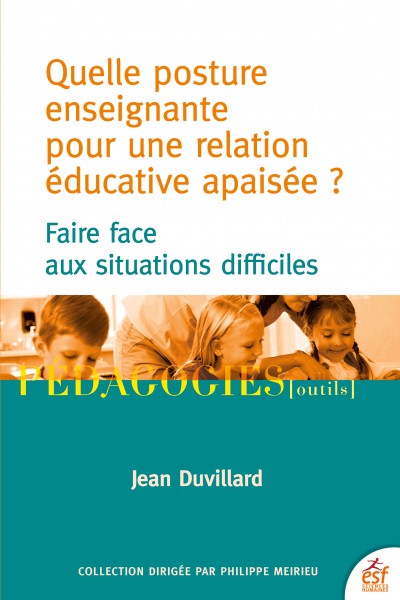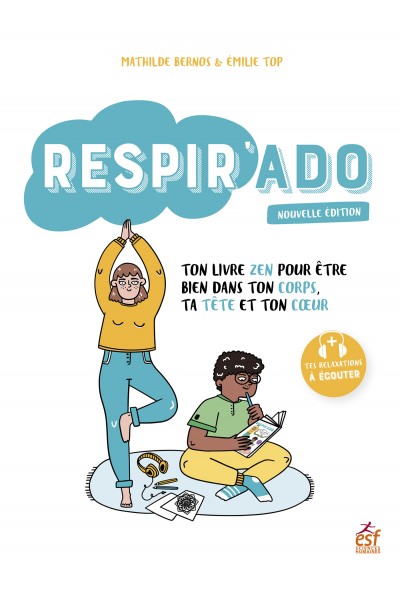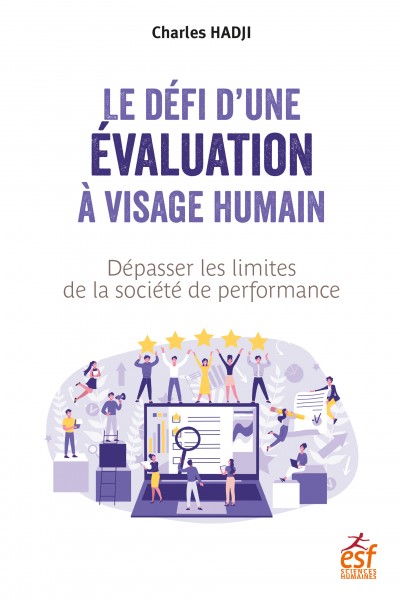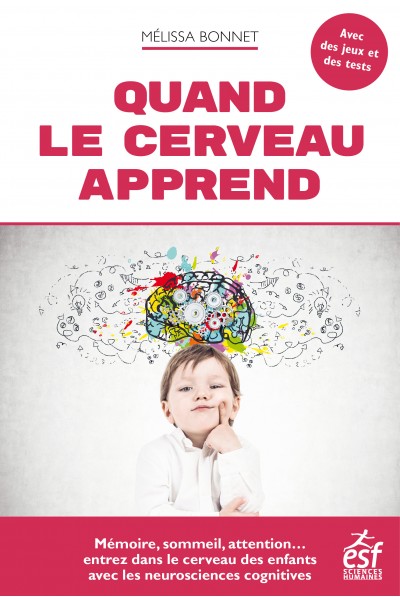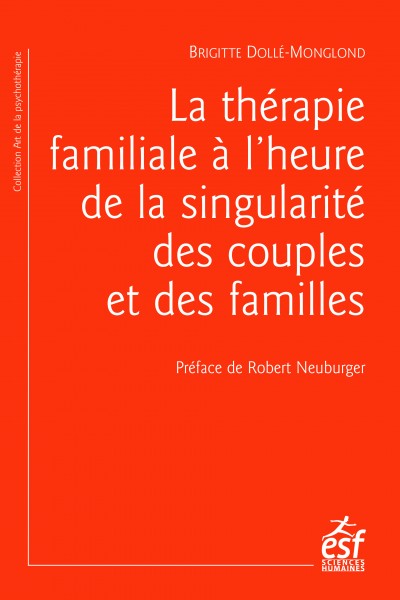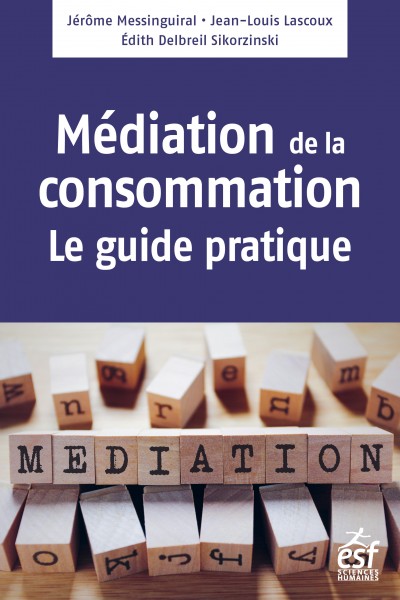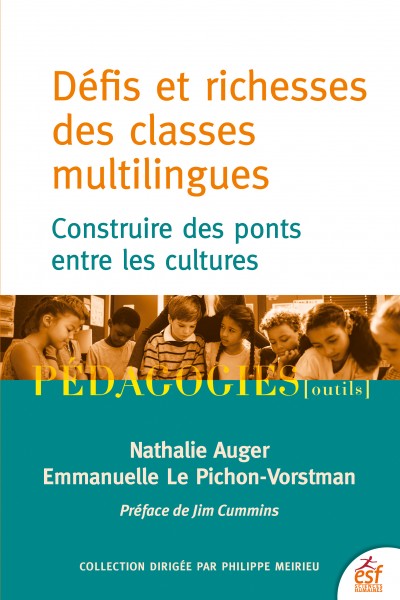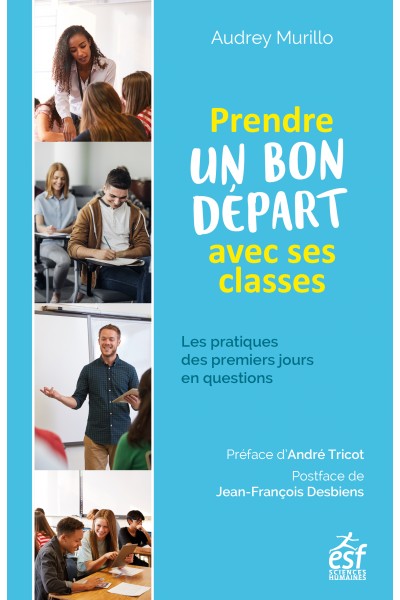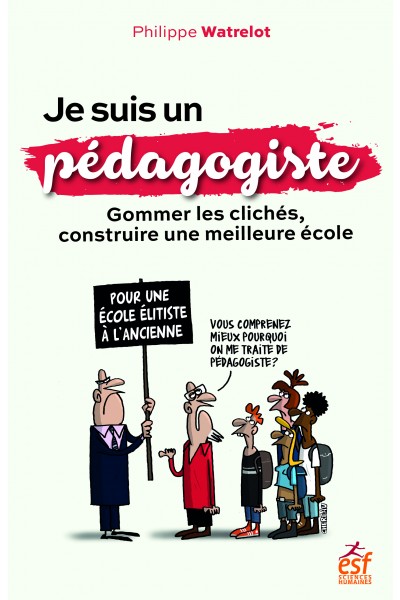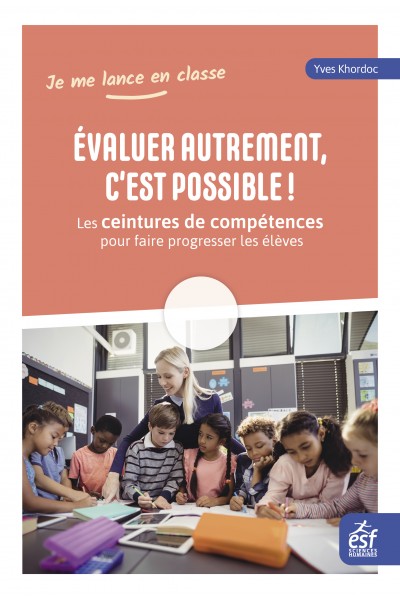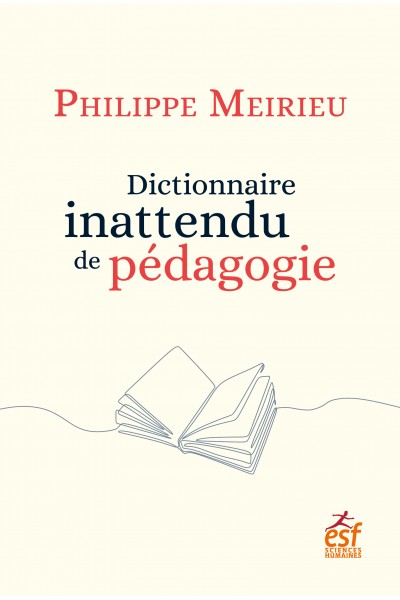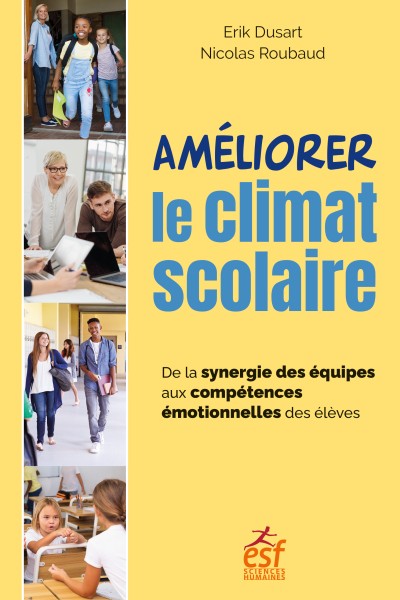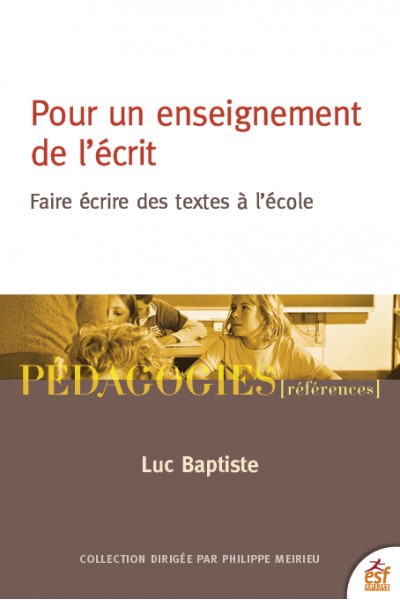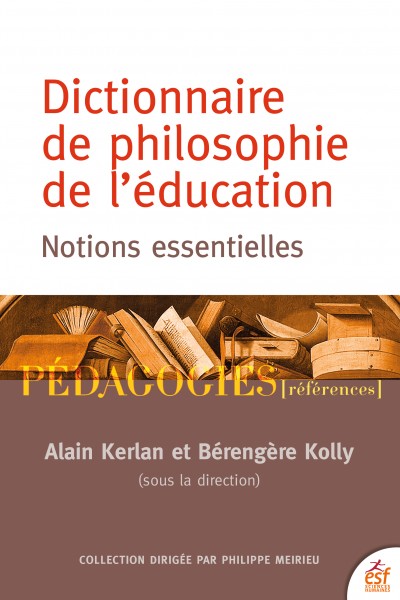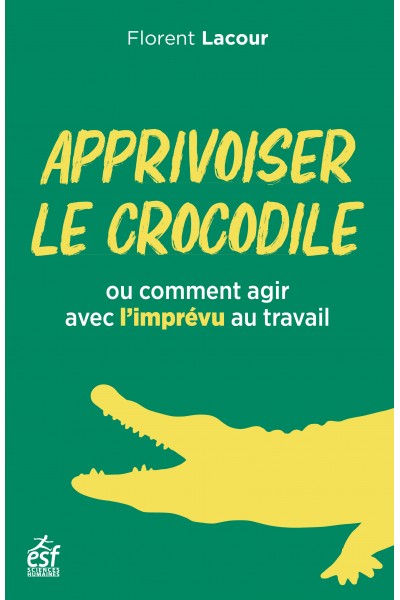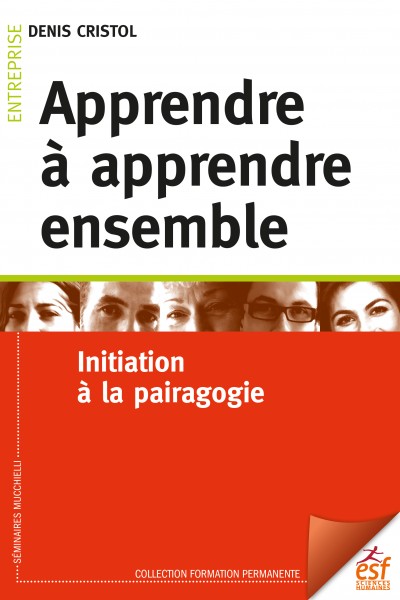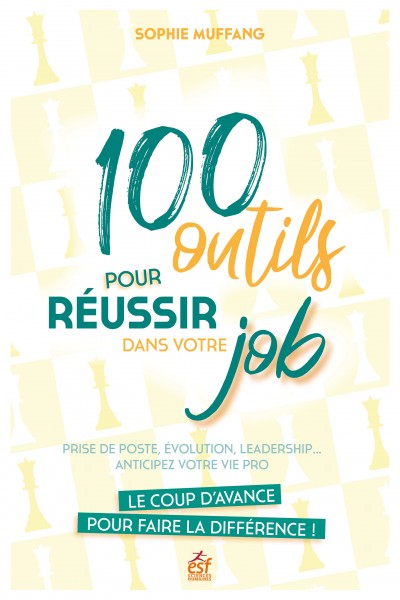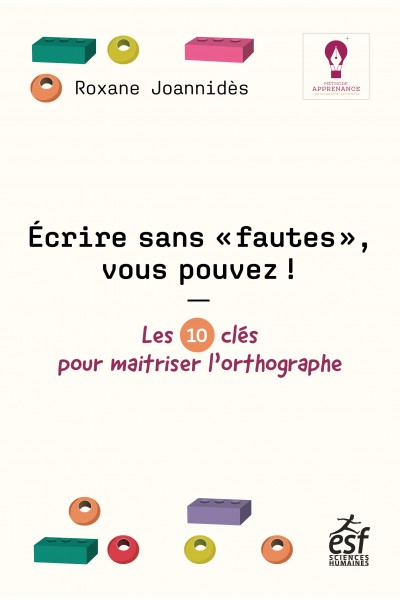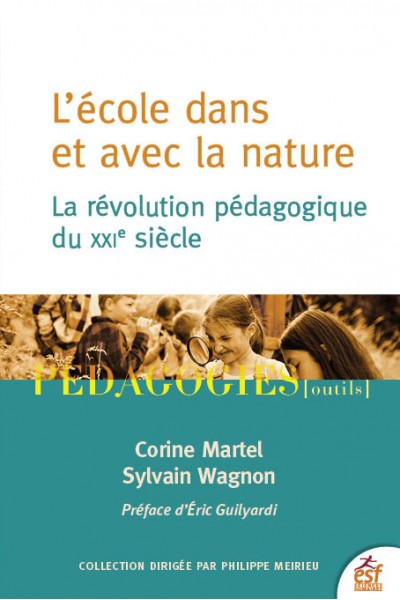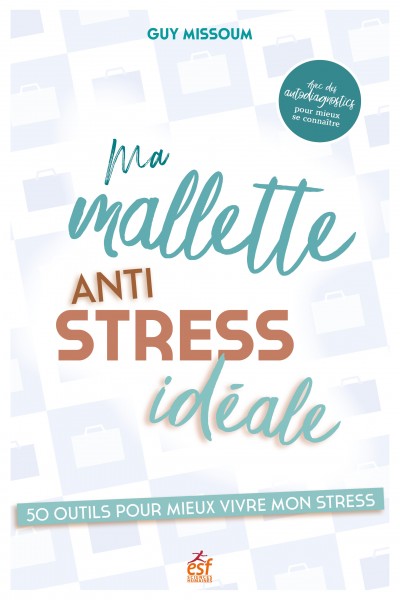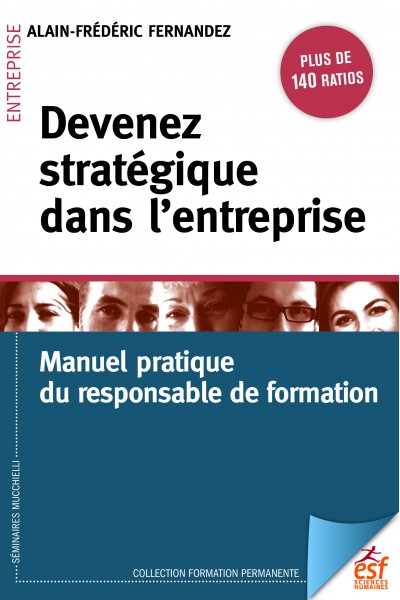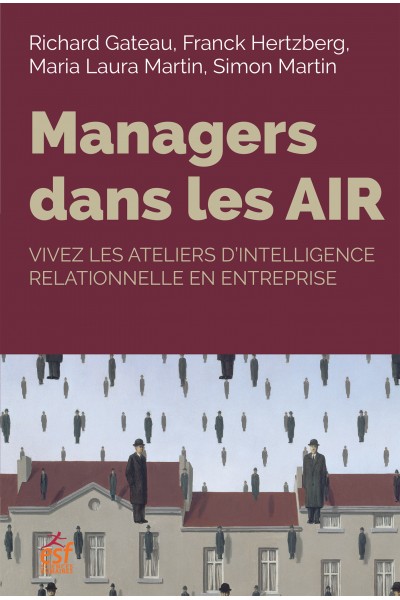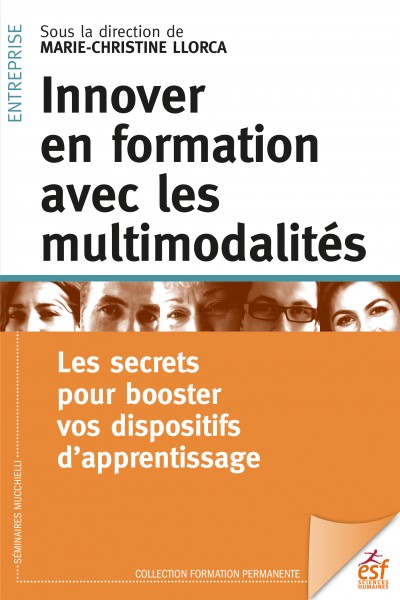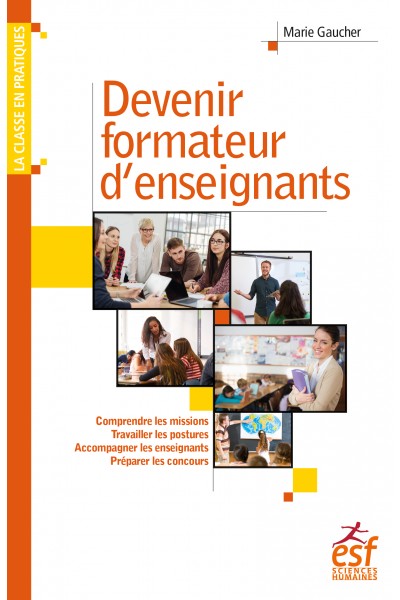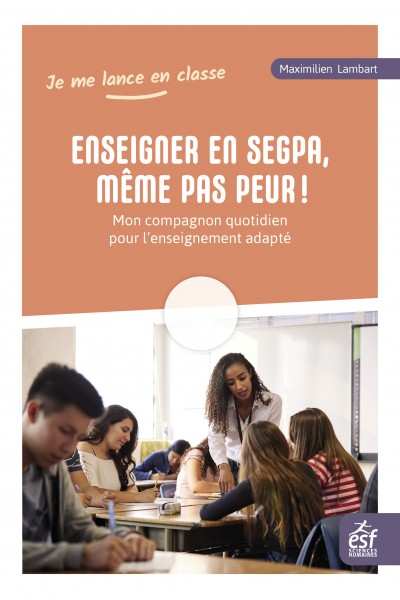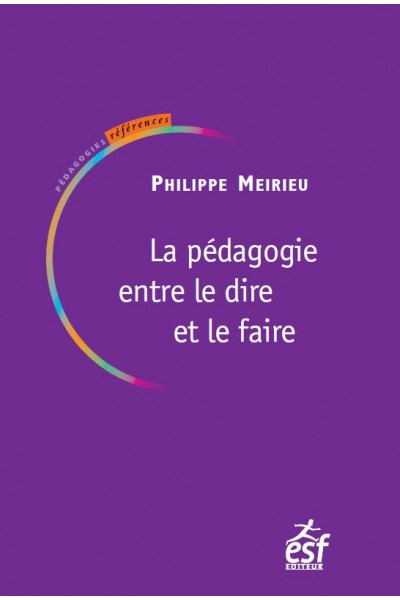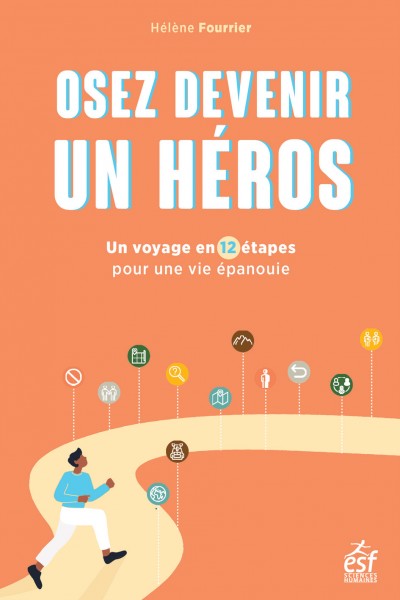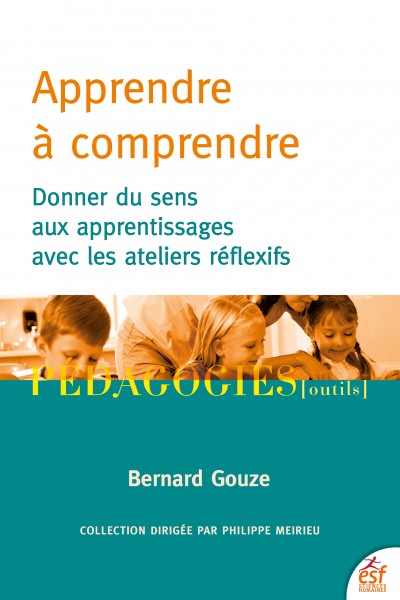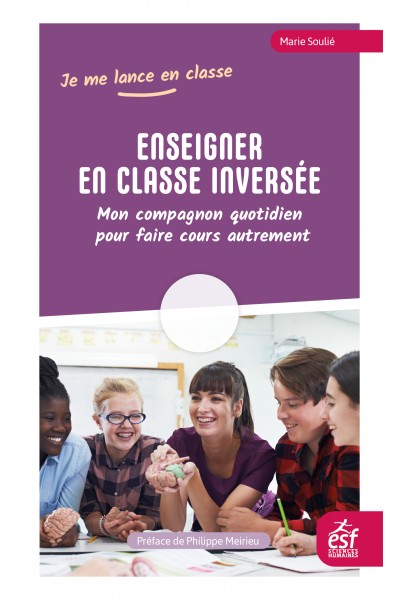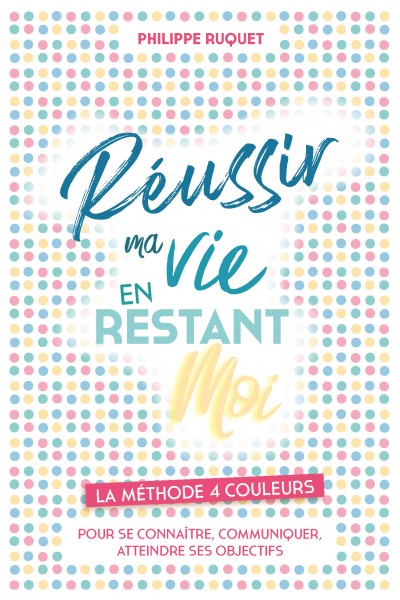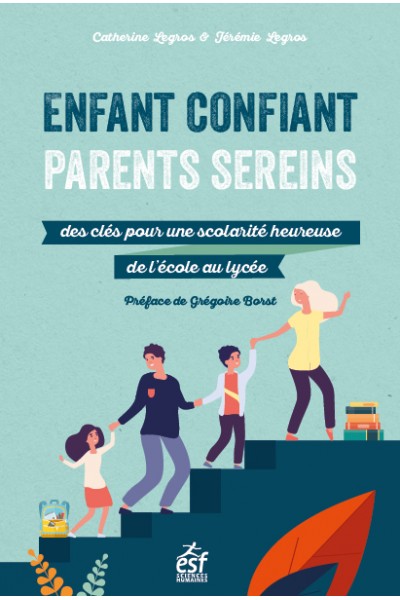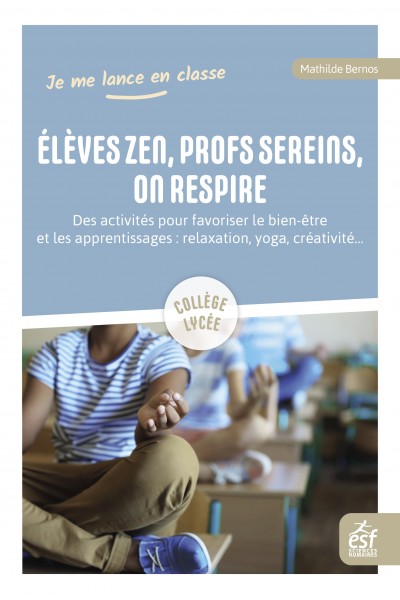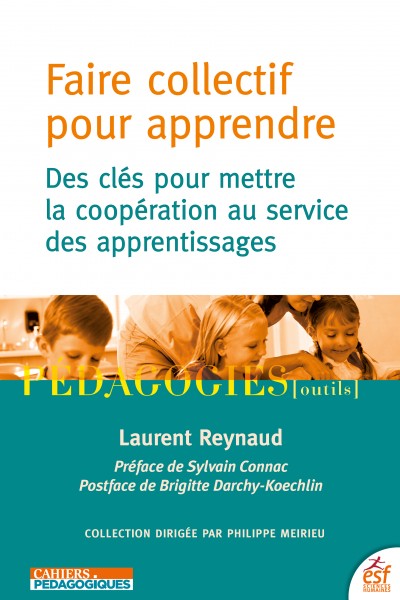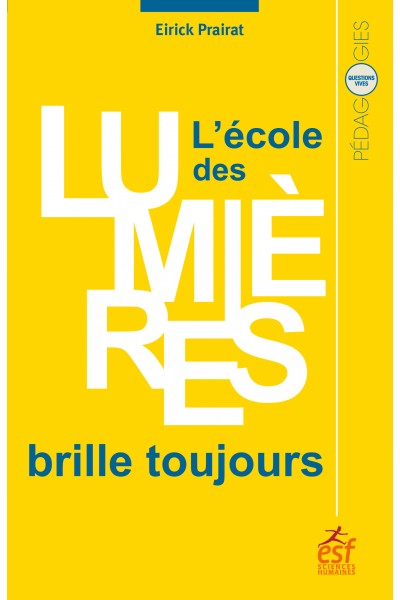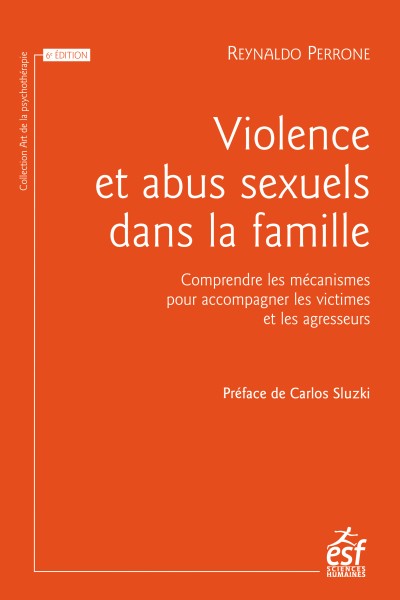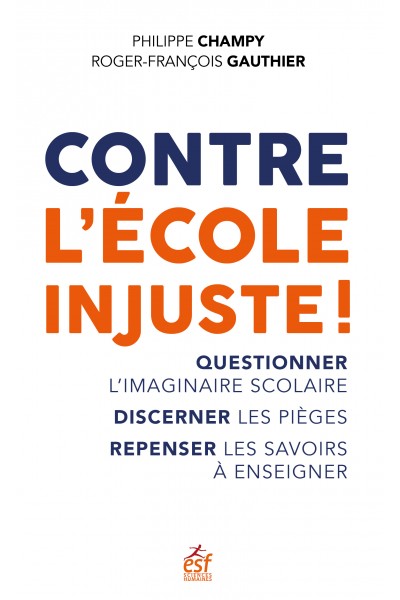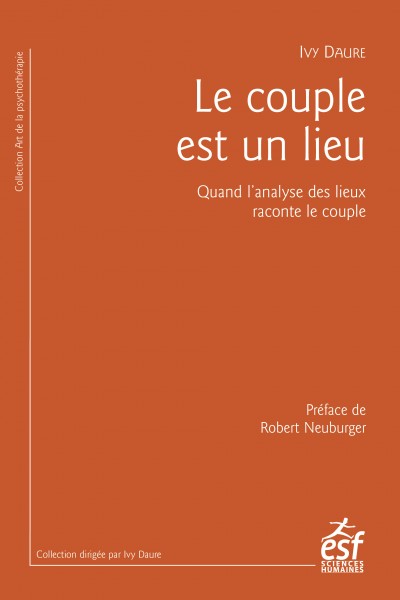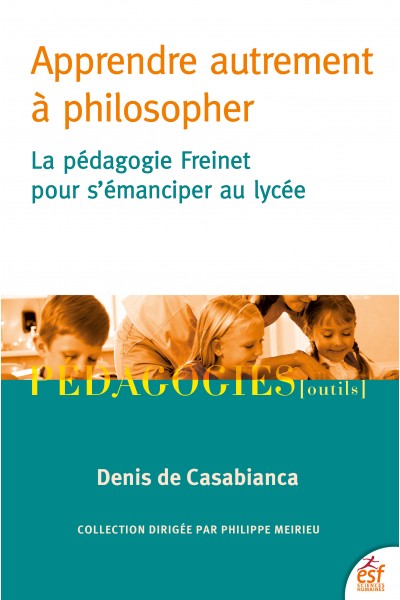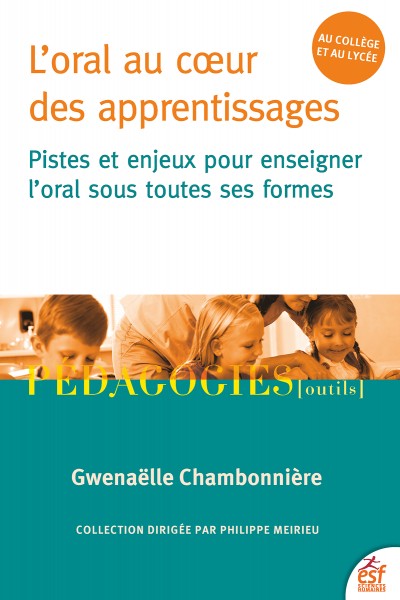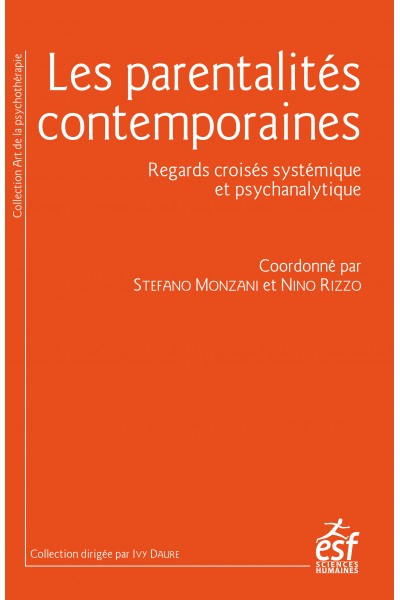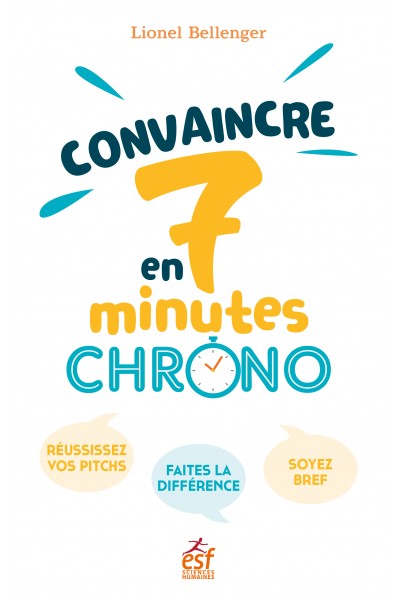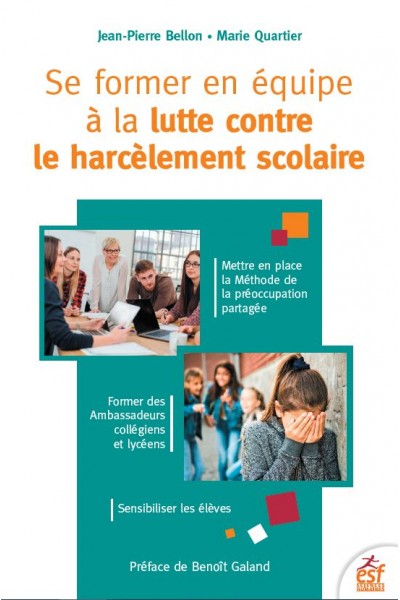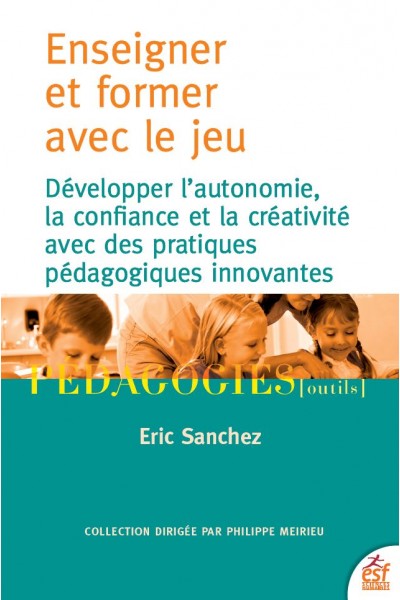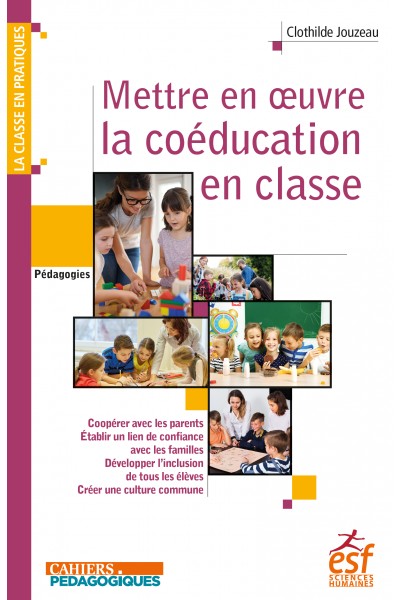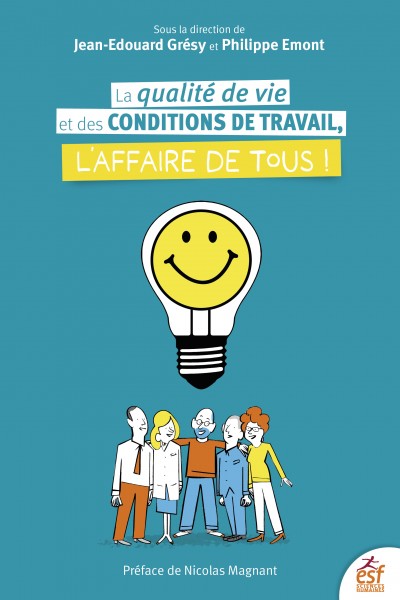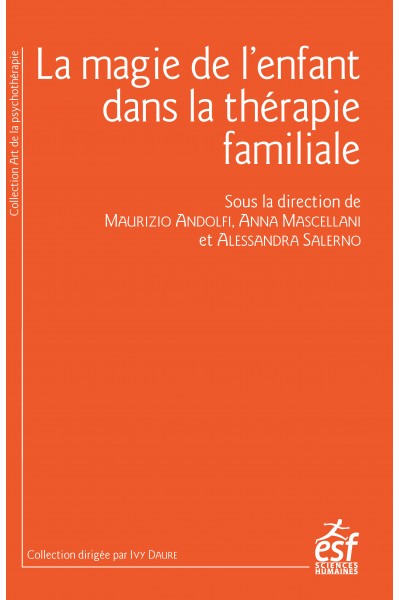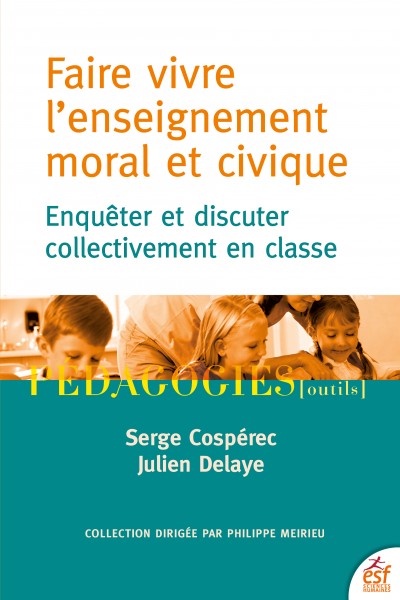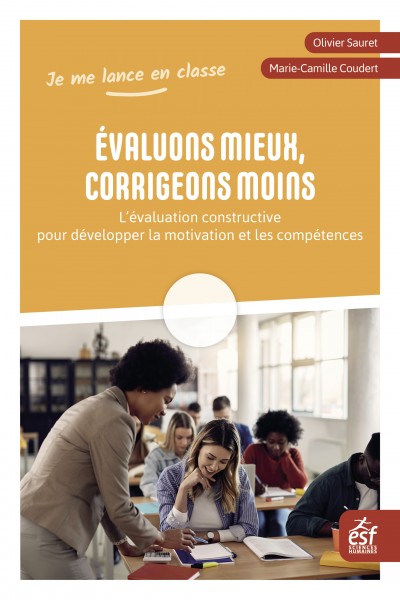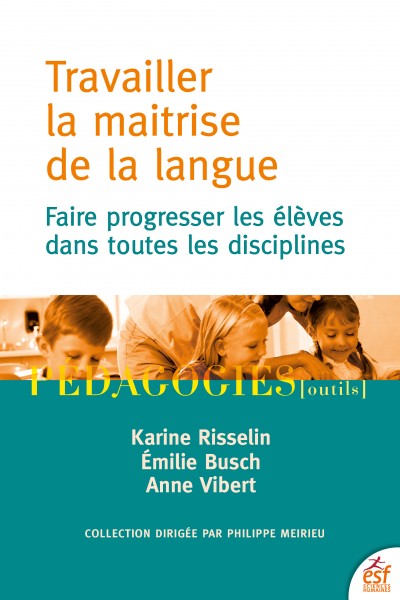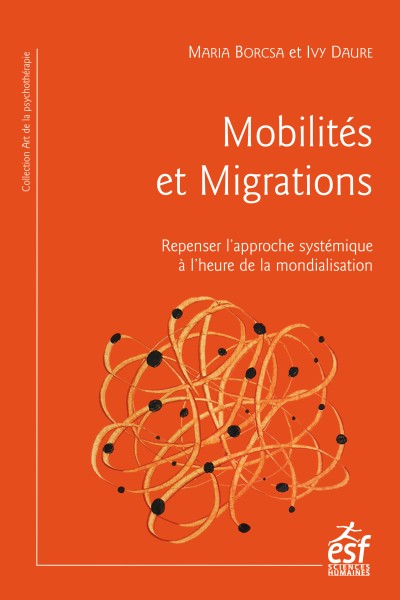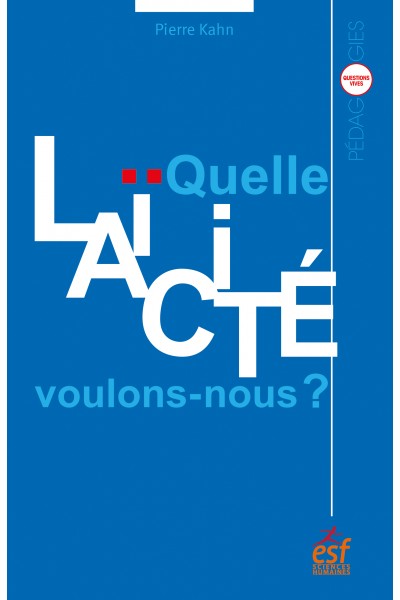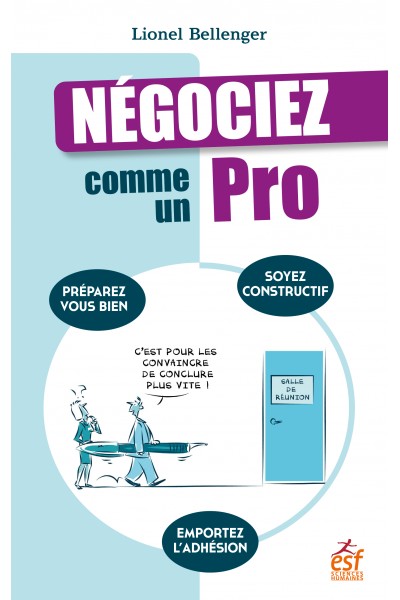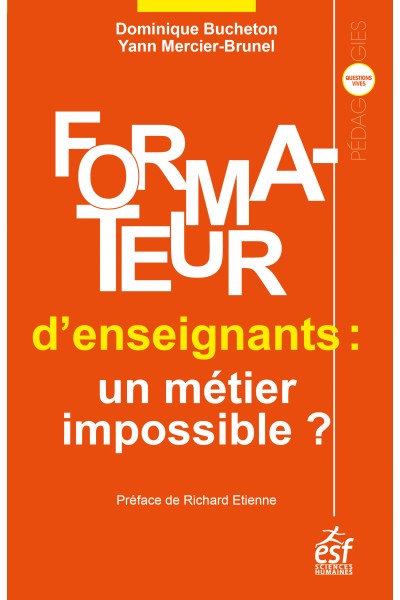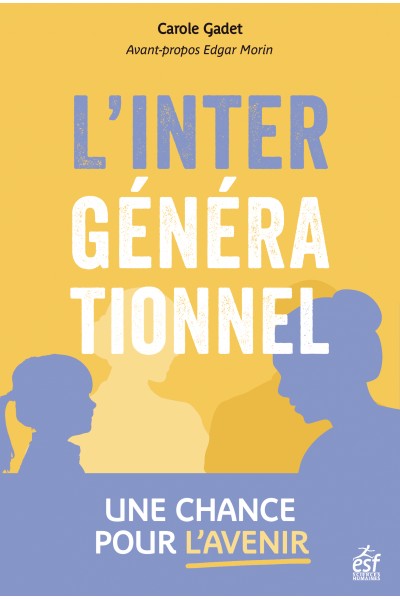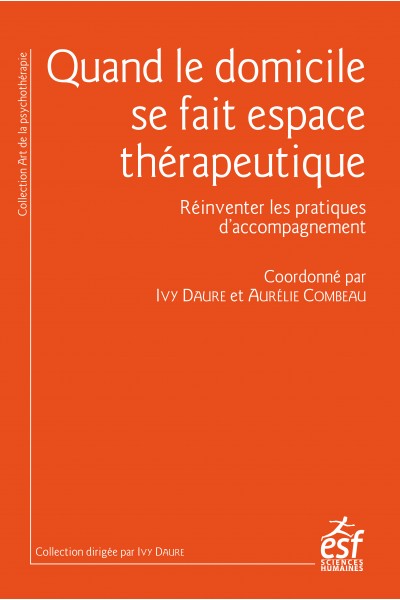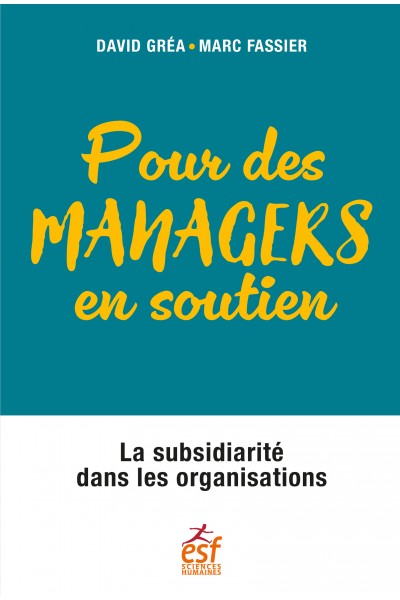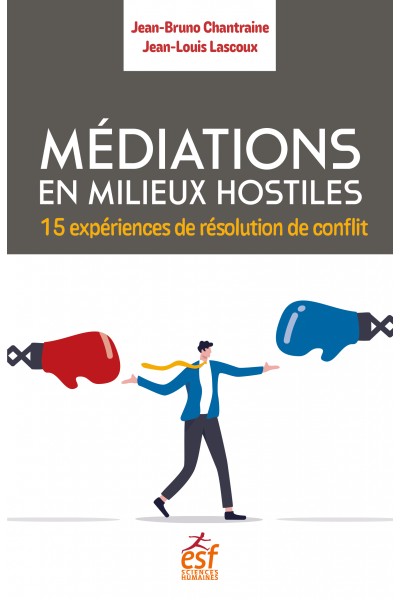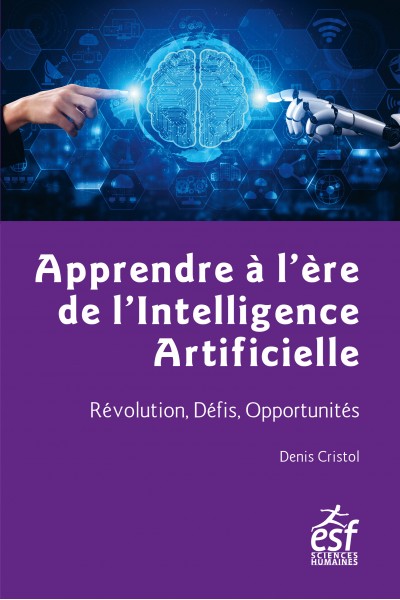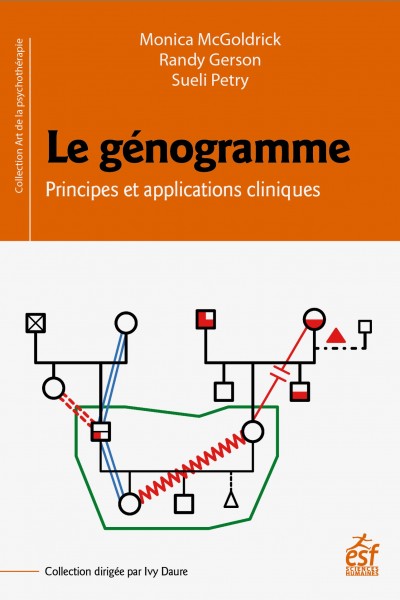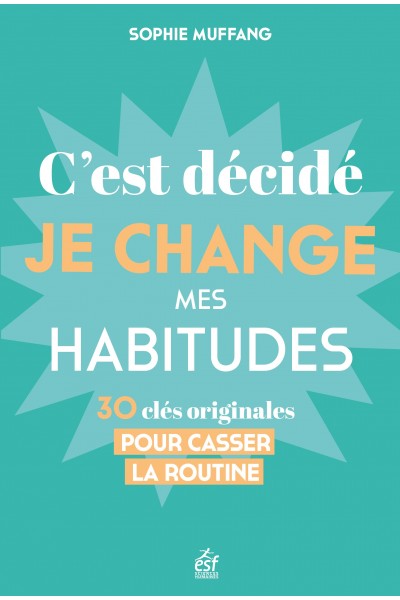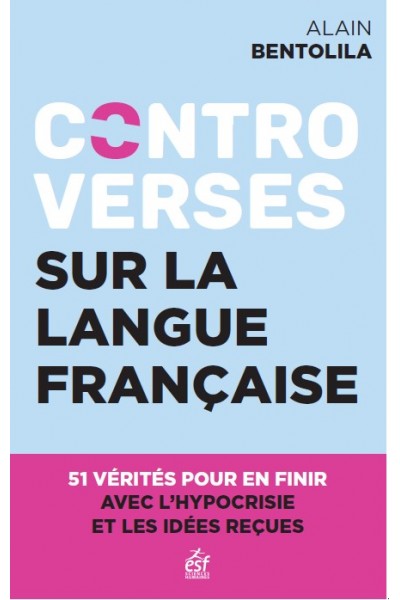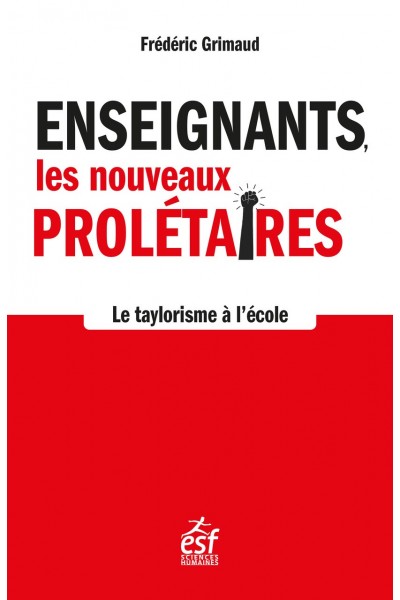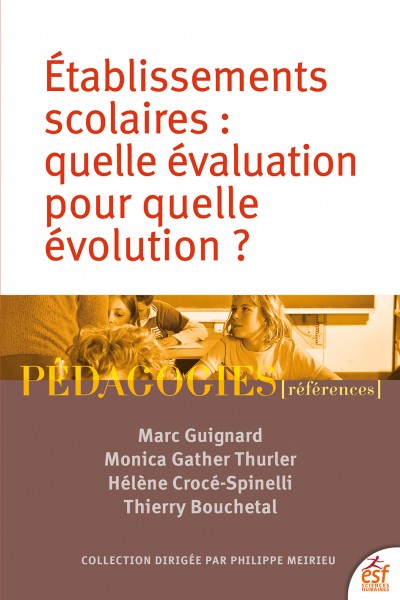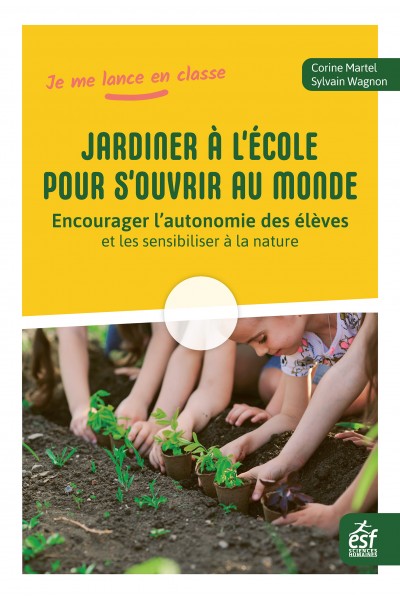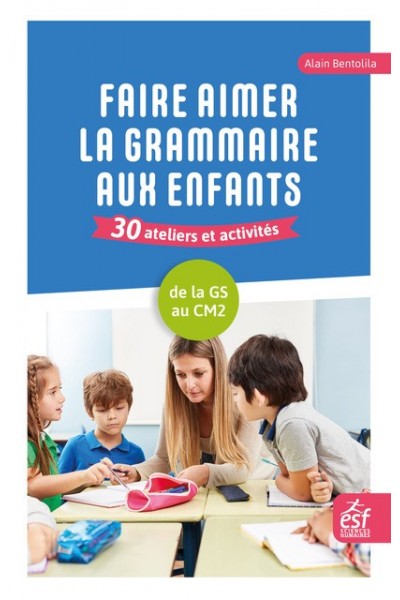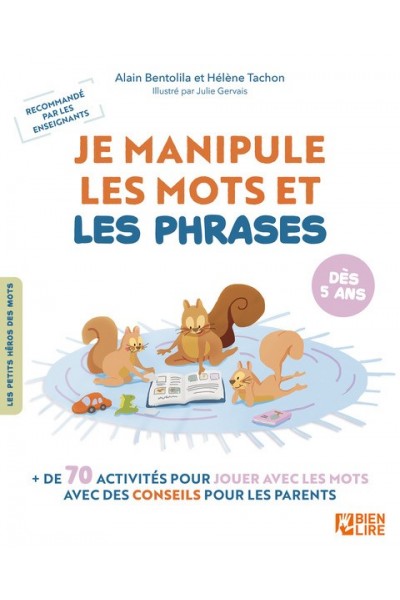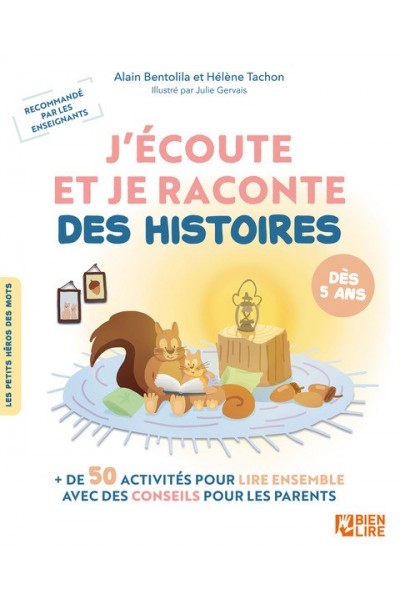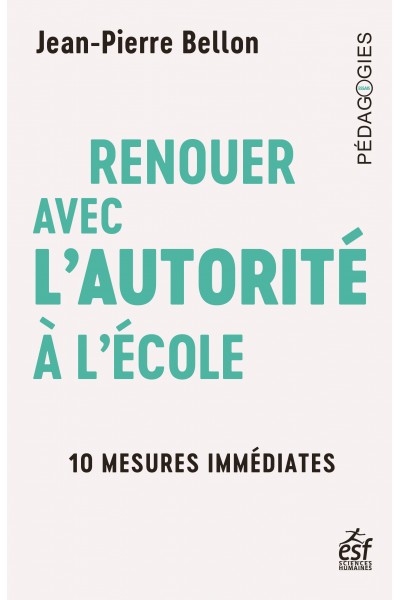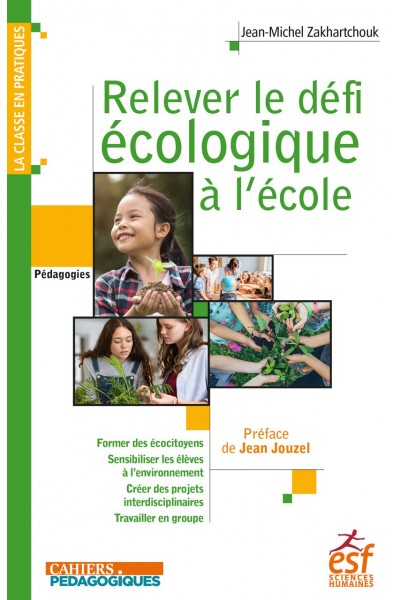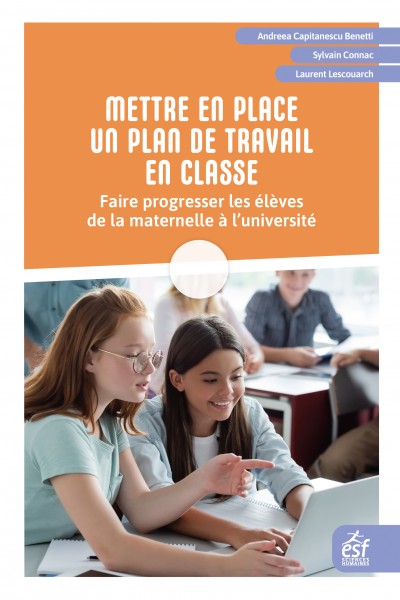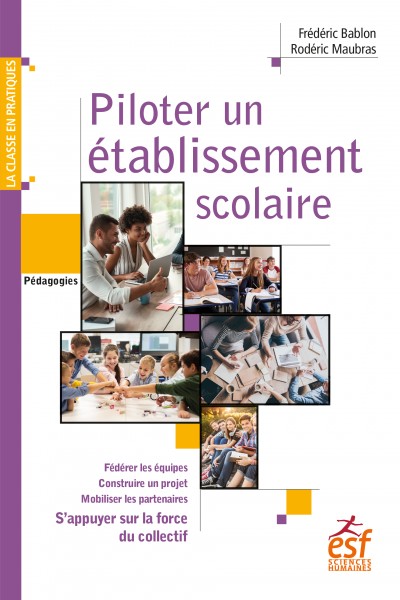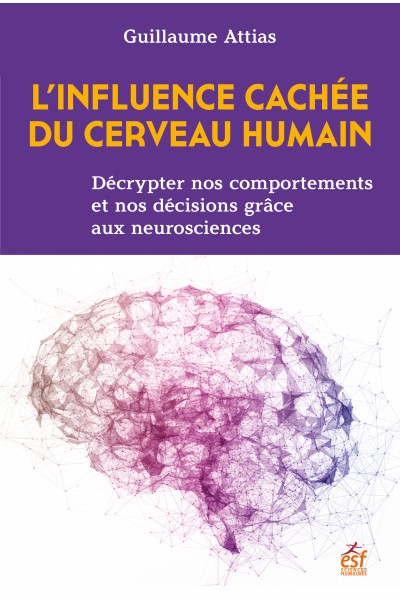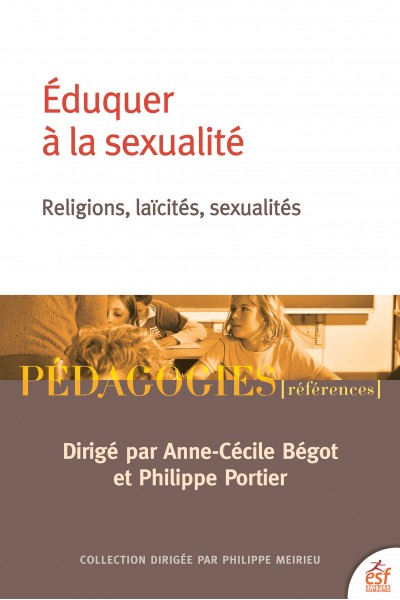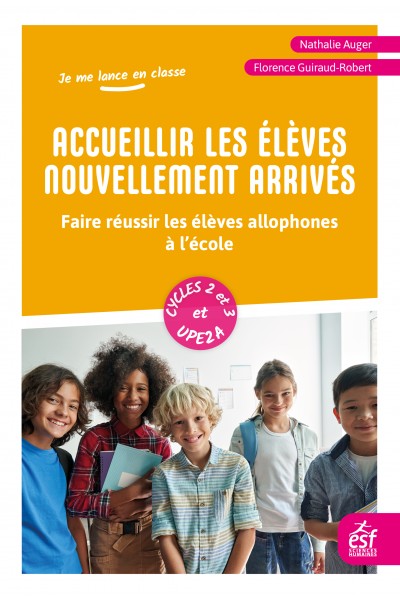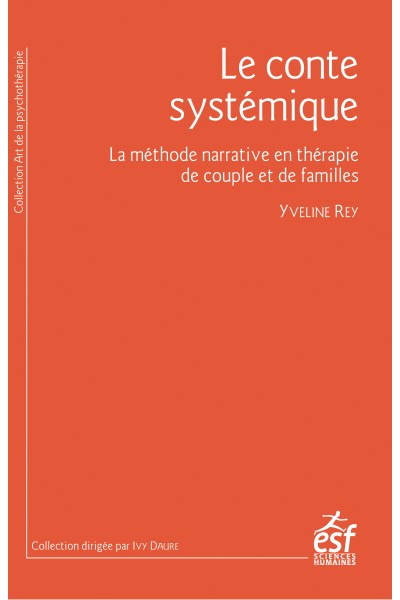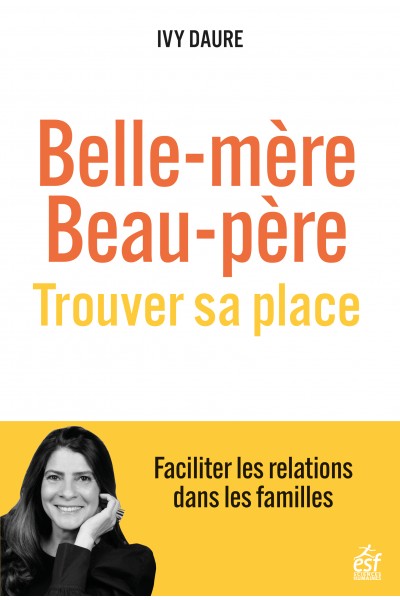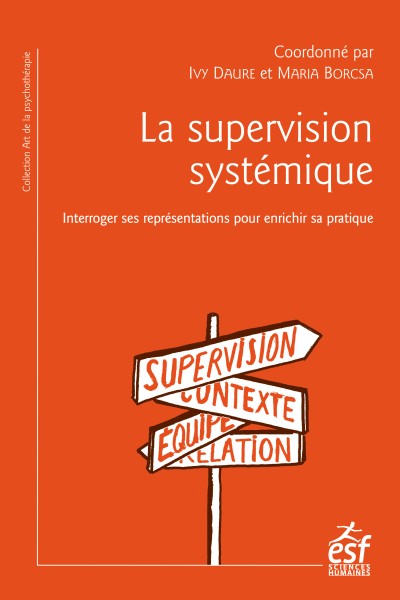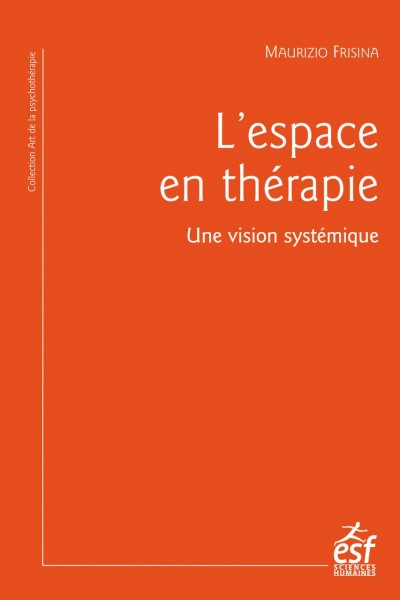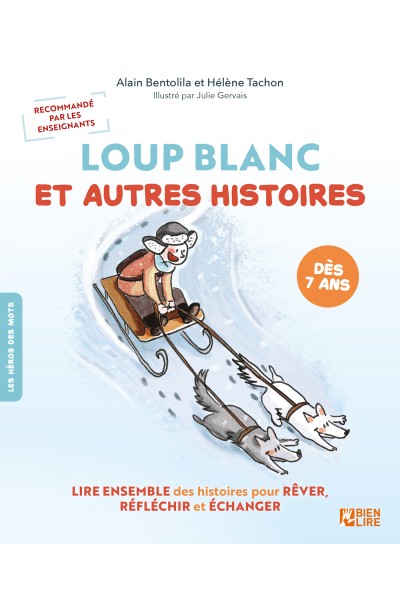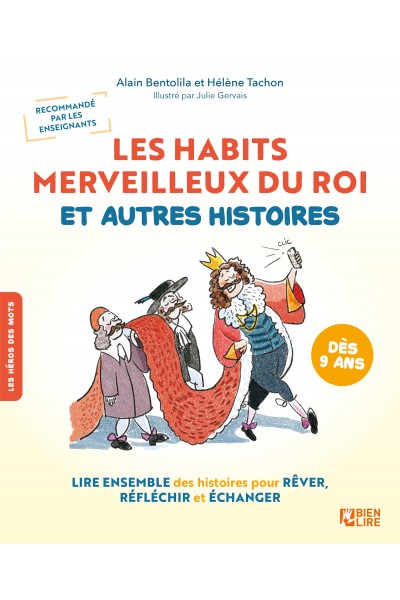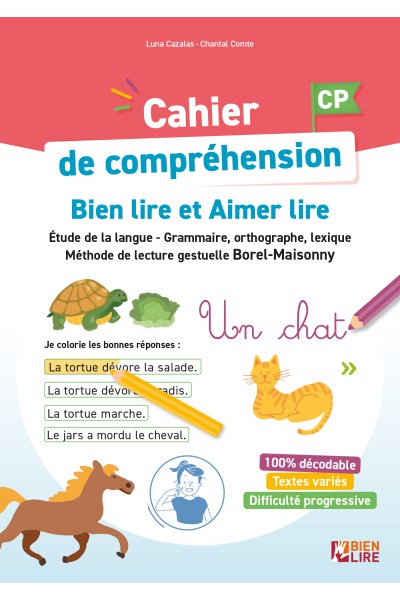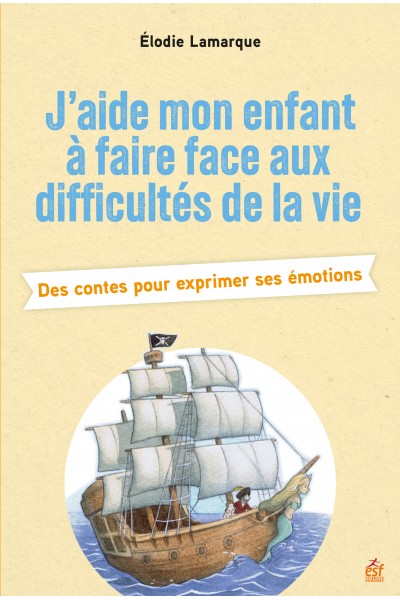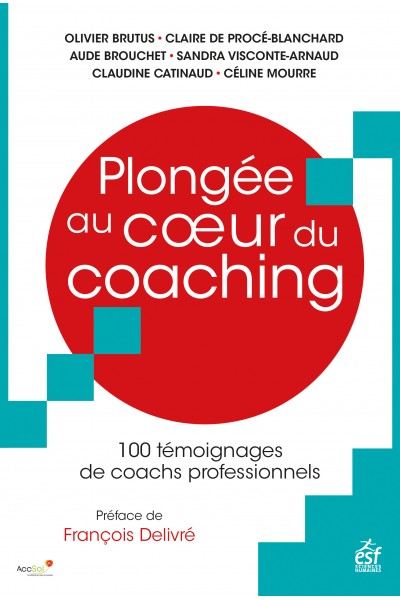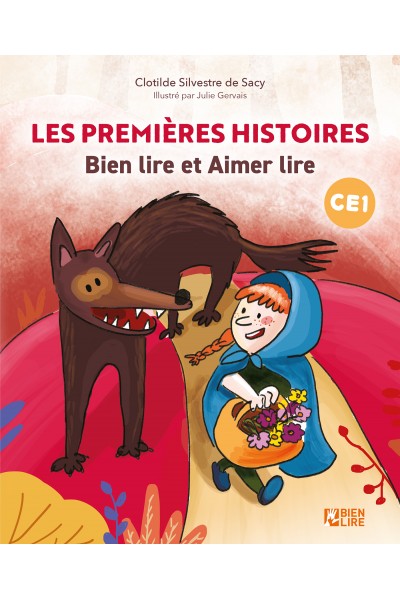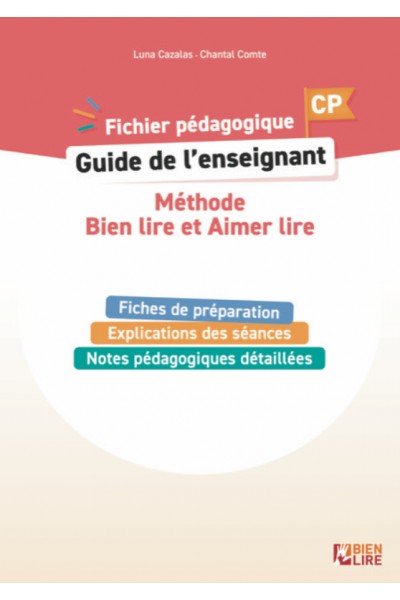-
- Qui sommes-nous
- Contact
Les mots-amis : entretien avec Anne Sardier
Anne Sardier est enseignante-chercheuse en sciences du langage. Elle a enseigné à l’université du Québec à Montréal, à l’université de Limoges et à l’université Clermont-Auvergne. Ses recherches concernent la didactique du lexique, elle développe une réflexion sur la construction de la compétence lexicale et propose aux enseignants des mises en oeuvre novatrices pour l’enseignement-apprentissage du vocabulaire en classe.
Dans son livre Les mots-amis pour progresser en vocabulaire (en librairie le 19 juin), elle présente une approche basée sur la volonté d’enseigner de manière intégrée les trois dimensions du système lexical : la forme des mots, le sens des mots et la cooccurrence entre les mots, pour permettre aux élèves de mieux développer leur vocabulaire.
Que sont les « mots-amis » ?
Les mots-amis sont les cooccurrents fréquents d’un autre mot, c’est-à-dire les mots qu’on utilise souvent les uns avec les autres, c’est pour cette raison qu’on les dit « amis » dans le dispositif proposé. Par exemple, on voit dans l’ouvrage Les mots-amis pour progresser en vocabulaire que les mots-amis de « bruler » peuvent être des noms, parfois concrets comme « bois » ou « cheminée » ou parfois abstraits comme « honte » parce qu’on peut dire « Le bois brule dans la cheminée » ou « La honte brule ses joues ». On voit aussi que les mots-amis de « figure » peuvent être des verbes comme « changer », dans l’expression « changer de figure », ou des adjectifs comme « géométrique ».
Les mots-amis sont une aide précieuse pour comprendre les changements de sens, ils aident aussi à savoir quelles associations sont possibles en réemploi lexical. Les lister, comme proposé dans le dispositif, permet aux élèves d’acquérir un stock de mots qu’il est possible de réemployer ensemble.
En quoi ce dispositif se distingue-t-il des autres méthodes d'apprentissage du vocabulaire ?
Le dispositif est innovant et se distingue des autres méthodes d’apprentissage pour deux raisons principalement : d’abord parce qu’il met l’accent sur les mots-amis pour comprendre et réemployer un mot nouveau, ensuite parce qu’il s’appuie sur la discussion lexicale pour enseigner la stratégie des mots-amis.
Le dispositif propose de lister et catégoriser grammaticalement les mots-amis. Une des difficultés quand on enseigne le vocabulaire peut en effet être son lien permanent avec la grammaire. Par exemple, comprendre le rôle des compléments dans les variations de sens d’un verbe. La catégorisation grammaticale proposée dans le dispositif établit clairement ce lien et en fait même une aide pour les élèves. Elle leur fournit une stratégie complémentaire de celles parfois déjà mises en œuvre, pour acquérir des mots nouveaux. Le dispositif leur permet donc d’accroitre et de structurer ainsi leur vocabulaire.
Dans la démarche proposée, cette stratégie émerge de la discussion lexicale à l’issue de laquelle elle fait l’objet d’un enseignement explicite. Cette activité centrale dans le dispositif des mots-amis est bien expliquée dans l’ouvrage, afin que les enseignants puissent la mettre en œuvre et que les élèves s’approprient la stratégie ainsi enseignée.
Pourquoi est-il important d'articuler ensemble trois dimensions du lexique : sémantique, morphologique et syntagmatique ?
Étant donné que le but est d’aboutir à l’accroissement et à la structuration du lexique, comme le rappellent souvent les programmes pour l’école et le collège, on ne peut pas faire l’impasse sur ces trois dimensions. C’est là un des points fondamentaux en didactique du lexique : prendre appui sur l’organisation du système lexical pour l’enseigner. Le lexique est en effet construit autour de trois grands axes : sa dimension sémantique qui est liée au sens de mots (les différents sens d’un mot, mais aussi les relations de sens entre les mots), sa dimension morphologique (la forme des mots et leurs ‘’familles’’), et sa dimension syntagmatique (les combinaisons des mots dans les énoncés). Ces trois dimensions ne sont pas indépendantes. Or, l’étude de la dimension syntagmatique est fort peu proposée en didactique, à part dans le dispositif des mots-amis. Par exemple, si les élèves comprennent que « bouillonner » est de la famille de « bouillir », et que ces deux verbes portent l’idée d’une agitation, étudier les combinaisons leur permet de savoir qu’on utilise « bouillir » avec les mots « lait », « café » ou « fièvre » et « bouillonner » avec « torrent » ou « sang ». Ils comprennent alors qu’on ne peut pas toujours les employer de manière équivalente. Si ce fonctionnement est explicitement enseigné comme proposé dans l’ouvrage Les mots-amis pour progresser en vocabulaire, les élèves ont alors les moyens de réemployer les mots avec justesse, et ils développent leur compétence lexicale.
Le dispositif est-il applicable facilement dans toutes les classes ?
Le dispositif est tout à fait applicable dans différentes classes. Les choix des mots étudiés dans l’ouvrage ont été effectués entre autres parce qu’ils sont adaptables à différents niveaux. D’ailleurs les expérimentations ont souvent eu lieu dans des classes multi-âges.
La démarche d’enseignement du vocabulaire peut être mise en œuvre dans les classes de cours élémentaires, de cours moyens et en sixième. Elle l’a aussi été en école maternelle. Elle est fondée sur plusieurs principes qu’on retrouve dans les propositions de séquence à tous les niveaux. Par exemple, la démarche prend comme point de départ les représentations des élèves et le scénario lexical qu’ils se sont construit à propos des mots étudiés, elle met en œuvre la discussion lexicale pour approfondir les sens des mots et catégoriser les mots-amis, elle propose des situations d’entrainement, d’emploi et de réemploi, etc. Des solutions sont toujours proposées dans l’ouvrage au cas où les élèves n’auraient pas de représentations des mots étudiés, ou bien au cas où la discussion lexicale aurait du mal à démarrer. On veille toujours à l’adaptabilité du dispositif à différents contextes d’enseignement.
Quels sont les bénéfices de ce dispositif sur la compréhension et l’expression des élèves ?
Le dispositif a d’abord été créé pour favoriser le réemploi lexical. Il part d’une exploration des mots pour mieux en comprendre le fonctionnement et, donc, mieux les comprendre et les réemployer.
Du côté de la compréhension, la recherche a montré que le dispositif des mots-amis donne aux élèves une stratégie leur permettant de comprendre des mots nouveaux en allant chercher des « amis » dans les énoncés. C’est un gain important parce que le contexte général n’est pas toujours éclairant et que plusieurs stratégies sont souvent à utiliser pour comprendre un mot inconnu ou peu connu.
Du côté de l’expression, le dispositif des mots-amis permet aux élèves de faire des choix judicieux entre les combinaisons possibles, comme entre « bouillonner » et « torrent ». Ils les aide ainsi à utiliser des mots polysémiques selon différents sens et à enrichir leurs productions de mots nouveaux comme « torrent » qui est peu connu.
Par ailleurs, en établissant clairement le lien avec la grammaire, il permet de donner plus de cohérence à l’enseignement de la langue. Les catégorisations grammaticales sont alors utiles dans les séances de vocabulaire et, à terme, pour la compréhension de mots et pour l’expression.
En quoi ce dispositif peut-il être particulièrement utile aux les élèves allophones ou en difficulté langagière ?
Le dispositif peut être utile aux élèves allophones ou en difficulté langagière parce qu’il favorise la mémorisation lexicale en proposant une démarche d’exploration des mots et de leur fonctionnement. Le dispositif favorise alors la rétention des mots en mémoire sémantique par catégorisation et combinaison. Grâce aux mots-amis, il permet en effet de mémoriser des listes de verbes, de noms ou d’adjectifs. Il permet aussi de mémoriser ces mots entre eux comme « bruler » avec « bois » et « cheminée » ou comme dans l’expression « changer de figure ». Grâce aux supports qui sont proposés dans l’ouvrage, les élèves peuvent avoir ainsi des structures prêtes à l’emploi si nécessaire. Le dispositif permet donc d’enseigner aux élèves allophones différentes façons de dire pour accroitre leur palette lexicale. Le fait de mettre les mots en correspondance les uns avec les autres, comme le propose le dispositif, favorise leur mémorisation et le développement de la compétence lexicale.
Le livre contient plusieurs séquences prêtes à l’emploi. Comment les avez-vous choisies et construites ?
Outre le fait de suivre la démarche générale du dispositif des mots-amis, plusieurs raisons ont guidé les choix des séquences.
Premièrement, les séquences proposent d’étudier plusieurs mots appartenant à une même classe sémantique comme les verbes de paroles, ou autres. Les mots sélectionnés se font écho. Par exemple, pour expliquer « murmurer », les élèves disent que c’est le contraire de « hurler ». Cette façon de faire contribue aussi au réemploi lexical.
Deuxièmement, plusieurs séquences étudient des verbes, parce qu’ils sont moins souvent explorés que les noms, et parce qu’ils ne fonctionnent pas sans les noms en sujet ou complément. Ils nécessitent donc une étude syntagmatique du lexique et ils sont ainsi étudiés et mémorisés avec les noms qui sont leurs « amis ».
Troisièmement, dans les recherches collaboratives desquelles sont issues les séquences, les choix des mots à étudier ont été effectués avec les enseignants. Ils ont par exemple suggéré d’étudier des verbes de soutien comme s’occuper de, parce qu’ils ont constaté que ces verbes posaient des problèmes de compréhension à leurs élèves.
Quatrièmement, une séquence propose de ne partir non pas de mots présélectionnés, mais du domaine des émotions. Ce choix a été fait parce qu’il correspond aussi à une réalité de la classe. Une séquence propose donc une étude du lexique des émotions avec les mots-amis, en mettant l’accent sur la dimension syntagmatique du lexique pour appareiller par exemple des mots comme « accabler » avec « injure », « tressaillir » avec « effroi », etc.
À partir des recherches en didactique du lexique, les choix ont donc été faits au plus près de la classe.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un enseignant qui souhaite débuter avec ce dispositif ?
Je dirais qu’il est important de se saisir de la démarche générale pour suivre toutes les étapes qui concourent au développement de la compétence lexicale. De la sorte, l’enseignant et ses élèves s’approprient un mode de raisonnement autour des mots, autour de lexique, plus globalement, ils exercent leur vigilance lexicale.
Je dirais aussi que le dispositif leur permet de relier un enseignement via les échanges entre pairs et un enseignement explicite grâce à la discussion lexicale qui est un élément clé du dispositif parce qu’elle favorise une exploration des mots en profondeur grâce aux échanges, et qu’elle se clôt par un enseignement explicite de la stratégie.
Du point de vue de la périodicité enfin, le dispositif des mots-amis propose une démarche pour explorer le fonctionnement d’un corpus de mots. Il est donc possible de le mettre en œuvre plusieurs fois dans l’année, par exemple toutes les deux périodes selon les besoins de la classe.
Et pour terminer, je dirais que le dispositif des mots-amis est, d’après les enseignants, une respiration pour les élèves et pour eux-mêmes, il leur permet de quitter le manuel de français pour découvrir autrement le lexique et faire éclore leur sensibilité lexicale.
Produits associés
Apprendre... oui, mais comment
Des établissements scolaires autonomes ?
Harcèlement scolaire : le vaincre c'est possible
Gérer les risques psychosociaux
Bien lire et Aimer lire - Méthode de lecture CP/CE1
Bien lire et aimer lire - Les premières histoires
Les méthodes qui font réussir les élèves
La relation d'aide et la psychothérapie
Repenser l’échec et la réussite scolaire
Star Wars, un mythe familial
70 exercices pour développer vos soft skills
Pédagogie de l'activité : pour une nouvelle classe inversée
Libérer la parole dans l'entreprise
La dynamique des groupes
Jeux et jeux de rôle en formation
Pratique de la médiation professionnelle
Manager, réussissez dans vos nouvelles responsabilités
L'erreur, un outil pour enseigner
Faire la classe à l'école élémentaire
Frankenstein pédagogue
Elèves difficiles ? Osez les ruses bienveillantes
La personnalisation des apprentissages
Gérer les ingérables
Management et communication : 100 exercices
Développer l'agilité dans l'entreprise
Enseigner en classes hétérogènes
Les TICE en classe, mode d'emploi
Le mythe familial
Où vont les pédagogues ?
Les types de personnalité MBTI et CCTI
100 exercices et études de cas pour la formation
Quatorze leçons de thérapie stratégique
40 exercices ludopédagogiques pour la formation
Autorité au collège, mode d'emploi (L')
Bien lire et aimer lire, les gestes pour découvrir la lecture dès 5 ans
Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages
Concevoir un projet de formation
Concevoir un stage de formation
Construire des compétences dès l'école
Construire votre management d'équipe
Culture au coeur des apprentissages (La)
Dialogue social : prenez la parole !
Donner du sens à l'école
Ecole inclusive : un défi pour l'école (L')
Elèves et professeurs : réussir ensemble
Enfant philosophe, avenir de l'humanité ? (L')
Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre
Enseigner selon les types de personnalité
Enseigner, un métier sous contrôle ?
L'entretien de face à face dans la relation d'aide
Entretien d'explicitation (L')
Gestion des ressources humaines (La)
Jeux psychotiques dans la famille (Les)
Langages du corps en relation d'aide (Les)
Lettre à un jeune professeur
Management des compétences (Le)
Métier d'élève et sens du travail scolaire
Négocier en situations complexes
Outils de base de l'analyse transactionnelle (Les)
Paradoxe et contre-paradoxe
Parents d'élèves, mode d'emploi
Pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui (La)
Pédagogie, dictionnaire des concepts clés
Pédagogie. Des lieux communs aux concepts clés
Pour une anthropologie des savoirs scolaires
Pratique de l'analyse transactionnelle dans la classe
Réussir sa première classe
Réussir ses premiers cours
Réussissez vos recrutements
Eduquer après les attentats
Enjeux éthiques du métier d'enseignant
Pratique de l'ingénierie relationnelle
Alternative lycéenne ! (L')
Éduquer avec le numérique
Le travail collaboratif des enseignants Pourquoi ? Comment ?
Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent
La perversion narcissique, mythes et réalité
Dictionnaire critique des psychothérapies
L'autorité à l'école, mode d'emploi
L'art de vendre
Affiche des gestes Bien Lire et Aimer Lire
Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution sociothérapeutique
Les neurosciences cognitives dans la classe
Osez les pédagogies coopératives au collège et au lycée
Réforme de la formation professionnelle
Au cœur de la psychothérapie
Quand les animaux inspirent l'entreprise
Éduquer l'attention
Réussir avec le Digital learning
L’accompagnement thérapeutique des hauts potentiels
À quoi servent les sciences de l'éducation ?
Différencier son enseignement au collège et au lycée
Éduquer entre engagement et lucidité
Alzheimer autrement - 100 activités pour plus de vie
Dictionnaire encyclopédique de la médiation
Enseigner avec les erreurs des élèves
Inverser la classe
Management et innovation - 60 nouveaux exercices
Quand l'école prétend préparer à la vie...
Reconnaître et accompagner les élèves à haut potentiel
Enseignants et élèves en souffrance
Former les enseignants
L'art de la facilitation
Jouer des compétences pour évoluer et s'orienter
Réinventez vos formations avec les neurosciences
Les gestes professionnels dans la classe
Les blessures de l'école
Mon cahier d'exercices pour Bien Lire et Aimer Lire
Un instit ne devrait pas avoir à dire ça !
Une rentrée sereine en élémentaire, ça se prépare
Une rentrée sereine en maternelle, ça se prépare
Un cadre serein dans sa classe, ça se construit
Construire ensemble l'école d'après
La coopération, ça s'apprend
Cultivez vos soft skills
365 jours pour prendre soin de moi
Ils ont garé le bus devant le but, pourtant on a réussi à marquer
Quelle posture enseignante pour une relation éducative apaisée ?
Accompagner les élèves Dys, c'est possible !
Le défi d'une évaluation à visage humain
Quand le cerveau apprend
Médiation de la consommation, le guide pratique
Évaluer autrement, c'est possible !
Dictionnaire inattendu de pédagogie
Améliorer le climat scolaire
100 outils pour réussir dans votre job
Innover en formation avec les multimodalités
Devenir formateur d’enseignants
Enseigner en Segpa, même pas peur !
Réussir ma vie en restant Moi
Enfant confiant, parents sereins
Élèves zen, profs sereins, on respire
Faire collectif pour apprendre
Violence et abus sexuels dans la famille
Contre l'école injuste
J'aide mon enfant à dire stop au harcèlement
L'oral au cœur des apprentissages
Convaincre en 7 minutes chrono
J'arrête de courir après le temps
Enseigner et former avec le jeu
Mettre en œuvre la coéducation en classe
La magie de l'enfant dans la thérapie familiale
Faire vivre l'enseignement moral et civique
Évaluons mieux, corrigeons moins
Travailler la maitrise de la langue
La pédagogie Freinet en maternelle : comment faire ?
Négociez comme un pro
Formateur d'enseignants, un métier impossible ?
L'intergénérationnel, une chance pour l'avenir !
Quand le domicile se fait espace thérapeutique
Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle
Controverses sur la langue française
Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde
Restaurer le lien social en situations extrêmes
Relever le défi écologique à l'école
Mettre en place un plan de travail en classe
L'influence cachée du cerveau humain
Accueillir les élèves nouvellement arrivés
Belle-mère, beau-père. Trouver sa place
Loup blanc et autres histoires
Les habits merveilleux du roi et autres histoires
Méthode de lecture Bien lire et Aimer lire
Cahier de compréhension Bien lire et Aimer lire
Cahier d'exercices Bien lire et Aimer lire
J'aide mon enfant à faire face aux difficultés de la vie
Articles similaires
 ESF Sciences Humaines se lance dans les podcasts !
ESF Sciences Humaines se lance dans les podcasts !
 Entretien avec Marie-Josée Couchaere, auteure de Cultivez vos softs skills
Entretien avec Marie-Josée Couchaere, auteure de Cultivez vos softs skills
 L'évaluation à visage humain : entretien avec Charles Hadji
L'évaluation à visage humain : entretien avec Charles Hadji
 Accompagner les élèves Dys, c'est possible : entretien avec Isabelle Ducos-Filippi
Accompagner les élèves Dys, c'est possible : entretien avec Isabelle Ducos-Filippi
 Respirado, ton livre zen pour être bien dans ton corps, ta tête et ton cœur : entretien avec Mathilde Bernos et Emilie Top-Labonne
Respirado, ton livre zen pour être bien dans ton corps, ta tête et ton cœur : entretien avec Mathilde Bernos et Emilie Top-Labonne
© ESF Sciences Humaines 2019 . Tous droits réservés . Mentions Légales . cgv . Confidentialité